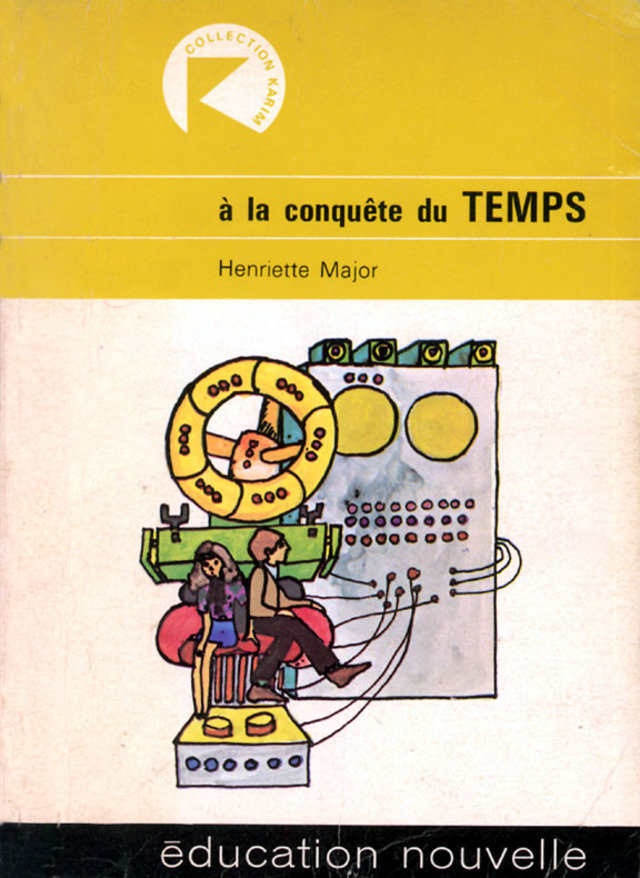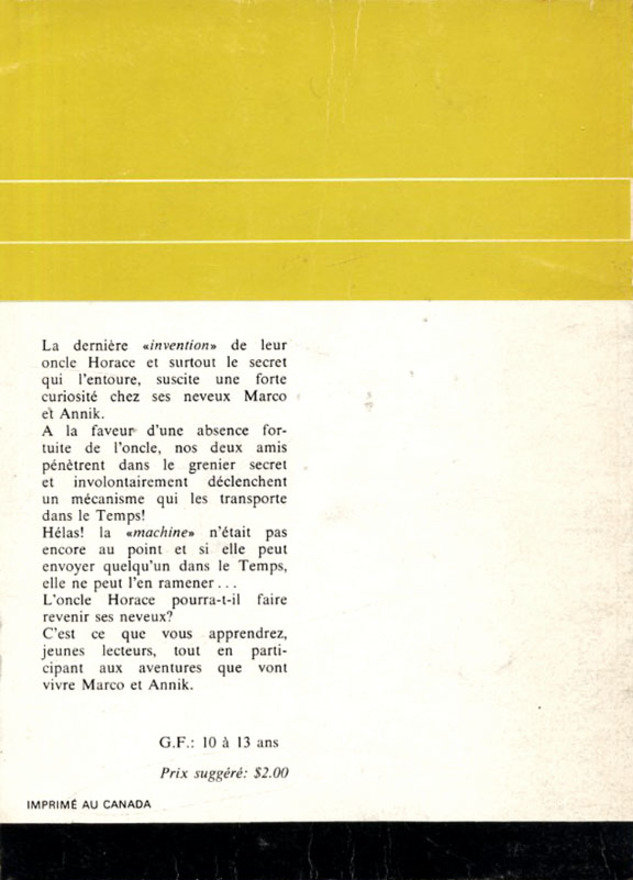À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
Annik et Marco voudraient bien découvrir quelle invention occupe leur oncle Horace dans le grenier de la maison en cet été de 1969. Profitant de l’absence momentanée de l’inventeur, les deux enfants se faufilent dans la pièce où ils voient un ancien fauteuil de barbier relié par des fils à un panneau de contrôle. En voulant s’asseoir dans la chaise, les enfants mettent accidentellement en marche la machine à voyager dans le temps et se trouvent transportés en 1669 sur l’île Jésus.
Les deux jeunes citadins, après avoir repris leurs sens et évalué la situation, rencontrent un couple d’Indiens – un adulte et un jeune de leur âge, Aroutak – qui arrive en canot. Ils suivent les deux Indiens, non sans être retournés auparavant sur les lieux de leur déportation où ils récupèrent un sac à dos contenant des vêtements, une lampe de poche et un message que leur a envoyé leur oncle. Ils sont accueillis avec méfiance au village amérindien mais quand Marco allume la lampe de poche, il fait sensation et les Indiens le prennent pour un dieu. Les deux enfants sont alors adoptés par la tribu.
Lors d’une expédition de chasse, le lendemain, Marco et Aroutak délivrent Étienne Brûlé, un coureur des bois tombé dans une trappe d’ours. Soigné par le sorcier du village, Brûlé conseille aux deux jeunes Blancs de fuir car étant considérés comme les enfants du grand chef, ils pourraient faire un jour les frais d’une guerre entre tribus. Étienne Brûlé les aide à s’échapper et les confie à la famille Mailloux qui exploite une ferme à l’extérieur du fort de Ville-Marie. C’est à la faveur d’une visite au marché public en compagnie de Joseph et de Guillaume Mailloux que doit se faire le retour des enfants à leur époque selon les instructions envoyées entre-temps par leur oncle. L’opération doit se dérouler dans la boutique d’un antiquaire que connaît l’épouse d’Horace, laquelle est située à l’emplacement de l’auberge de la Mère Flavie en 1669, une parente de Joseph Mailloux.
Commentaires
Henriette Major a certes été, avec Paule Daveluy, Cécile Gagnon, Monique Corriveau et Suzanne Martel, une pionnière de la littérature jeunesse au Québec. Son œuvre lui a valu plusieurs prix littéraires. Toutefois, À la conquête du temps, publié au début de sa carrière, fait voir rapidement ses limites comme œuvre de fiction et davantage comme roman de science-fiction. L’auteure évoque d’ailleurs ce terme à la dernière page devant la possibilité que l’invention d’Horace permette un jour de voyager dans le futur. Il est clair que le récit d’Henriette Major, au demeurant charmant, relève du cours d’histoire et non d’une intention d’exploiter les multiples possibilités de la science-fiction. Ainsi, malgré le fait que les enfants rencontrent des personnages historiques – Étienne Brûlé, Marguerite Bourgeoys –, leurs actions ne risquent pas de modifier la trame du passé. Le thème du paradoxe temporel n’est jamais effleuré ou évoqué.
À la conquête du temps s’avère donc un prétexte à revisiter l’histoire du Québec à l’époque de la Nouvelle-France, et plus particulièrement Ville-Marie. Il aurait été plus audacieux d’envoyer les deux enfants dans le futur plutôt que dans le passé et cela aurait sollicité davantage l’imagination des jeunes lecteurs mais, au moins, l’auteure ne les a pas expédiés en Europe à l’époque du Moyen Âge (un cliché récurrent en littérature jeunesse de nos jours). Il y a une volonté pédagogique certaine de la part de Major de présenter des personnages historiques et de familiariser les jeunes lecteurs aux mœurs et à la culture amérindiennes. Le portrait qu’elle esquisse de la réalité quotidienne autochtone est juste et nuancé, tout comme celui des conditions de vie des colons. Il se dégage en outre du contact des Amérindiens et des Blancs un sentiment de respect et de tolérance.
Par ailleurs, on sent chez Major le souci d’équilibrer la représentation garçon/fille dans le roman mais force est d’admettre que Marco est plus assuré et mature dans ses prises de décision et possède un bagage de connaissances plus « utile » et étendu. Quand les deux enfants reprennent conscience après avoir été transportés en 1669, la première phrase d’Annik est : « Qu’est-ce que nous faisons ici ? pleurnicha Annick. » Consciemment ou non, Henriette Major accrédite ici un stéréotype féminin.
Malgré tout, le propos d’À la conquête du temps est fort pertinent et maintient l’intérêt du lecteur. C’est plutôt en ce qui concerne la narration que le roman déçoit quelque peu car il comporte plusieurs invraisemblances et incohérences. La rapidité avec laquelle l’oncle Horace met au point de nouvelles inventions est tout à fait irréaliste, sinon risible. Les descriptions sont simplistes, quand l’auteure ne se borne pas tout simplement à les énumérer : la bicyclette volante, la machine à enfiler les aiguilles, le macadam élastique et la radio trans-époque, envoyée au XVIIe siècle par l’oncle pour communiquer avec les enfants, qui joue un rôle bien mineur.
Les incohérences sont plus gênantes. Les deux Indiens rencontrés lors du premier contact portent « sur leur tête un léger canot » pour éviter les rapides de la rivière. Aussitôt ceux-ci contournés, « on met les canots à l’eau ». Ailleurs, l’auteure attribue le nom de l’Indien adulte (Tawiskara) au plus jeune (Aroutak). Un autre exemple : Annik aimerait donner en cadeau à Agnès Mailloux un bonnet en dentelle pour la remercier d’avoir cédé un bijou aux Indiens en échange de sa liberté mais elle n’a pas d’argent pour en acheter un au marché de Ville-Marie. C’est Marguerite Bourgeoys qui lui en fait cadeau – un prétexte, dirait-on, pour mettre en vitrine ce personnage historique. Pourtant, Annik portait un bonnet puisqu’elle en a un quand elle revient en 1969 : « […] une petite fille en robe de calicot, en sabots et en bonnet blanc se matérialisa au milieu de la pièce. » Il y a plusieurs petits détails de ce genre qui agacent et témoignent d’un manque d’expérience, tant de l’auteure que de la direction littéraire.
À la conquête du temps n’est pas un roman médiocre, loin de là – il faut se rappeler que la littérature jeunesse au Québec en 1970 en est à ses débuts –, mais il n’a pas l’importance historique du roman de Suzanne Martel, Quatre Montréalais en l’an 3000, paru en 1963. [CJ]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 304-306.
Références
- Lortie, Alain, Requiem 17, p. 7.