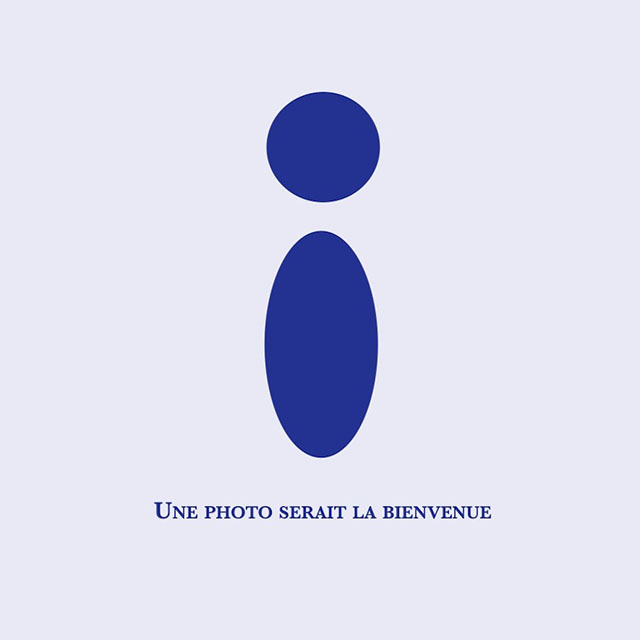À propos de cette édition

Résumé/Sommaire
Amiantis a envahi l’Asbestasie et retient Asbesta en otage en Amiantide tandis que quatre villes rebelles bombardent le pays avec du métal en fusion. Les femmes et les bambins de moins de cinq ans vivent sous un dôme pendant que les enfants et les adolescents travaillent dans les mines et que les hommes font la guerre. De retour dans son pays, Amiantis, conseillé par Asbesta, met à contribution ses castors et les loutres de la jeune femme pour construire un barrage qui inondera le territoire afin d’éviter que le métal, en refroidissant, rende le sol infertile à jamais. Les femmes et les enfants sont évacués du dôme à bord de radeaux tandis que les jeunes et les hommes sont laissés à eux-mêmes.
Commentaires
Quel texte étrange et sibyllin de Jean-Jules Richard ! Celui-ci est l’auteur méconnu du roman Le Feu dans l’amiante, paru en 1956, une étude sociale réaliste ayant pour cadre la grève de l’amiante de 1949 qui a marqué l’histoire du syndicalisme au Québec. À part le titre qui fait allusion de façon transparente à l’amiante et à Asbestos et même si l’amiantose est évoquée dans « Amiantis et Asbesta », il n’y a aucun rapport entre ce texte, sous-titré Légende, et le roman, tant dans la forme que dans le contenu.
S’agit-il d’une allégorie politique ? Ce cri du cœur devant une catastrophe anticipée se veut-il un pamphlet écologique ? Il est beaucoup question des minéraux contenus dans le sous-sol qui évoquent les richesses naturelles du territoire québécois. Le nom des villes est d’ailleurs étroitement associé à un métal : Ferrum, Aluminia, Magnésiome, Silicatt. Et ce barrage qui inonde l’Amiantide (réminiscence de l’Atlantide) ne rappelle-t-il pas la construction des grands barrages hydroélectriques des années 1960 et 1970 ?
Jean-Jules Richard utilise l’hyperbole et le symbolisme pour conférer à son récit les accents d’une tragédie grecque en sol québécois. L’amour ou la confiance d’Asbesta à l’égard d’Amiantis n’est pas payé de retour puisqu’il noie la jeune femme, l’accusant d’être porteuse de l’amiantose. Asbesta apparaît comme une victime du destin. On est aussi dans l’épopée avec une figure de Messie qui guide les survivants du dôme vers une terre plus accueillante.
Au passage, l’auteur brosse un portrait peu flatteur des hommes (« Ils font de la politique ! »). Il est encore plus cinglant envers les jeunes qui passent leur temps à fumer du chanvre et à suivre des « cours d’inquiétude » : « Les jeunes ne veulent rien savoir. Ils ont refusé de faire les récoltes. Ils se sont laissé pousser la barbe et les cheveux et, avec les filles, ils sont allés se complaire dans la pineraie. » Pensez-vous comme moi aux hippies ? Étonnante, tout de même, cette charge quand on sait que l’auteur du Journal d’un hobo (1965) a bourlingué dans sa jeunesse.
« Amiantis et Asbesta » me fait penser à un croisement d’une nouvelle d’André Carpentier (« Le “Aum” de la ville ») et du cycle Les Chroniques infernales d’Esther Rochon, particulièrement Aboli (les enfers froids). Jean-Jules Richard n’a cependant pas la maîtrise de ces deux auteurs qui décrivent un univers tout aussi irrationnel. Son écriture est chaotique et ne parvient pas à organiser en un récit conséquent une succession de flashs prometteurs. Le texte comporte des revirements inexplicables, fait trop peu de cas de la mise en contexte des enjeux politiques – pourquoi les quatre villes rebelles bombardent-elles l’Amiantide dont elles font partie ? – et laisse dans l’ombre des pans de l’histoire. En bout de ligne, le lecteur n’arrive pas à saisir l’intention de l’auteur. Vision eschatologique ou espoir de rédemption ?
À la fois politique, écologique, sociologique et féministe – les femmes sont sauvées, les hommes sacrifiés –, le texte de Jean-Jules Richard ne réussit pas à fusionner tous ces courants qui le travaillent en une œuvre forte qui marque les esprits. Mais quel écrit étonnant tout de même ! [CJ]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 330-332.