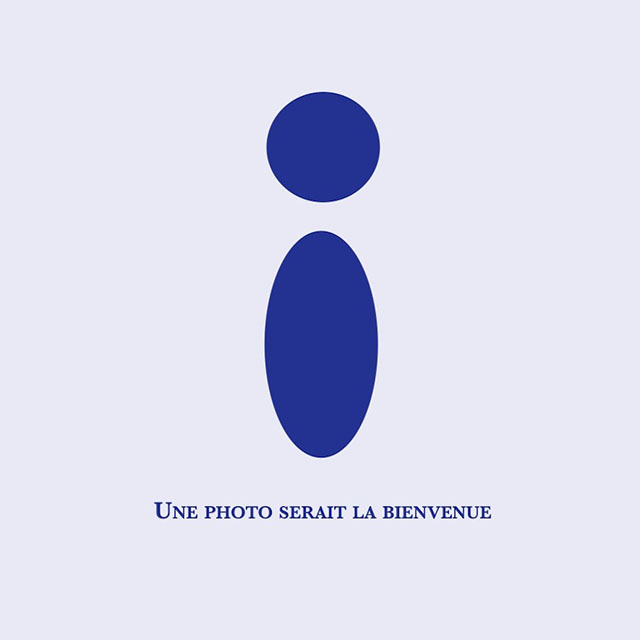À propos de cette édition

Résumé/Sommaire
KRAB est enchaîné, un collier au cou, à MARS, leurs deux corps d’« anormaux » séparés par un mur, la chaîne passant par une fenêtre. Ils sont prisonniers de BAXUS, le chef adolescent des soldats. Hanté par le souvenir de sa femme LAGHDA et de son fils VERSAM, qui a survécu à l’extermination des enfants en choisissant le « long sommeil », KRAB ne pense qu’à se libérer et à se venger de BAXUS. Il est prêt à tout pour y arriver, même sacrifier, à l’aide d’un bout de toile transformée en corde d’escalade et de pendaison, son compagnon d’infortune, MARS.
Commentaires
S’ouvrant in medias res, cette courte nouvelle de science-fiction de Dan May demeure tout au long mystérieuse, distillant au compte-gouttes les indices d’un monde dystopique. Ainsi, si l’on voit poindre à l’occasion les signes d’un régime autoritaire, policier et génocidaire, aucun indice historique ou géographique, à l’exception de l’omniprésence du sable, ne nous permet d’identifier le cadre de référence. Dans une simplicité narrative d’une grande efficacité, toute la nouvelle est entièrement focalisée sur cet homme, KRAB, prisonnier et humilié, sur sa volonté inébranlable à lutter contre l’aliénation de sa condition et à se libérer de ses chaînes à tout prix.
Une des particularités formelles de la nouvelle est la constante utilisation des guillemets pour les mots les plus simples. Celle-ci met en évidence l’étrangeté de ce monde, du contexte dans lequel se retrouvent les personnages, en montrant que le langage est en crise, qu’il ne suffit plus à dire le réel. Un « collier » n’est pas vraiment un collier, de même pour « l’homme blanc », les « soldats », les « civils », la « chaîne » ou le « long sommeil » qui ne semblent pas tout à fait évoquer leur référent habituel.
De manière plus originale, même les verbes les plus simples, par exemple, « savait » ou « rêvait », sont marqués de l’incertitude des guillemets. Cette stratégie de distanciation cognitive est particulièrement économe, mais elle échoue (volontairement) à transmettre la moindre information sur ce monde, sinon son « léger » décalage par rapport au nôtre. Les mots ne sont jamais étrangers, inventés ou reconfigurés, comme c’est souvent le cas en science-fiction, ils ne font que lutter contre l’aliénation par la mise à distance, par le refus de la normalisation des situations qu’ils décrivent. [ED]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 309.