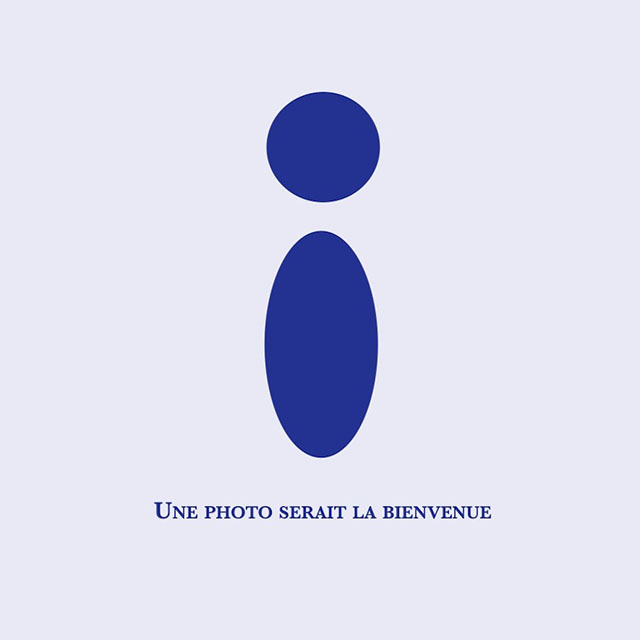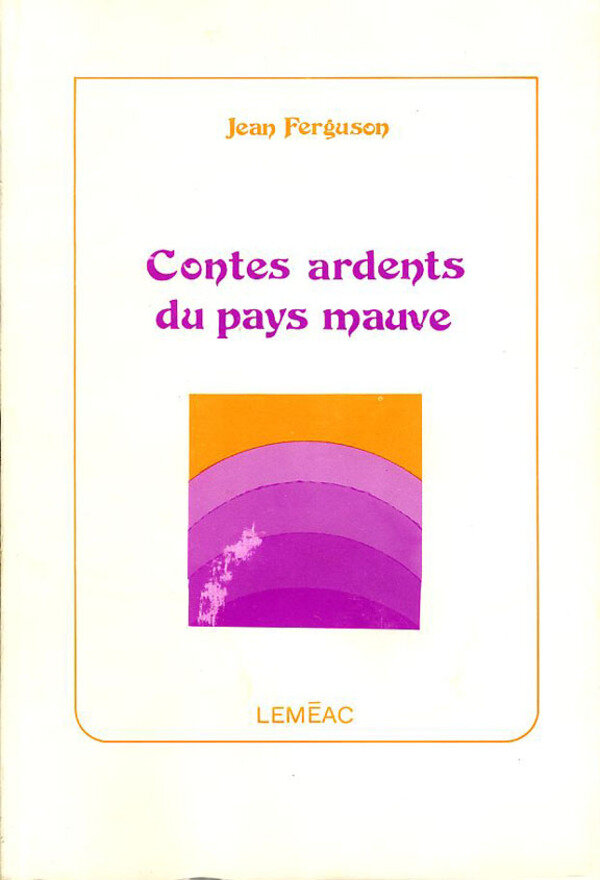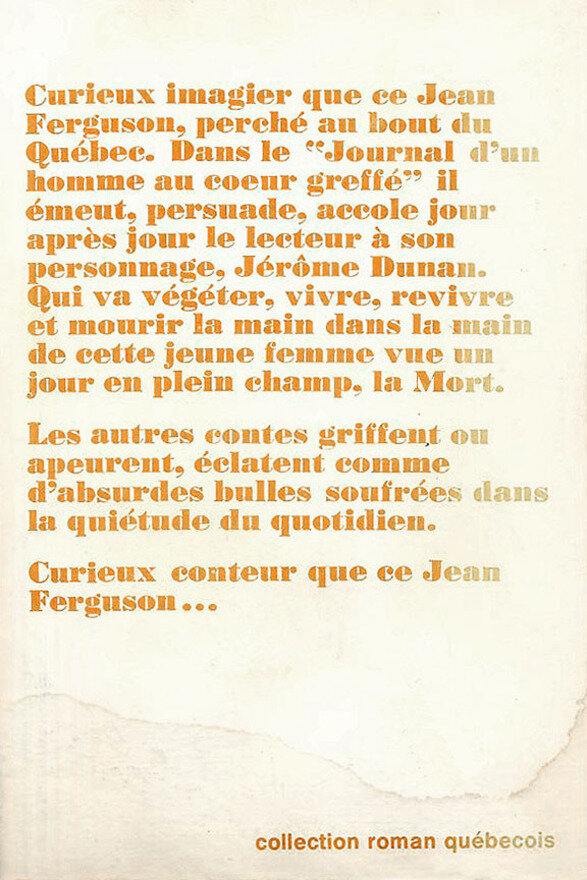À propos de cette édition
Commentaires
La qualité première d’une « bonne » nouvelle littéraire passe nécessairement par son caractère original. La chute y est pour beaucoup ; mais à elle seule, elle ne saurait être garante du sense of wonder (en SF) ou de son effet fantastique (c’est selon). De même, une bonne idée de départ, si elle est mal travaillée, mal écrite, ou simplement mal ficelée dans son processus de mise en intrigue, ne suffira pas à émerveiller ou inquiéter/ intriguer/terroriser le lecteur (encore une fois, selon le genre traité). Jean Ferguson, dans son recueil Contes ardents du pays mauve, semble avoir oublié ces deux nuances importantes. Les nouvelles qui composent l’ensemble sont… moyennes, sans plus. Jamais l’auteur ne réussit à véritablement transporter son lecteur par l’originalité de ses écrits, de ses idées. Les récits tombent généralement à plat, et on s’ennuie un peu en lisant des textes sans surprise, mal construits ou pire, avec un fort sentiment de déjà-vu.
Pourtant, Ferguson avait des idées de départ intéressantes ; sauf qu’elles sont généralement mal exploitées. « Le Petit Numéro deux mille quarante », par exemple, qui nous confronte à une dystopie reposant sur le conditionnement, dès la naissance, des individus dans des « Centres d’élevage d’enfants ». Dès le départ, le parallèle avec Brave New World d’Aldous Huxley est évident ; et le lecteur se demande justement comment Ferguson réussira à se démarquer du texte canonique ; et ce même lecteur a tôt fait d’être déçu. Un enfant qui se met à pleurer nous étant présenté comme l’élément perturbateur de la dystopie, puisque cela n’arrive plus depuis des milliers d’années, apparaît comme invraisemblable, puisqu’un enfant, dès les premiers instants de sa naissance, va justement pleurer par réflexe inné lors de sa première bouffée d’air.
De même, si tous les enfants ont accès aux données historiques de l’espèce via un ordinateur central, pourquoi faut-il attendre des milliers d’années avant qu’un petit curieux s’informe sur des sujets plus tabous ? N’y a-t-il pas de filtre intégré ? Quiconque a des enfants vous le confirmera, ces petits êtres font preuve de la plus grande pugnacité quand il s’agit de questionner le monde qui les entoure, bravant les interdits, allant de surprises en découvertes, souvent au grand dam de leurs parents – ce qui rend caduc le raisonnement initial de l’auteur, alors même que son modèle, Huxley, évitait pourtant cette erreur.
Ce n’est là qu’un seul exemple, qui malheureusement se réitère tout au long du recueil : dans « Ker, le tueur de dieu », l’auteur nous présente un personnage habitant un monde post-apocalyptique, revenu à un état plus primitif et qui est confronté à des humains technologiquement avancés venus de l’espace – précisément la même prémisse que celle de Stefan Wul dans Niourk (1957), jusque dans la présence de poulpes, survivants de l’holocauste nucléaire. Même son de cloche lors de la lecture de la nouvelle « Le Chasseur de robots », qui est en tout point identique au magistral Do Androids Dream About Electric Sheep ? de Philip K. Dick, paru en 1966 et plus tard porté à l’écran sous le titre de Blade Runner (1982). Je n’irai pas jusqu’à dire qu’il s’agit d’une forme de plagiat, mais les similitudes sont trop flagrantes pour être passées sous silence – surtout que les récits de Ferguson sont nettement moins bons que leurs modèles.
J’ai mentionné que les nouvelles de l’auteur étaient trop souvent sans surprise, et pour cause. La prévisibilité semble la marque de commerce du recueil. Le récit qui ouvre le volume en est un beau spécimen : dans « Journal d’un homme au cœur greffé », pourtant bien écrit, le lecteur en devine la chute à la quatrième page – si ce n’est avant. Pourtant, seule cette finale permet de classer le texte comme fantastique ; et bien qu’elle se veuille construite sur le mode de la surprise, le problème est justement qu’il n’y a nulle stupéfaction, puisque l’on s’attend à ce lien d’outre-tombe entre le greffé du cœur et son donneur. Et c’est encore pire lorsque l’on s’attarde au texte « Le Mort en vacances », certainement la plus faible des nouvelles composant le recueil. La nouvelle débute bien, mais malheureusement, le titre, trop révélateur, vend le punch dès le départ, ce qui brise le plaisir de la lecture. Par la suite, le récit devient simplement la vision du futur de l’auteur, vu sous le regard d’un contemporain ; simple artifice permettant de présenter ladite vision futuriste. La section concernant la révolte du protagoniste est largement invraisemblable ; on voit mal comment un dictateur qui contrôle ses sujets par la pensée laisserait sans surveillance le cerveau à l’origine de cette manipulation, dont la mort signifie la fin du monde. Non seulement c’est sans intérêt, mais en plus, il s’agit de la nouvelle la plus mal écrite – bien qu’à ce sujet, il faille mentionner le dernier récit, « L’Automobile », où la narration omnisciente agace au plus haut point, puisqu’elle ne sert qu’à expliciter de manière grossière un contexte que l’on aurait préféré découvrir petit à petit, au fil de la lecture, au moyen de petits indices épars, plutôt que de se faire enfoncer ce genre d’information dans la gorge.
Il y a bien deux exceptions parmi ce lot de récits passables : « L’Homme aux yeux lumineux » et « La Bête imaginaire ». Le premier détonne du reste par l’absence de résolution d’un récit fantastique demeuré ouvert dans sa finalité, sans véritable conclusion. Certes, la focalisation interne comporte ici quelques faiblesses, à mi-chemin entre le conte de taverne et le témoignage direct, sans être ni l’un ni l’autre ; mais on pardonne rapidement cette lacune, tant l’absence d’indices sur la nature de l’homme aux yeux lumineux, autant que son dessein, provoque le questionnement. Est-ce un fantôme, une hallucination, un extraterrestre ? Le lecteur est laissé sur sa faim, à ses propres conjectures, et c’est tant mieux. Quant à « La Bête imaginaire », de loin le plus (le seul ?) original récit du livre – et le meilleur –, le lecteur ne peut que se délecter devant le personnage de Petrone, admirable tant il est détestable, d’autant que sa mort sous le sceau du cannibalisme rehausse également l’ensemble de ce conte de sorcellerie.
En somme, les textes de Contes ardents du pays mauve, sans être complètement mauvais, ne méritent, pour la plupart, certainement pas une réédition, tant l’ensemble m’est apparu commun et sans véritable originalité. [MRG]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 200-203.
Références
- Boivin, Aurélien, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec V, p. 175-176.