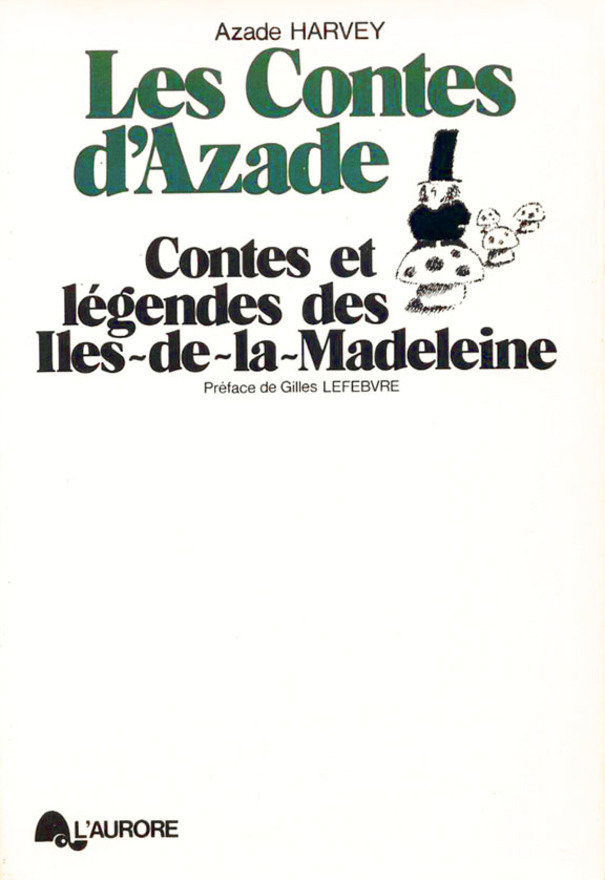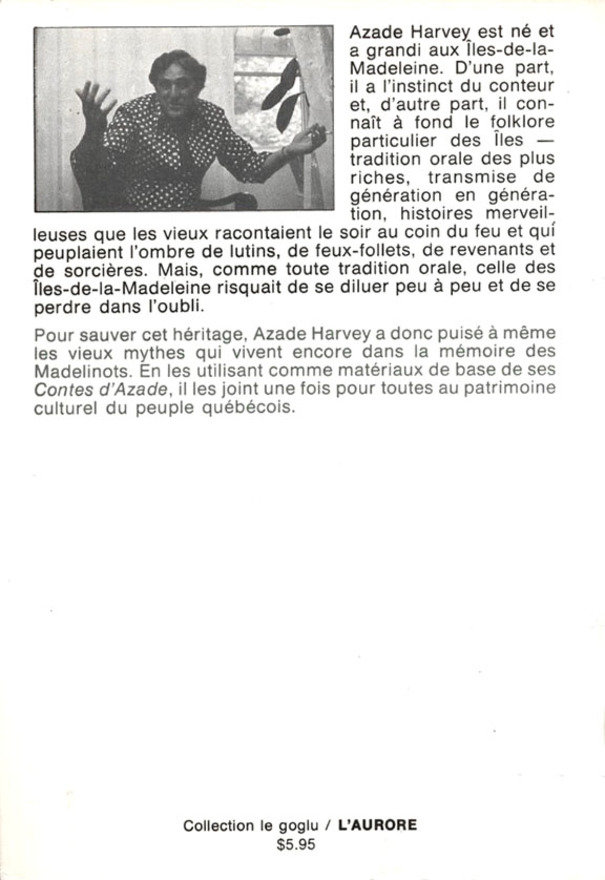À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
[14 FA ; 25 HG]
Albert et sa sirène
Bertha la Puce
L'Homme sans cœur et sans remords
La Butte du Nègre
La Peur sur l'île
La Défunte Flash
La Goélette à Bert
La Légende du cheval blanc
La Maison de la dune
La Maison maudite
La Mi-carême
La Petite Barque
La Soquem et les lutins
La Trombe
Le Bon Docteur Solomon
Le Charmeur de rats
Le Chien Mickey
Le Don Juan des Îles
Le Halage de maison
Le Monstre de Pointe-aux-Loups
La Source du petit bon Dieu
Ovide et sa musique céleste
Le Rôdeur de dunes
Le Trésor de l'île Brion
Les Déserteurs de la marine
Les Deux coquerelles
Les Deux escouades
Les Feux-follets
Les Filles de l'île Brion
Les Fraudeurs
Les Marionnettes
Les Petits Lutins
Les Puces
L'Homme de la pointe
L'Homme mystérieux de l'Île d'Entrée
L'Odyssée des chasseurs de loups-marins
Marie la douce
Pascal le bâtisseur
Une chasse à l'outarde
Commentaires
Sous-titré Contes et Légendes des Îles-de-la-Madeleine, ce recueil de 39 textes n’a rien en commun avec les Mille et Une Nuits, hormis la seconde moitié du nom Schéhérazade, qui a manifestement inspiré le demi-pseudonyme de l’auteur.
Brèves, ces histoires s’avèrent généralement anodines. Celles qui ne relèvent pas du fantastique le sont encore plus. C’est le cas de « La Maison maudite », une affaire conclue en cinq paragraphes, ou de « Pascal le bâtisseur », qui aurait pu être un gag indûment étiré tel qu’en proposaient Gilles Latulippe ou Denis Drouin à cette époque.
Certaines histoires tournent court, comme si l’auteur lui-même s’en était désintéressé avant de les avoir proprement développées (« L’Homme de la pointe ») ou comme s’il se contentait d’écrire deux ou trois pages afin de cocher un titre sur une liste de thèmes imposés (« Les Feux-follets »).
Souvent, les cas de hantise sont vite réglés, les mystères percés sans grandes recherches, et l’on a facilement raison des manifestations du surnaturel – pouvoirs magiques non requis. Rien de tout cela n’est bien conséquent. Comment pourrait-il en être autrement dans des textes de trois ou quatre pages ?
Au chapitre des récurrences, signalons les rats, les insectes doués de parole (puces, coquerelles, en de curieux emprunts à l’esprit de la fable animalière), puis les lutins, qui reviennent assez souvent pour représenter une autre forme de vermine. Ceux de Harvey (ils font immanquablement penser – pour le lecteur moderne – aux nains de jardin popularisés par Amélie Poulin) s’avèrent bavards, cachottiers, tantôt serviables mais tantôt maléfiques en ce qu’ils sont associés à la disparition de protagonistes ou de témoins involontaires.
En termes d’influences, ce sont les contes traditionnels du XIXe siècle qui se trouvent aux sources de plusieurs de ces textes, davantage que le fantastique « de possession » qui s’est fait jour au début des années 1970 (L’Exorciste et ses cohortes). Si j’emploie « esprits frappeurs, esprits hurleurs » dans les résumés ci-après, c’est pour faire court ; ces mots ne figurent pas au vocabulaire harvésien. (Quoiqu’on rencontre « phénomène parapsychique » dans la bouche d’un personnage cultivé, vers la fin du recueil, mais ces termes détonnent dans l’ambiance générale.)
Quelques cas singuliers, comme « La Soquem et les lutins », ne découlent manifestement pas du corpus traditionnel, puisque la Soquem – même si ce n’est pas écrit – c’est la Société québécoise d’exploration minière, et qu’il est question de mines de sel, d’électricité produite par éolienne et des soucis ou contrariétés que ces nouveautés causent aux lutins. Si on prenait cette histoire au sérieux, on pourrait lui prêter l’étiquette du réalisme magique.
À l’inverse, « La Trombe », en tant qu’histoire de pêche miraculeuse, est une extrapolation – avec la touche exagérée du conteur – sur les anecdotes de tornades aspirant des poissons avec l’eau de mer.
Le survol du sommaire ne serait pas complet sans une mention du franc libertinage qui caractérise deux ou trois de ces récits, plus dans l’air du temps d’un Jean-Pierre Ferland ou d’une Louise Forestier que d’un Louis Fréchette.
Au chapitre de la langue, hormis l’intérêt ethnographique du lexique des Îles (avec glossaire aux dernières pages), le vocabulaire d’Azade Harvey ne s’avère pas particulièrement riche : par exemple, « petites lumières » pour miroitements lorsqu’il parle de l’abondance des harengs à la surface du Golfe au clair de lune. Ou encore, trois fois l’adjectif « petit(e) » en trois lignes, au début de « La Source du petit bon Dieu ».
Ce recueil est le premier de cinq, publiés sur une période de huit ans chez trois éditeurs différents (le dernier à peu près inconnu). De celui que j’ai lu, je tire le bilan suivant : Azade Harvey aurait dû regrouper sa matière (où les redites abondent) et se limiter à une dizaine, peut-être une douzaine d’histoires plus substantielles, mieux développées, dont certaines auraient pu rester en mémoire pendant quelque temps. Si les recueils suivants furent à l’image de celui-ci, ils passèrent probablement inaperçus, et il est possible que ma conclusion vaille pour l’ensemble. [DS]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 241-244.
Références
- Lamontagne, Gilles, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec V, p. 176-177.