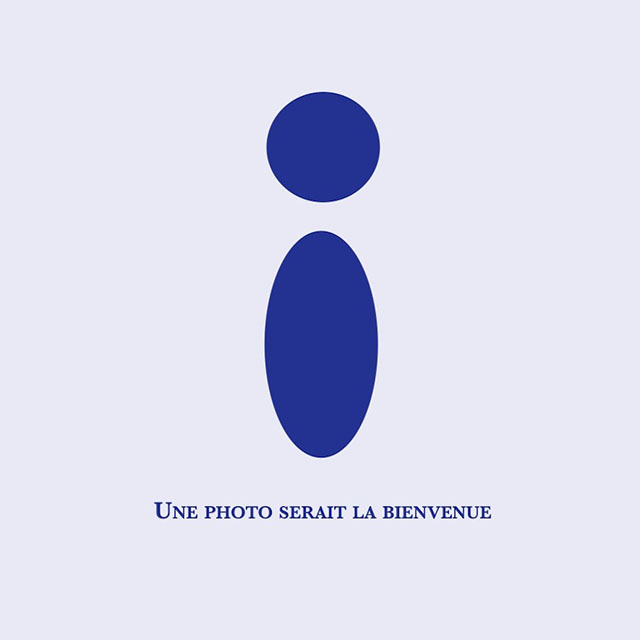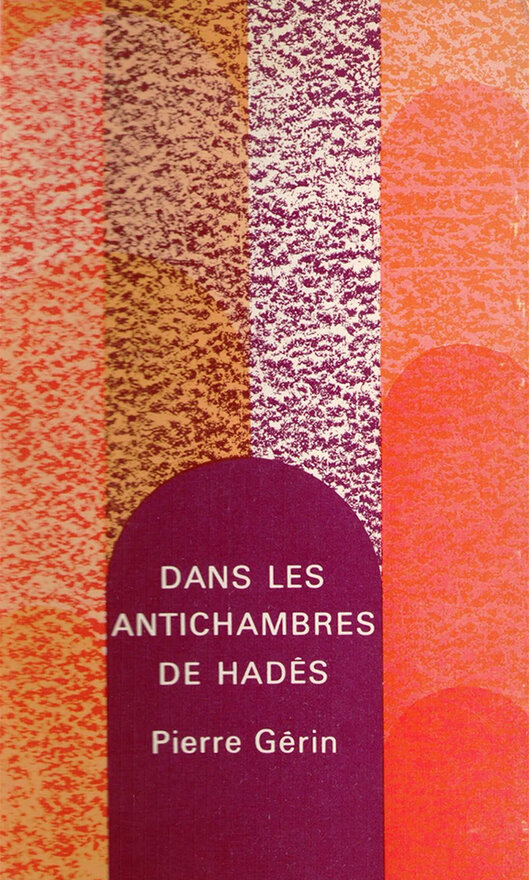Résumé/Sommaire
[5 FA ; 1 SF ; 21 HG]
Rosemay
Le Signe
La Petite Portugaise
La Maison des deux amants
Les Pauvres Gens
L'Étranger
Slaves
La Benoîte
L'Idole aux yeux de porcelaine
À Canossa
Le Voyageur sans bagages
La Musicienne
Les Vaches maigres
Le Parricide
Le Pont
La Meilleure des mères
La Fillette à l'oiseau
Le Malentendu
Le Père Ladarche
Le Poète partagé
Le Secret d'Artapharès
Les Adieux
Le Mur
Souvenir, souvenir, que me veux-tu ?
Un caprice d'enfant
Le Retour
Le Condamné
Commentaires
Le premier recueil de nouvelles de Pierre Gérin, Dans les antichambres de Hadès, adopte un ton sombre, désenchanté, amer. La vie ne remplit pas ses promesses et révèle à la fin au protagoniste la duperie dont il a été l’objet. Hadès, maître des enfers, évoque moins le châtiment qui attend les pécheurs après leur mort que l’enfer dont parlait Sartre.
D’ailleurs, l’une des nouvelles fantastiques du recueil, « Le Voyageur sans bagages », se veut une réfutation de l’affirmation du philosophe existentialiste voulant que « l’enfer, c’est les autres ». Le narrateur, qui se nomme Ertras (Sartre à l’envers), comprend au bout du périple qui le mène de vie à trépas que « l’enfer, c’est moi ». Ce texte est chargé de symboles : le compartiment du train où le voyageur est seul est décoré de photos de villes qui ont été importantes dans sa vie, le hall de la gare où il aboutit compte trois portes marquées des lettres C (pour ciel), P (pour purgatoire) et E. Gérin installe une atmosphère propice au fantastique. Le protagoniste se détache peu à peu du monde, le paysage s’efface graduellement dans la brume, les travaux littéraires du voyageur le laissent indifférent, le temps s’abolit et Ertras se dépouille de tout : la dernière image le présente nu devant un miroir.
Cependant, rares sont les cas où le fantastique s’expose ainsi à visage découvert. Le recueil de Gérin oblige le lecteur que je suis à réfléchir sur ce qui fait qu’un texte est fantastique ou pas. Dans la Bibliographie analytique de la science-fiction et du fantastique québécois (1960-1985), les auteurs considèrent que dix nouvelles relèvent du fantastique et une de la science-fiction. Va pour la nouvelle de SF sur laquelle je reviendrai. Pour ma part, je n’ai retenu que cinq nouvelles dans le corpus fantastique. Le « fantastique » que pratique Gérin est en phase avec la définition qu’en donne Todorov mais il manque, à mon sens, un élément ou un détail qui établit la différence entre l’étrange et le fantastique. Le basculement dans le fantastique n’a pas lieu à tout coup. Cela est dû au fait que plusieurs nouvelles reposent sur des cas de superstitions. Or ces croyances irrationnelles ne font pas nécessairement bon ménage avec le fantastique. On est davantage ici dans l’occulte.
Il y a aussi le fait que l’auteur associe systématiquement superstition et surnaturel aux îles du Sud et ne croit visiblement pas à ces sornettes, d’après le ton légèrement railleur qu’il emprunte. Notre esprit rationnel nous convainc qu’il s’agit de simples coïncidences qui se produisent dans la vie de tous les jours. Suffit de lire le journal où sont rapportés régulièrement des faits qui défient l’imagination et la vraisemblance. Mais en même temps, les circonstances de la mort de certains personnages (comme la fillette dans « Un caprice d’enfant » et dans « La Fillette à l’oiseau ») sont tellement invraisemblables et tirées par les cheveux qu’on finit par conclure qu’il y a du surnaturel là-dessous.
Tout, dans le recueil de Gérin, rappelle les origines françaises de l’auteur : les références culturelles et littéraires, les lieux géographiques, le passé colonial de la France. On se croirait parfois dans une chanson de Brassens ou de Brel. Gérin fait l’éloge des gens simples, critique les riches et les aristocrates, brosse un portrait des rapports de classes. On baigne dans une ambiance Vieille France aux temps « heureux » des colonies. On ne serait pas surpris d’apprendre que l’auteur, qui a vécu en Nouvelle-Écosse après avoir enseigné à Madagascar et à Tananarive de 1950 à 1967, soit, à l’image de plusieurs de ses personnages, retourné en France à l’heure de la retraite.
Malgré que toute son œuvre ait été publiée chez des éditeurs québécois, on ne sent pas – du moins, dans le présent recueil – la moindre appartenance à la littérature québécoise. Gérin s’inscrit dans la tradition littéraire des portraitistes qui, en quelques mots, dépeignent leurs personnages. L’ensemble qui se dégage de cette galerie de portraits est assez déprimant. Les personnages adultes se rendent compte, sur leur lit de mort, qu’ils ont été trompés par leur conjoint ou leur famille, que leurs rapports étaient basés sur le mensonge et qu’ils sont passés à côté de leur existence.
Quelques nouvelles se démarquent mais trop souvent les amorces sont répétitives : un narrateur non identifié s’adresse à un interlocuteur muet, puis le récit introduit un retour sur le passé pour éclairer le propos premier. Outre « Le Voyageur sans bagages » et « Le Pont », « Slaves » figure parmi les réussites du recueil car il expose une énigme qui rappelle une pièce de Luigi Pirandello, Six personnages en quête d’auteur. Un commissaire enquête sur la mort d’un homme d’origine slave. Qu’est-ce qui fait qu’on croit la version de Sandra au moment de son interrogatoire ? Quelque chose d’inexplicable, mais surtout l’absence de mobile pour un tel crime. Sandra pourrait très bien avoir inventé de toutes pièces cette histoire de personnages qui échappent au contrôle du dramaturge Fédor Séniawine qui les a créés, puis causent sa mort, et faire porter la responsabilité sur eux. Une lecture fantastique de la nouvelle nous amène par contre à conclure que la Sandra interrogée par le commissaire est justement la création du dramaturge et qu’en se forgeant une fausse identité de colocataire et d’amie de Fédor, elle se disculpe habilement. Il n’est pas facile de trancher mais la dimension fantastique de la proposition est bien davantage présente ici que son caractère réaliste. Tout est question de perception, finalement, et la maîtrise de l’auteur peut faire la différence.
Ainsi, une seule phrase – « des liens mystérieux […] unissent entre elles toutes les créatures » –, dans « Un caprice d’enfant », basée sur la vision du monde de la défunte femme du docteur Mouranges, suffit à balayer nos doutes et à nous convaincre que la mort de l’écureuil et celle de la petite Yasmine sont intrinsèquement liées. Comme plusieurs personnages, Mouranges fait face à un dilemme moral : en trahissant la mémoire de sa femme, il précipite la mort de sa fille.
La seule incursion de Gérin en science-fiction ne pose pas de problème d’appartenance au genre. En un raccourci saisissant, « Le Secret d’Artapharès » brosse l’évolution technologique d’une civilisation avancée (« La vapeur, l’électricité, l’énergie atomique mirent leur force à sa disposition ») et son effondrement tout aussi spectaculaire. Il faut recevoir ce texte comme une fable car il est difficile de croire qu’un insecte papyrophage, en dévorant tous les livres de la Terre, puisse détruire le savoir accumulé par cette civilisation qui a les ressources pour envoyer une mission sur Vénus. Elle n’aurait pas d’ordinateurs ?
Dans les antichambres de Hadès représente un objet singulier dans le corpus québécois. Son ancrage profond dans la société française, son écriture classique, son éclectisme – certaines nouvelles mettant en scène des enfants relèvent de la littérature enfantine – et son idéologie ethnocentrique qui se manifeste ici et là suscitent autant l’intérêt que l’ennui. [CJ]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 215-218.
Références
- Lord, Michel, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec V, p. 212-213.