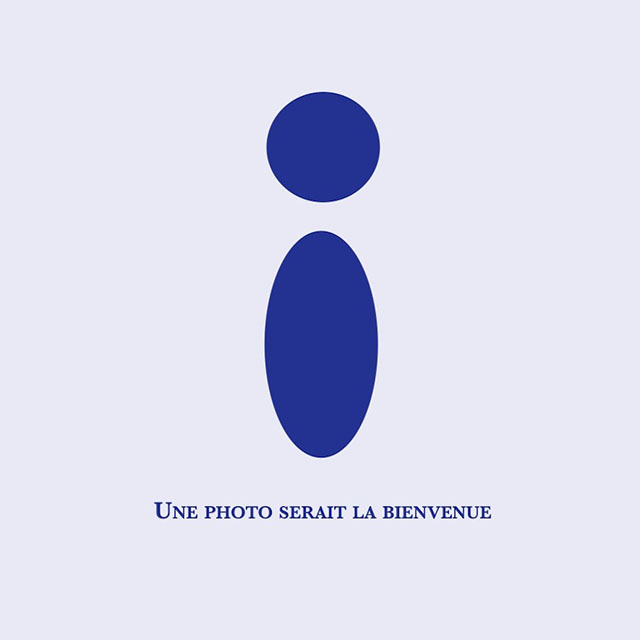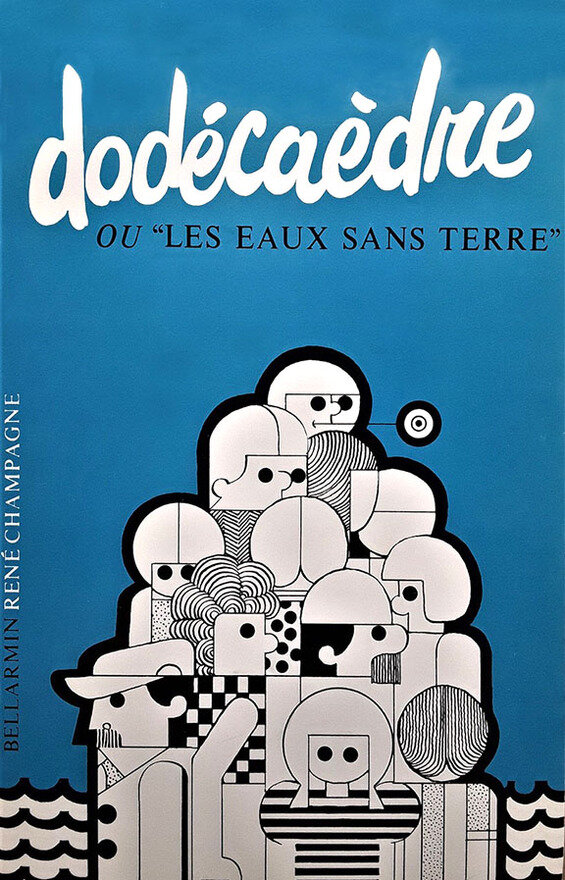Résumé/Sommaire
Gloripolis, petit village blotti entre les montagnes et à l’écart des grandes routes, n’est pas un village comme les autres. Il possède une source qui est à l’origine de sa fondation il y a cinq siècles et qui le distingue des autres villages. La vie sociale s’est structurée autour de la préservation de la source qui fait la fierté et le bonheur des Gloripolitains. Le bourg coule des jours tranquilles en totale autarcie, imperméable aux modes et aux courants modernistes auxquels succombent les villes voisines.
Dodécaèdre est un cordeur de bois entièrement dévoué à son métier et qui met son souci du travail impeccable au service de sa communauté. Mais voilà que Starèdre, un homme énergique et charismatique, prône le changement et l’ouverture au monde. Il veut moderniser les institutions du village, le sortir de son immobilisme et faire de Gloripolis une ville qui rayonnera dans le monde. À la tête du parti des futurophiles, il s’oppose aux arguments des amis du passé, dirigés par Prétéritus, qui fondent leur politique sur la conservation des traditions, le culte du passé et la vénération des anciens. Le village est divisé entre ces deux visions antagonistes mais Starèdre convainc la majorité de tourner le dos au passé et de regarder vers l’avenir.
Il engage des technocrates étrangers pour prendre en charge la modernisation de l’administration municipale et le développement du territoire. Grâce à une politique nataliste et à l’arrivée de nombreux émigrants, le village voit sa population croître considérablement et il atteint bientôt le statut de ville. Les transformations sociales entraînent la disparition du métier de Dodécaèdre qui devient, à la demande de Starèdre, secrétaire du Conseil de ville. Le jeune homme s’acquitte de sa tâche avec compétence et loyauté même s’il est davantage conservateur que progressiste. Il sera toutefois tiraillé entre ses convictions personnelles et son sens du devoir, surtout quand le président Starèdre, poussant plus loin ses réformes, ordonne la suppression de la source et de la place-à-la-source et, par voie de conséquence, l’abolition de l’ordre des fontocrates, gardiens immémoriaux de la source.
Oscillant entre la révolte et la résignation, Dodécaèdre demeure à son poste et assiste bientôt au déclin de Gloripolis car la gloire est chose éphémère. Incapable de rallier de nouveau ses citoyens à ses idées, Starèdre cherche un bouc émissaire et démet Dodécaèdre de ses fonctions de secrétaire. On lui confie un poste de fossoyeur et il règne sur le cimetière de Gloripolis qui retrouve peu à peu la quiétude du village d’antan.
Commentaires
Dodécaèdre ou « les eaux sans terre » emprunte la forme d’une fable politique universelle, ce qui ne l’empêche pas d’être constamment imprégnée de l’histoire du Québec, l’histoire littéraire autant que politique. En lisant ce récit de René Champagne, j’ai pensé souvent à Maria Chapdelaine de Louis Hémon dans la première partie qui vante les mérites du passé, voire de l’immobilisme (« Au pays de Québec rien ne doit mourir et rien ne doit changer », écrivait le romancier natif de Brest), puis aux utopies qui ont fleuri au cours des années 1940 et 1950 au Québec (L’Impératrice de l’Ungava, Défricheur de Hammada, entre autres).
René Champagne présente une synthèse de ces deux visions du Québec qui se sont exprimées dans la littérature québécoise dans la première moitié du XXe siècle en utilisant le schème utopie/dystopie qui cautionne l’inclusion de son œuvre dans le champ de la science-fiction. Certes, il n’y a ici aucune invention technologique comme il s’en trouve dans les romans cités plus haut, mais l’absence de lieux géographiques identifiables, l’absence de dates historiques, le nom même des personnages et quelques néologismes bien choisis (« fontocrates », « futurophiles », « venance »), tout concourt à parer cette œuvre des atours de la science-fiction.
Si Dodécaèdre, personnage principal et témoin privilégié de l’histoire de Gloripolis, relaie, on le sent bien, les opinions de l’auteur, il reste que René Champagne fait preuve de nuance face aux positions bien campées des amis du passé et du parti des futurophiles. On a beau être dans un roman à thèse, tout n’est pas totalement noir ou totalement blanc. Ainsi, le régime sous lequel vit le village depuis des siècles est devenu sclérosé et repose sur des interdits et des lois contraignantes auxquels tout le monde se soumet parce qu’on n’a jamais connu rien d’autre. Par ailleurs, le règne de Starèdre part de bonnes intentions et s’édifie sur des règles démocratiques mais peu à peu les idées de grandeur et l’ambition du président incitent ce dernier à exercer une autorité qui ressemble de plus en plus à une dictature.
Si l’histoire littéraire du Québec se lit en trame de fond, l’histoire politique québécoise est tout aussi transparente. Au régime duplessiste qui évoque un village conservateur et replié sur lui-même succède un vent de changement qui correspond à la Révolution tranquille des années 1960. René Champagne a tout le recul nécessaire – son livre est paru en 1977 – pour départager les bons coups et les erreurs qui ont marqué ces deux périodes de l’histoire québécoise. Toutefois, l’analyse socio-politique qui se dégage du récit importe moins aux yeux de l’auteur, me semble-t-il, que le message sous-jacent associé à la source. Celle-ci est l’âme du village, son ciment social. Dès le moment où la source est détruite pour des considérations matérielles, Gloripolis est coupée de son essence, de sa raison d’être.
Pour René Champagne, la source, c’est la foi. Les chants dédiés à la source qui rappellent les cantiques religieux, la formation et le célibat forcé des fontocrates qui, comme les prêtres, ont pour mission de l’entretenir, les textes sacrés qui l’évoquent, la venance, période d’un an au cours de laquelle les jeunes reçoivent un enseignement destiné à en faire des citoyens modèles prêts à se sacrifier pour la source, autant d’éléments suggérant une religion, une spiritualité indispensable à la cohésion sociale et à la sérénité de la collectivité.
On peut certes voir dans ce constat une critique de la Révolution tranquille qui a jeté par-dessus bord la religion, et de la société québécoise en général, si prompte à oublier, malgré sa devise « Je me souviens ». Si l’auteur, par la voix de Dodécaèdre, déplore l’abandon de la foi, remplacée par le matérialisme et l’argent comme valeurs, il blâme cependant beaucoup moins Starèdre (les dirigeants politiques) que les fontocrates (les gens d’Église). Il accuse ceux-ci d’être restés muets quand ils auraient dû prendre position, d’avoir pensé à leur prestige et leurs privilèges plutôt qu’à défendre la source : « Mais cet homme [Pentaèdre, ancien chef des fontocrates] ne fut jamais parole pour les autres. La parole meurt en lui. […] La parole à cause de lui cesse d’être parole. » Champagne dénonce ici avec vigueur la faillite de l’élite ecclésiastique.
Dodécaèdre n’est pas une œuvre sans défauts. Les personnages, définis exclusivement par leurs fonctions, manquent d’épaisseur psychologique comme c’est souvent le cas dans les romans qui reposent sur des concepts idéologiques. Leurs noms sont insipides et abscons. Dodécaèdre (un polyèdre à douze faces, selon le Petit Larousse) se nomme ainsi parce qu’il est né le douzième jour du douzième mois ! En outre, le récit ne compte aucun personnage féminin et la femme, à l’exception de la sage-femme qui jouit d’un certain prestige, ne semble pas exister dans cette société. L’écriture est un peu sèche et la lecture s’avère parfois ardue en raison de l’absence systématique de virgules quand l’auteur commence une phrase par une inversion comme dans l’exemple suivant : « Devenus riches Gloripolitains et Gloripolitaines voyagent beaucoup maintenant. » L’auteur est cependant capable de belles métaphores comme celle-ci : « C’est ainsi qu’à Gloripolis le rouet du souvenir filait jour et nuit la laine du passé. » [CJ]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 116-118.
Références
- Pion, Denis, Dictionnaire des écrits de l'Ontario français, p. 257-258.