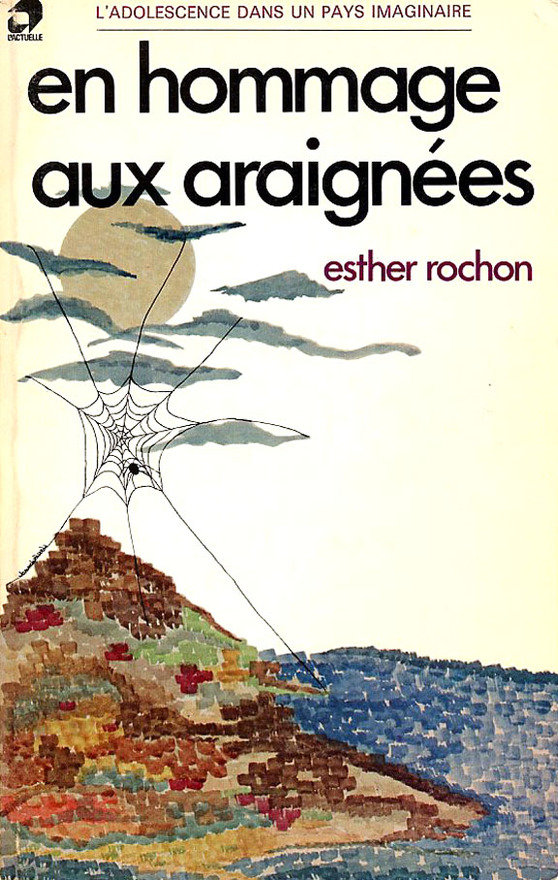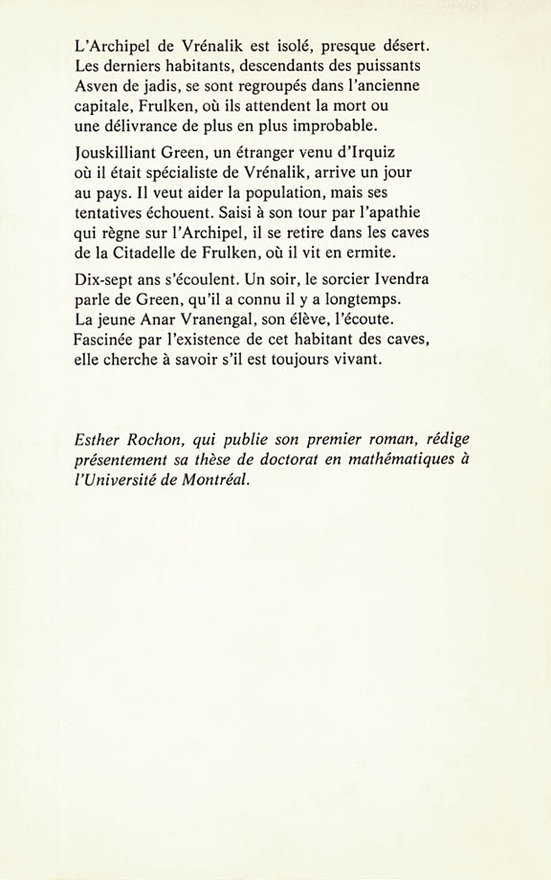À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
Jouskilliant Green vient de débarquer à Frulken, capitale et citadelle de l’archipel de Vrénalik. Professeur à l’Université d’Irquiz, sans trop savoir pourquoi, il a tout quitté, femme et boulot y compris, pour venir s’établir dans ces îles en déchéance, pâle reflet d’une gloire passée, presque oubliée. Vrénalik tombe en ruine : sans électricité, sans voitures, sans usines ; alors qu’au Sud, le continent prospère. Les insulaires, forts superstitieux, blâment cette décadence de leur patrie sur un coup du sort – à savoir, la perte, il y a fort longtemps, de la statue du dieu-océan Haztlèn. Green, avec sa rationalité, détonne dans le paysage ; mais le jeune Ivendra Galana Galek, même s’il partage les superstitions de ses congénères, l’accepte néanmoins, et devient son élève. Mais après quatre ans, Green souhaite le silence. Il cesse de parler. Le maire lui propose alors de l’enfermer dans le réseau des caves qui serpentent sous la cité et où se trouverait l’unique bibliothèque des îles, là où nul ne s’aventure, afin qu’il y trouve la solitude permanente qu’il souhaite. Green accepte.
Sans savoir s’il est toujours vivant, les habitants jettent de la nourriture dans l’unique puits d’accès, d’abord par obligation, ensuite par habitude. Les années passent. Ivendra, à sa majorité, devient le sorcier des îles, alors que le maire, déçu par l’attitude de Green, perd la boule, devient un tueur en série avant d’être éliminé par son assistante, Oumral, l’amante de ce dernier et accoucheuse de son état, qui prendra sa place à la mairie. Elle élève le dernier fils de celui-ci, le prénommé Strénid, le bourreau d’animaux qui est né la même année qu’Anar Vranengal, la narratrice et élève d’Ivendra.
Dix-sept ans ont passé depuis la descente de Green dans les caves ; et Anar comme Strénid convainquent Oumral qu’il est temps que Green sorte de son confinement. Anar envoie des messages dans le puits ; Green finit par sortir de son isolement. En s’extirpant du puits, il tient dans sa main une grosse araignée blanche qui se réfugie dans sa poche – il la retrouvera trois semaines plus tard, morte, au moment où Green décide de partir des îles. Mais avant de s’exécuter, il fait visiter les caves à Anar ainsi que l’ancienne bibliothèque, qui ne contient qu’une centaine de livres. Dans une autre salle, une myriade d’araignées blanches vivent ; et c’est là que Green donne les plans des catacombes à Anar, en lui confiant que désormais, ces caves appartiennent à la jeune apprentie.
Autres parutions
Commentaires
Ceux qui connaissent l’œuvre d’Esther Rochon reconnaîtront dans ce texte de jeunesse toute la force poétique qui a fait le charme envoûtant de l’autre grande dame de la SFFQ. Pour les autres, les néophytes si je puis dire, il faut comprendre qu’il est difficile de décrire le style de Rochon, tant celui-ci transpire le beau dans le choix de chaque mot, de chaque phrase, donnant à l’ensemble une aura de mystère et de poésie toute simple, mais d’une efficacité enivrante. Mystère, poésie, mais aussi limpidité et profondeur, tant elle sait rendre palpable l’univers qu’elle décrit, et ce sans jamais sombrer dans l’inutile fioriture. Aucun adjectif superflu, aucun adverbe dérisoire, aucune description inutilement longue ; et pourtant, le lecteur a la nette impression de s’y trouver, d’habiter cet univers de fantasy qui ne l’est d’ailleurs que par l’étrangeté de la toponymie. Et en même temps, l’ensemble paraît enveloppé dans une nappe de brouillard, comme si tout n’était pas dit, comme si, justement, l’implicite gouvernait ce style épuré. C’est Jack Vance qui rencontre Stanislas Lem et Henry James, avec une touche de l’intelligence de Van Vogt.
Qui sont ces habitants de Vrénalik ? Certes, ils sont décrits ; certes, on fait leur connaissance… ou si peu. Pourquoi font-ils ce qu’ils font ? Pourquoi cette résignation ? Pourquoi continuent-ils d’habiter ces îles qui n’ont plus rien à leur offrir, sinon l’attente de la mort ? Pourquoi n’y a-t-il pas d’industrie, pas même de pêche, dans cet endroit qui, par moments, rappelle la décrépitude d’Innsmouth, la cité adoratrice des dieux marins oubliés du panthéon de Lovecraft ? D’ailleurs, qu’en est-il de la fameuse statue du dieu-océan, ce Haztlèn à peine mentionné mais qui hante de sa malédiction le quotidien des insulaires ? Pourquoi, à l’ère moderne, les habitants continuent-ils de vivre dans la plus crasse des superstitions, au point d’avoir un « sorcier » parmi eux ? Qu’en est-il de la singulière présence des araignées blanches, limitées à une seule salle dans les caves, où elles pullulent ? Quel sens donner à tout cela ? Ensorcelé, le lecteur referme le livre avec davantage de questions que de réponses.
Bien entendu, en ce qui concerne les araignées blanches, il faut y lire une allégorie de l’emprisonnement. Emprisonnement de Green dans les caves, mais également – et surtout – des insulaires dans leur archipel. Green, comme le papillon qui vole à tire d’aile, sans réel but, ne voyant pas le piège de la toile de soie avant de s’y empêtrer, Green, donc, erre sans but dans une vie morne ; cherchant le salut dans la solitude, il pénètre dans les caves, où il reste empêtré, alors que tout autour de lui le monde tourne, mais ne change, pour ainsi dire, à peu près pas.
Dans une toile d’araignée, l’insecte pris au piège n’est pas mort : il vit encore, attendant d’être le repas de l’aranéide, qui le paralyse de ses crochets à venin. À la merci de l’Autre. Il en va de même pour Green : vivant, il ne peut sortir de lui-même de cet emprisonnement, qui paralyse sa psyché, sa rationalité, laquelle n’a plus de raison d’être dans cet environnement hostile. Certes, le récit nous apprend que Green a dû se débrouiller pour survivre ; mais justement, son intellect étant totalement absorbé par la survie de l’instant, son esprit rationnel, celui du professeur d’université, était relégué aux oubliettes – paralysé, pour ainsi dire. Et dépendant de l’Autre, de celle qui lui envoie, tous les jours, de la nourriture par le puits.
De même, les habitants de Vrénalik sont emprisonnés par la nature même de l’archipel : complètement isolés parce que se recroquevillant sur leur propre microcosme, ils sont dépendants des livraisons importées d’outre-mer, alors même que l’océan, qu’ils se sont conditionnés à craindre, pourrait leur fournir tout ce dont ils ont besoin. Comme Green, comme le papillon paralysé dans la toile, leur psyché est engourdie par leurs peurs ancestrales, leurs superstitions qui les empêchent de devenir des acteurs productifs de la société. La perte de la statue est un traumatisme collectif qui entrave toute volonté d’émancipation tout en servant de bouc émissaire à cette même absence de détermination, d’opiniâtreté : c’est la faute de la statue si nous sommes maudits ; aussi nous n’avons plus la hardiesse nécessaire pour reconstruire ce qui s’est détruit, puisque nous sommes maudits.
C’est là un poison insidieux, mais d’autant plus efficace qu’il ne tue pas instantanément ; plutôt à petit feu, gardant subtilement en vie une victime qui a cessé de se débattre dans la toile, laquelle sera fatalement son tombeau. Rochon l’a compris, et à travers son récit, elle met en garde le lecteur : l’abandon de sa propre rationalité est un piège doucereux, mais mortel. [MRG]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 337-339.
Références
- Demers, Dominique, Le Droit, 15-11-1986, p. 60.
- Des Rivières-Pigeon, Catherine, Québec français 65, p. 98.
- Gadbois, Vital, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec V, p. 301-302.
- Gervais, Jean-Philippe, Solaris 68, p. 36.
- Goffinet, Serge, Odyssée 8, p. 10-12.
- Laurin, Michel, Nos livres, mars 1987, p. 27.
- Mativat, Daniel, imagine… 41, p. 117.
- Sauvé, Hélène, Lurelu, vol. 9, n˚ 3, p. 14.
- Spehner, Norbert, Requiem 3, p. 12.