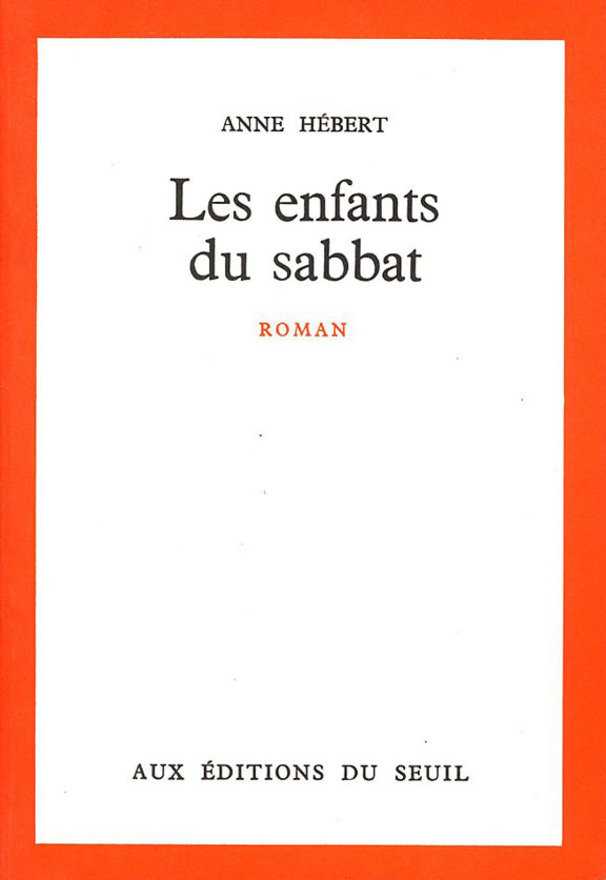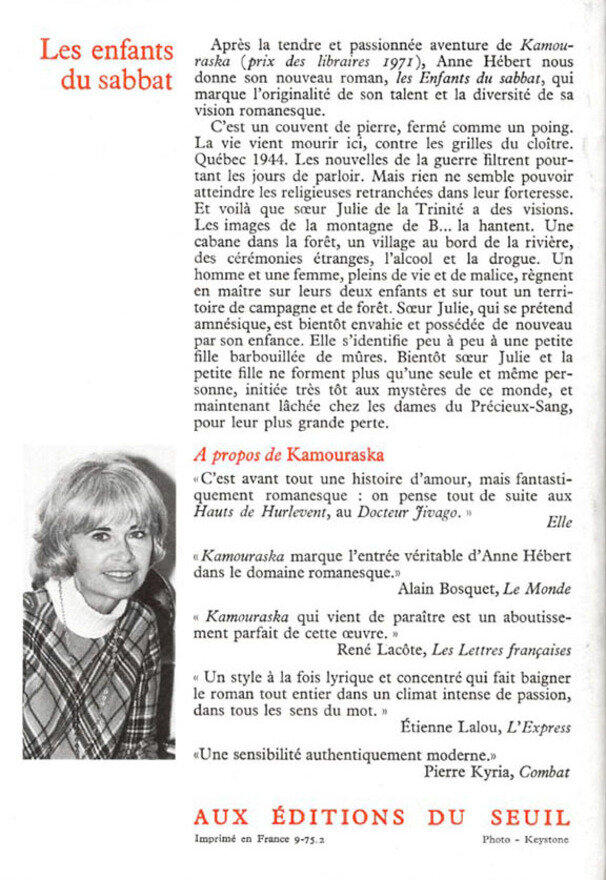À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
1944, au couvent des sœurs du Précieux-Sang. Sœur Julie de la Trinité, une jeune novice, a de la difficulté à poursuivre son noviciat en raison de souvenirs qui la hantent de plus en plus. Durant son enfance à la montagne B…, elle a été témoin de scènes où son père et sa mère menaient d’étranges rituels magiques, à l’aide de drogues et d’alcool. En effet, sa mère est une sorcière, descendante d’une longue lignée d’adoratrices du Diable, qui remonte jusqu’à une ancêtre française ayant immigré en Nouvelle-France dans le but de poursuivre son œuvre. Quant à son père, il s’agit de Satan incarné.
Au couvent des sœurs du Précieux-Sang, sœur Julie développe des pouvoirs magiques, à mesure que l’influence de son héritage de sorcière s’éveille. Au départ, elle utilise ses dons pour se venger de ceux et celles qui l’ont lésée, d’une manière ou d’une autre. Mais plus le temps passe, et plus elle s’évertue à corrompre le couvent et ses habitantes. Elle se souvient encore qu’elle a été initiée à la sorcellerie par son père qui l’a violée, lors d’une cérémonie occulte. Sa mère tente la même chose avec son frère Joseph, mais ce dernier s’enfuit.
Après la disparition de leur père et la mort de leur mère dans l’incendie de leur cabane, Joseph et Julie vivent en marge de la société, jusqu’au jour où Joseph s’engage dans l’armée. C’est à ce moment que Julie entame son noviciat. Les signes d’une véritable possession démoniaque sont de plus en plus apparents chez sœur Julie. Un exorcisme est pratiqué, mais rien ne parvient à entamer l’emprise de Julie sur les sœurs du couvent. Un jour, sœur Julie affirme être enceinte, et elle accouche éventuellement d’une créature difforme, qui sera étouffée par la mère supérieure, avec la complicité du vicaire.
Au même moment, Julie s’enfuit de sa chambre pour rejoindre un jeune homme anonyme qu’on présume être le Diable s’étant de nouveau incarné pour venir récupérer sa fille et poursuivre son œuvre ailleurs.
Autres parutions
Commentaires
Les Enfants du sabbat a mérité le Prix du Gouverneur général en 1976. C’est dire l’importance de ce premier roman fantastique dans l’œuvre de l’une des plus grandes écrivaines du Québec. La structure du récit y est complexe, puisque les allers-retours entre le passé et le présent sont nombreux, et surviennent parfois au milieu d’un paragraphe. L’emploi du discours indirect est parfois source de confusion, puisqu’on ignore souvent qui s’exprime.
Anne Hébert maîtrise sa langue, et elle fait montre d’un style qui lui est propre, entre onirisme et poésie. Tout au long du roman, elle joue sur les frontières entre le réel, le fantastique et le rêve. Elle parvient à rendre avec exactitude l’ambiance de plus en plus oppressante du couvent, alors que l’emprise de sœur Julie sur ses coreligionnaires ne cesse de grandir. Par opposition, les scènes se déroulant à la cabane sont déroutantes dans leur aspect dionysiaque, où les excès sont de mise.
Le récit progresse lentement, mais c’est cette même lenteur qui contribue à mettre en lumière les changements qui s’opèrent au sein du couvent des sœurs du Précieux-Sang. Les personnages sont très bien campés, et Hébert joue avec brio de leurs failles et de leurs faiblesses. Elle expose froidement les contradictions de la sœur supérieure, mais aussi les petites hypocrisies qui ont cours à l’intérieur du couvent.
Qualifié avec raison de réalisme magique, le fantastique mis en place dans le roman est insidieux, et le lecteur est constamment amené à douter du témoignage de sœur Julie, mais aussi des autres personnages qui interagissent avec elle. Pourtant, il devient éventuellement difficile, voire impossible, de voir des coïncidences dans les événements qui secouent le couvent et auxquels sœur Julie semble intimement liée. L’éveil de la novice à son héritage de sorcière est amené subtilement, tout comme les changements qui se produisent dans sa psychologie. Alors qu’elle semble réellement contrite au début du récit, elle assume éventuellement l’arrogance que lui confèrent ses pouvoirs et son ascendant sur les membres de la communauté.
L’intérêt du récit provient également de l’opposition qui est faite entre la cabane de la montagne B… et le couvent. À travers cette dualité, Anne Hébert explore la relation entre le profane et le sacré, en plus d’offrir ce qui ressemble fort à une sévère critique de la religion catholique. Comme nous l’avons déjà mentionné, les frontières entre le rêve et la réalité sont extrêmement floues, et c’est à travers cette indétermination que Julie pourra effectuer ses voyages à la cabane, qui constitue, comme ses parents, la source de ses pouvoirs magiques.
Notons également la relation particulière qu’entretient Julie avec son frère Joseph. Alors qu’au début du récit elle affirme s’inquiéter de son sort puisqu’il combat en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, elle en arrive éventuellement à le détester, à cause de son mariage avec une Anglaise. Ce mariage, et la grossesse subséquente, servent en quelque sorte de déclencheur pour les pouvoirs de Julie. C’est lorsqu’elle apprend la nouvelle que la novice utilise pleinement ses pouvoirs et que les effets de ses maléfices se renforcent.
Il n’est pas anodin de noter qu’Anne Hébert a joint une courte bibliographie à son récit, donnant à lire la liste des ouvrages théoriques consultés. Évidemment, ils traitent de l’histoire de la sorcellerie en France et au Canada, mais il n’en demeure pas moins intéressant de connaître les recherches effectuées par l’auteure dans le cadre de l’écriture de son roman. Et cette attention portée aux détails transparaît clairement durant tout le récit, alors qu’un examen en bonne et due forme de Julie montre deux marques du Diable, à savoir deux zones insensibles et d’où le sang ne s’écoule pas. Les deux marques trouvent leur origine dans les rituels effectués par ses parents, dans le but évident de l’initier aux pratiques occultes auxquelles son lignage l’appelle.
Il s’agit sans contredit de l’un des romans fantastiques les plus importants des années 1970, non seulement en raison de la qualité de l’œuvre et de l’écriture d’Hébert, mais aussi parce que l’auteure a parfaitement saisi l’état d’esprit de l’époque, qu’elle a su traduire de manière magistrale dans ce combat entre les forces du Bien et du Mal. Ajoutons à cela que le roman marque un jalon dans l’œuvre d’Anne Hébert. Comme nous l’avons mentionné, il s’agit de son premier roman fantastique, qui sera suivi, cinq ans plus tard, par Héloïse, seconde et dernière incursion de l’auteure dans la littérature fantastique. Compte tenu de tout cela, il n’est pas étonnant que Les Enfants du sabbat ait donné lieu à tant d’études. Un roman incontournable et intemporel. [PAB]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 253-255.
Prix et mentions
Prix du Gouverneur général 1975
Références
- Archibald, Samuel, Le Devoir, 06/07-08-2016, p. E 1 et E 6.
- Arseneau, Élizabeth, Les Libraires 130, p. 61.
- Escomel, Gloria, Requiem 20, p. 30-32.
- Marmier, Jean, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec V, p. .297-299