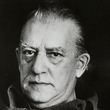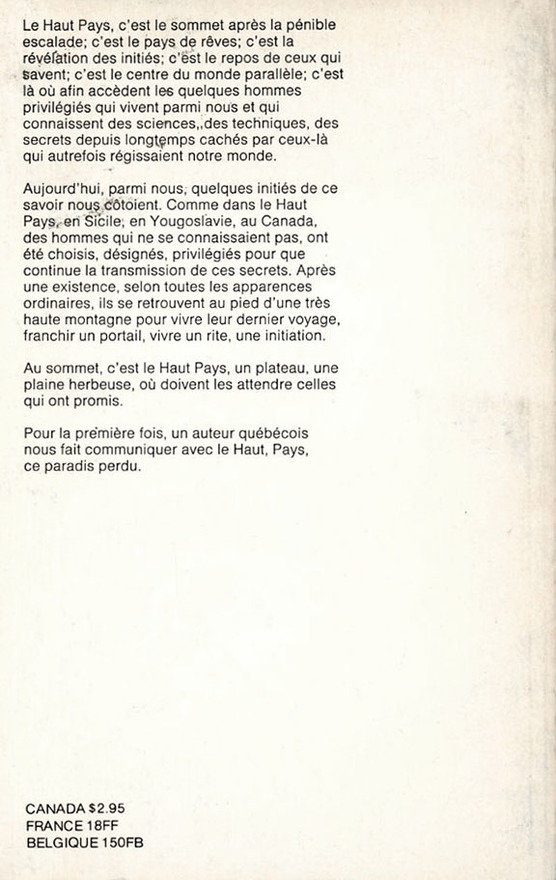À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
Trois hommes matures se retrouvent au pied d’une très haute montagne. Ils sont arrivés là après diverses expériences de vie, répondant à une voix intérieure pressante.
Cosimo est né en Sicile, près de Taormina. Adolescent, il découvre sur la terre de son père une pierre gravée de dessins étranges qu’il interprète comme un signe du ciel, sinon du destin. À la mort de son père, Cosimo n’entend pas devenir fermier ; il préfère se faire marin. Mais au moment de partir, il emporte avec lui le cœur de Marcella qui nourrissait l’espoir de l’épouser. Il le lui arrache littéralement de la poitrine. Pendant des années, il bourlingue sur les mers, scrutant l’horizon le jour et le ciel la nuit. C’est à Gibraltar que Cosimo voit s’ouvrir une brèche dans l’univers, par laquelle il rejoint une autre dimension et ceux qu’il appelle les Initiés.
Jurav, qui exerce un ascendant sur le trio, est né à Belgrade dans une famille de fonctionnaires. Enrôlé dans l’armée pendant la Deuxième Guerre mondiale, il prend le maquis quand les Allemands envahissent son pays et devient partisan de Tito. Au cours d’une manœuvre, il tue deux soldats allemands et s’apprête à trucider le troisième quand celui-ci lui révèle que lui, Jurav, est un désigné. Mais avant qu’il puisse accéder au stade suivant, celui d’initié, Jurav parcourt le monde pendant des années, menant une carrière internationale de photographe de la nature, ce qui l’amène à participer à des expéditions en haute montagne. Jurav rencontre une femme, Elisa Whiting, libre et indépendante comme lui. Se rendant compte mutuellement qu’ils s’attachent, les deux amants éphémères se séparent. Des années plus tard, Jurav découvrira finalement le passage dans une maison de geishas de Kyoto.
Vurain, le troisième homme, est né de l’union d’un Indien et d’une femme de souche française. Élevé dans la nature dans la partie inférieure de la baie d’Ungava, il se rend dans le sud, à Montréal, recevoir son éducation. Il s’installe au pays des Blancs contre la volonté de son père et épouse une jeune fille, Lucie, qu’il a rencontrée au travail. Le mariage ne dure pas et le couple éclate à la suite des différences culturelles entre les deux époux.
Préparé par son héritage amérindien, Vurain est initié à son tour et rejoint Jurav et Cosimo pour entreprendre l’étape ultime qui les mènera au Haut Pays, au sommet de ce pic aux falaises vertigineuses. Là se trouve la promesse d’une dimension supérieure de l’homme.
Commentaires
Je n’arrive toujours pas à déterminer avec certitude si Yves Thériault a écrit un roman ésotérique sérieux ou si Le Haut Pays n’est pas plutôt une vaste supercherie, une immense farce, un véritable pied de nez à toutes ces philosophies orientales qui ont déferlé sur l’Occident au tournant des années 1960-1970 à la faveur du mouvement contre-culturel. Thériault a-t-il mené le lecteur en bateau pendant tout ce temps pour aboutir à une « chute » – c’est le cas de le dire, s’agissant d’escalade et d’alpinisme – aussi surprenante ? Qu’on en juge. Les voix que les trois initiés entendent, Celles qui les attendent au sommet, ce sont « trois chèvres blondes » ! Mais en toute justice, il faut dire que le trio débouche aussi sur « un plateau extraordinaire, sorte de plaine herbeuse, traversée d’une rivière limpide, plantée de bosquets de grands arbres vieux mais sains ». Est-on encore dans la vraisemblance ? L’a-t-on jamais été, au fait ? À cette altitude (cinq mille mètres), une telle végétation est impensable.
Le Haut Pays est certes le roman le plus étonnant de la production d’Yves Thériault. C’est bien de mondes parallèles dont il est question, de dimension supérieure, de surhomme appelé à réaliser son plein potentiel en se détachant du monde des humains. D’une certaine façon, cette quête en vue d’élever l’esprit humain rejoint l’ambition qui animait Adakhan, le Vieux et Selvah, les inoubliables personnages principaux de L’Oiseau de feu de Jacques Brossard. Toutefois, là où ce dernier traduisait cette aspiration dans un récit de science-fiction, Thériault a recours à l’ésotérisme. Cela surprend de la part d’un auteur terre à terre qui a tellement écrit sur la nature, sur la sauvagerie de l’homme en résonance avec celle-ci.
Ici, les trois personnages du roman ont effectué un parcours les amenant à se détacher des choses du quotidien au point de tourner rapidement le dos à l’amour et de renoncer à toute sexualité. Quand on connaît toute l’importance de cette dimension de l’être humain dans l’œuvre de Thériault, c’est d’autant plus étonnant. Tout comme peut l’être le rôle de la femme dans ce roman, considérée comme un empêchement à l’élévation spirituelle de l’homme. Sans que chacune des trois femmes ne soit dépeinte sous un jour défavorable – après tout, Elisa Whiting a eu l’élégance de s’éloigner de Jurav –, c’est plutôt l’absence de femmes parmi les initiés qui rend mal à l’aise et prête flanc aux accusations de misogynie.
Par ailleurs, on remarquera que le destin des trois hommes est irrémédiablement scellé par le meurtre bien davantage que par les signes qu’ils croient déceler dans le ciel ou sur des objets. Chaque meurtre est différent, celui de Cosimo se révélant le plus sordide et gratuit. Jurav a tué trois Allemands dans un contexte de guerre tandis que le meurtre du père demeure symbolique chez Vurain.
Thériault excelle à faire vivre ses personnages, à dépeindre leur caractère en utilisant un style tellement naturel et dépouillé. Il a souvent situé ses romans dans diverses régions du monde, faisant ressortir la culture et le climat social qui définissent ses personnages. Son cosmopolitisme le sert encore ici mais, des trois protagonistes, c’est Vurain qui est le plus thériausien. La volonté d’assumer ses racines amérindiennes, la redécouverte de la spiritualité de son peuple et la réappropriation de ses rites – notamment le ouabano –, tous ces indices m’incitent à croire que la proposition littéraire de Thériault repose sur la sincérité et l’authenticité.
La façon qu’il a de magnifier l’univers amérindien, d’évoquer la magie des shamans et les mystères que maîtrisent les Autochtones – voire leur descendance des habitants de l’Hyperborée – rappelle trop l’ode à l’amérindianité que représente Ashini pour que Le Haut Pays ne soit qu’une fumisterie. Ce serait trahir Ashini si c’était le cas. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’Yves Thériault, dans un même temps – et paradoxalement –, n’a pas voulu livrer une critique de la contre-culture hippie qui carburait au mysticisme à l’époque où le roman est paru. Je doute qu’Yves Thériault ait partagé les mêmes valeurs que Paul Chamberland, Emmanuel Cocke, Patrick Straram et autres Jean Basile.
Le Haut Pays est si atypique dans la production de l’auteur qu’il risque de déstabiliser ses admirateurs. C’est aussi ce qui fait son intérêt, a contrario. [CJ]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 394-396.
Références
- Carrier, Denis, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec V, p. 383.
- Spehner, Norbert, Requiem 3, p. 12-13.