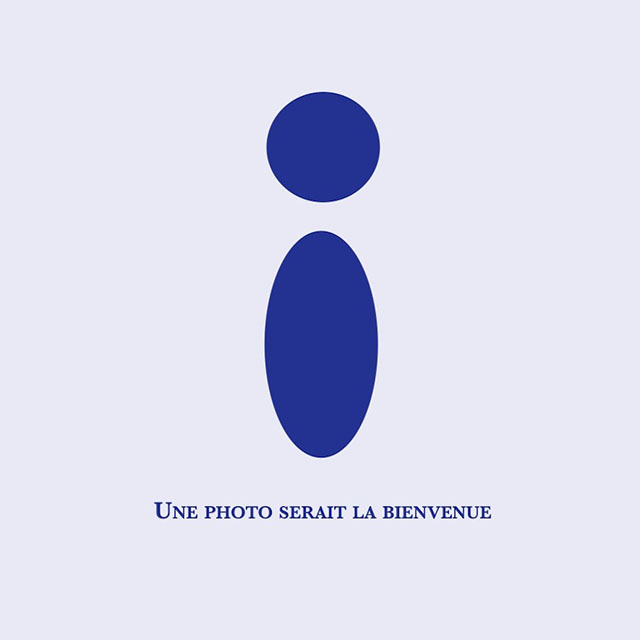À propos de cette édition

Résumé/Sommaire
Un être de plumes, vulnérable au soleil et incapable de s’en protéger, s’enflamme et subit de graves brûlures qui le débarrassent de son plumage et donc de ses ailes. S’ensuivent différentes transformations corporelles, allant de l’oiseau qui peut voler, à l’animal poilu qui marche à quatre pattes, pour finir nu, sans fourrure, humain. Il rencontre une femme, et ils sont prêts à affronter ensemble un nouveau début.
Commentaires
Pour ce texte fantastique essentiellement descriptif et hautement symbolique, Rivet s’inspire de plusieurs mythes, dont le premier est celui d’Icare. Dès l’incipit, l’auteur évoque la matrice de plumes dans laquelle se trouve l’être de la nouvelle éponyme, recroquevillé à l’image d’un fœtus, une jolie métaphore de la naissance. En l’absence d’une figure paternelle pour l’avertir du danger, tel Dédale pour l’Icare du mythe grec, c’est l’instinct de l’oiseau qui lui dicte de ne pas s’exposer au soleil, soulignant d’autant plus la nature animale d’Icare, puisque ce danger ne lui est pas appris.
En dépit de ce savoir inné, il voit tout son plumage, qui n’est pas fait de cire comme dans le mythe, disparaître en fumée et ne laisser que les tiges brûlées. C’est alors que l’apparition inopinée des rayons du soleil ne cause pas la mort, mais déclenche plutôt la renaissance douloureuse du personnage. Il n’est aussi pas étonnant d’y voir une allusion marquée au mythe du phénix, cet oiseau qui, après s’être consumé dans un feu, renaît de ses cendres. Après sa combustion et son écrasement au sol, Icare s’endort et n’est réveillé que par son estomac affamé, encore une mise en évidence de son animalité. Il se rend alors compte qu’il n’est plus un oiseau, mais un animal décrit tel un mammifère, marchant à quatre pattes et ayant un pelage nouvellement apparu.
L’animal semble être le même : il n’est pas question ici de réincarnation, mais d’une évolution, puisqu’il conserve des souvenirs de sa forme précédente, ce qui est sous-entendu par son réflexe de s’envoler, ce qui est maintenant impossible. Cette évolution ne nous semble pas seulement physique, mais aussi psychologique, puisque le déclencheur de la deuxième transformation d’Icare est le serpent aux couleurs vives qu’il chasse. Dégoûté par le sang et la chair, il jette alors son dévolu sur un arbre rempli de fruits rouges, bien que l’auteur insinue que ce soit une mauvaise idée car, repu, Icare se couche « pour oublier ».
L’habile insertion de deux motifs caractéristiques du mythe du péché originel chrétien, le serpent et la pomme, donne à Icare sa forme finale sans fourrure et surtout bipède, donc humaine. Bien que la pluie laisse croire qu’il n’est plus dans le jardin d’Éden, l’existence d’une entité omnisciente ayant le pouvoir de le punir est passée sous silence, ce qui donne un aspect agréablement universel au texte. Enfin, la découverte d’une femme, et de tout ce qu’ils ont à faire devant eux, agrémente la fin de l’œuvre de l’espoir d’une vie meilleure dont ils seront les seuls architectes.
La nouvelle de Rivet est donc un formidable amalgame de mythes illustres du monde et une magnifique allégorie : les transformations cycliques d’Icare au fil des leçons apprises en commettant des erreurs, son évolution, font immanquablement penser à la théorie de l’autodétermination et à la capacité de l’être humain de prendre sa vie en main. [SG]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 332-333.