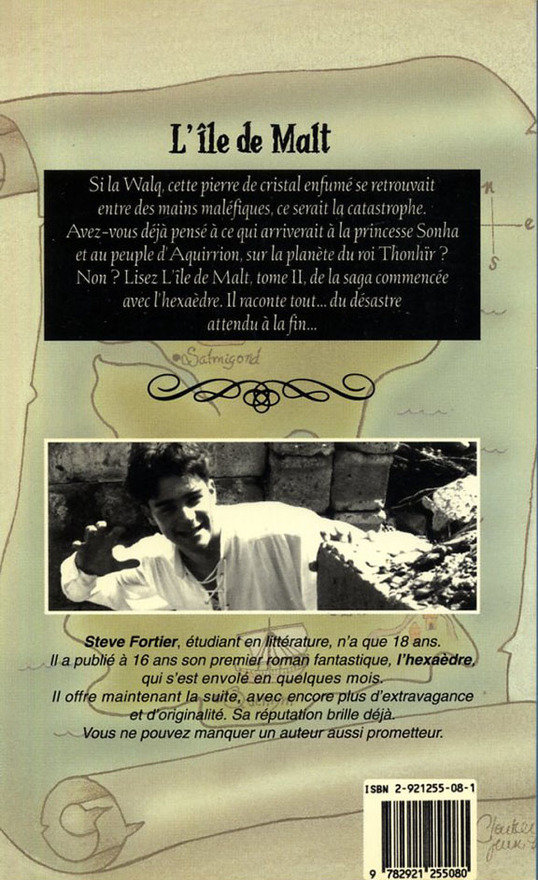À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
Pour Éric Tomasson, adolescent vivant chez ses parents au bord du fleuve, trois ans se sont écoulés depuis sa première visite sur Arquirrion, où il a vaincu le démon Norraus. Lorsque son père lui montre une gemme ramassée sur la grève, Éric reconnaît l’Hexaèdre, qui l’avait magiquement transporté sur la planète lointaine. De fait, il s’y retrouvera de nouveau, après une nuit agitée de rêves et de cauchemars. Le mage Menthar, conseiller du roi, l’y accueille et lui révèle qu’il devra cette fois-ci empêcher Madipe, le Paladin noir, de s’emparer de la Walq, la pierre du mal, et la prendre lui-même dans la vallée du Serpent d’or pour l’apporter en lieu sûr, dans l’île de Malt.
Rebaptisé Ulric par le roi, le jeune homme, délesté de l’épée Twinmaryl par des malfrats, se rend à Trésidrammon, où la druidesse Ursim lui enseigne « les principes de la magie contemporaine », puis l’aide à reprendre Twinmaryl aux trois brigands croisés par hasard. Avec une facilité dérisoire, Ulric cueille la Walq enfouie sous une roche, tandis que le Paladin noir et sa cavalerie surgissent et se laissent convaincre de passer tout droit, la magie d’Ursim s’avérant remarquablement utile. La traversée à bord de La Madrague est interrompue par l’attaque d’un serpent de mer ; Ulric est englouti durant l’affrontement, mais refait surface, littéralement, au port de Salmigond dans la grande île de Malt. Son bouclier magique, Dwainkïr, a généré une bulle autour de lui, le sauvant de la noyade. En cours de route, avec un faire-valoir nommé Ol, on assiste à un nouvel affrontement magique entre Ulric et ses compagnons d’une part, le Paladin noir et ses sbires d’autre part.
Le dernier acte se joue à la Vallée des dragons où le trio, tantôt à cheval, tantôt à pied, arrive avec la Walq, jusque-là intacte malgré naufrage et batailles. Hélas, un choc la fissure lors d’une chute malencontreuse de la druidesse, et l’équilibre du monde s’en trouve instantanément ébranlé : zizanie, agressivité et transformations bizarres se propagent dans la contrée jusqu’à ce qu’Ursim trouve le moyen de « réparer » la gemme… avec de la boue. Ulric parvient à aller la cacher au fond de la caverne de deux dragons, qui agiront désormais comme gardiens. Le dernier chapitre, narrant un retour quasi instantané au château du roi Thonhir, s’interrompt littéralement au milieu d’une phrase…
Commentaires
L’Île de Malt est la suite de L’Hexaèdre, publié lorsque Steve Fortier avait seize ans. Ce roman-ci est paru deux ans plus tard. La douloureuse absence de direction littéraire aux Éditions de la Paix se manifeste dès la première page de L’Île de Malt et ne se dément jamais. En relever des exemples serait un exercice aussi vain qu’arbitraire : presque trente ans après sa fondation, on sait qu’il n’y aura jamais eu de direction littéraire digne de ce nom dans toute l’histoire de l’éditeur granbyen. Un critique disposant de loisirs infinis rédigerait facilement cent pages sur les maladresses narratives et stylistiques de ce roman jeunesse de cent pages, sans parler des naïvetés – ou carrément des pitreries – accumulées au fil des chapitres.
Le thème éculé des civilisations extraterrestres appelant un jeune humain à la rescousse est le ressort de ce petit roman, comme il l’était dans L’Hexaèdre, où le caractère impérieux de ce besoin était peut-être expliqué (mais je soupçonne que non). Lorsque toutes les ressources d’une civilisation avancée échouent, lorsque toute la magie d’un royaume s’avère insuffisante, il est bien connu qu’un adolescent terrien désigné par le hasard fera l’affaire. « Tu es de retour ! Une fois de plus, tu reviens sur notre planète pour sauver notre existence. Brave jeune homme ! » (p. 39) Éric/Ulric serait donc un héros, infaillible et exceptionnellement brillant ? Il accumulera pourtant bourdes, gaffes et étourderies, comme oublier d’enlever sa cote de maille avant d’affronter le serpent de mer à bord d’une barque, dans un combat où il risque à coup sûr de tomber à l’eau – et ça ne rate pas.
Universellement, le principe moteur de ces situations s’appelle « n’importe quoi » et se manifeste de manière fractale, si l’on peut dire : au niveau macroscopique ci-haut mentionné, autant qu’au niveau de la péripétie ou de l’anecdote. Ainsi, pages 28 et 29, Éric reçoit le cours intensif de navigation qui lui permettra d’atteindre l’île de Malt et que le roi Thonhir a eu la clairvoyance de prévoir pour lui. Cela dure facilement dix minutes, peut-être même un quart d’heure, tant il est vrai qu’il ne faut rien négliger. (Mais le jeune homme ne sera de toute façon que passager…).
Faire l’apprentissage de la magie sera quelque chose d’encore plus sérieux, de plus exigeant : la séduisante druidesse Ursim consacrera pas moins de deux jours à la lui enseigner. Steve Fortier ne connaissait manifestement pas le cycle Terremer d’Ursula LeGuin où l’apprenti Ged n’a pas trop d’une vie pour comprendre et maîtriser les équilibres de la magie. Toutefois, qu’on se rassure, ce qui est à l’œuvre dans L’Île de Malt, c’est la magie du « n’importe quoi ».
On serait tenté de croire que la narration recourt systématiquement au procédé de l’ellipse, mais ce serait prêter trop de capacités au jeune auteur. Ces raccourcis et sauts d’envergures diverses (sauts de puce, sauts de lièvre et autres coq-à-l’âne saugrenus) témoignent simplement de son insondable maladresse. À divers endroits, il manque un détail, une information, que Fortier avait sûrement en tête, qu’il croyait peut-être nous avoir fournie, mais qu’on doit reconstituer en supposant qu’elle apparaissait dans le premier roman. Ici encore – on m’excusera d’enfoncer le même clou –, un travail d’édition minimalement compétent aurait relevé ces carences, obligé l’auteur à étoffer ses scènes et à mieux ficeler ses enchaînements. À ce chapitre, il faut se réjouir de la brièveté du « roman » car les choses empirent au fil des pages, jusqu’au second affrontement avec Madipe qui s’avère carrément confus.
C’est au point où le lecteur adulte en est réduit à aider mentalement (et rétrospectivement) le jeune auteur : « d’accord, ici il nous raconte une mutinerie, mais il ne connaît pas ce mot ». Pas plus qu’il ne connaît « château », « gaillard » ou « dunette » pour nommer ce qu’il appelle « un balcon », à bord d’un navire. Faut-il ajouter que le tableau qu’il esquisse de la vie à bord d’un voilier… sombre dans le ridicule ?
On ne se surprend guère des anachronismes qui surgissent dans un contexte pseudo-médiéval : des coups de feu entendus pendant un affrontement, un capitaine de galion qui porte un « costume sombre, cravate et chemise pâle, […] Un cigare à la main gauche, une canne dans l’autre, un parfait gentleman. »
Dois-je alourdir le verdict en commentant les dialogues ? « Oh ! soutint le Terrien. » (p. 81) Le marchand de sottises s’est montré équitable dans sa répartition : on en trouve autant dans les dialogues que dans la narration ou le développement (!) des personnages.
La dernière phrase se lit « Une technologie… » et est suivie de la mention « Fin du tome 2 ». Qu’on me permette d’anticiper sur les ASFFQ 1997, 1998 et suivantes : il n’y aura jamais de suite et le jeune Fortier passera à autre chose.
Pour tout dire – et ce n’est pas une blague –, il agira pendant quelques années comme lecteur-conseil auprès de l’éditeur de ses premiers textes… [DS]
- Source : L'ASFFQ 1996, Alire, p. 89-92.
Références
- Spehner, Laurine, Lurelu, vol. 20, n˚ 2, p. 23-24.