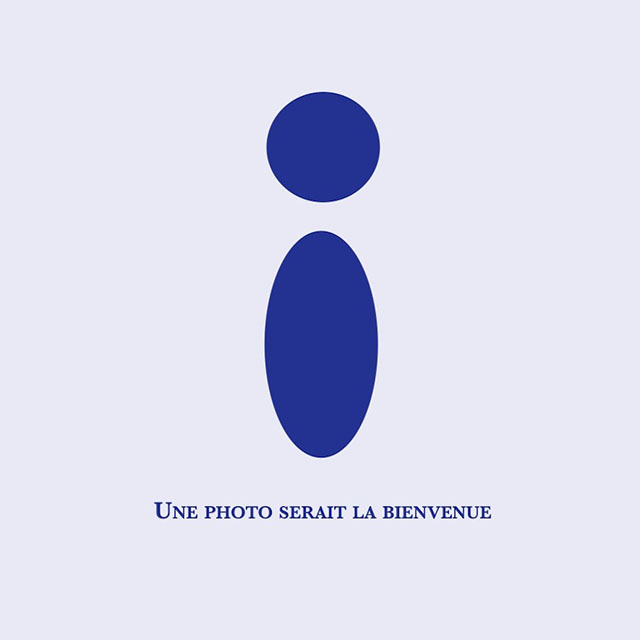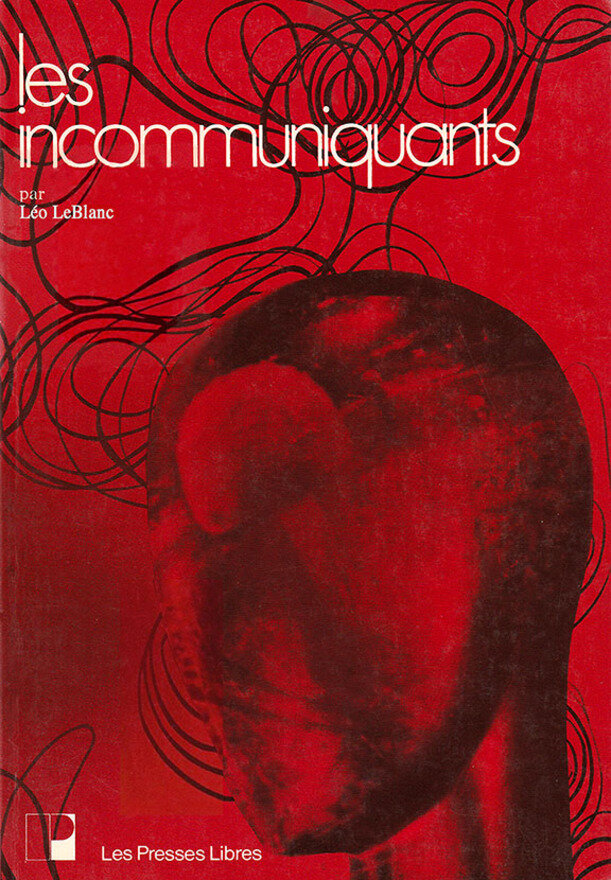Résumé/Sommaire
Un scientifique nommé l’Oiseleur est aux prises avec un groupe de conspirateurs qui veulent réduire à leur plus simple expression les activités humaines de communication. Et quelle est la théorie qui sous-tend l’action de ces Incommuniquants ? « Les hommes pensent trop et communiquent trop ! Ces communications sans fin sont en train de former un cocon d’ondes autour de la Terre, ce qui va la couper complètement du réseau intercommunicatif de l’univers, lui faisant perdre un important relais. Et de la même façon que vos ordinateurs s’autorèglent, l’univers va s’autorégler en éliminant la source du désordre : la pensée humaine. » L’Oiseleur affrontera le Grand Incommuniquant dans un combat singulier et repoussera la menace que l’organisation terroriste faisait peser sur le monde.
Commentaires
Dans les récits de science-fiction, l’état des communications sert souvent à préciser le degré de développement de la société décrite. En quelques mots, le lecteur est situé : la société qu’il découvre a atteint un haut niveau de perfectionnement, souligné par l’usage répandu de l’ordinateur, ou elle a considérablement régressé en revenant aux formes primitives de la communication, révélation implicite qu’une catastrophe nucléaire a eu lieu. Les moyens de transport et de communication apparaissent dès lors comme des signes essentiels dans une littérature aussi codée que la SF.
Léo LeBlanc a fait de la communication le thème principal de son roman. Le but qu’il poursuit est évident : le romancier veut rendre hommage à la communication qui a « permis aux hommes de se connaître, de savoir leurs besoins réciproques, de mettre un terme à leur misère, contre la faim. » Les intentions de LeBlanc sont nobles, sans doute. Malheureusement, on a l’impression que le débat sur la question n’a jamais eu lieu et que les dangers provenant du développement sauvage des communications ont été trop vite escamotés. Les prétentions des Incommuniquants ne sont pas aussi farfelues qu’il y paraît à première vue, mais l’auteur ne fait rien pour les réfuter. C’est la loi du plus fort qui légitime tout.
De même, la victoire de l’Oiseleur consacre, aux yeux de l’auteur, la primauté de l’Homme sur l’Univers. Ce choix, et surtout la bonne conscience du héros, ne manquent pas de rendre ce roman hautement contestable. Ma réaction serait peut-être différente si l’auteur avait approfondi son thème central.
Sur un sujet similaire, il faut voir ce qu’a fait Agnès Guitard dans le cadre d’une nouvelle, « Les Virus ambiance ». Elle a su enrichir son récit de considérations sociologiques de toutes sortes et doter ses personnages de sentiments intérieurs, ce que ne parvient pas à faire Léo LeBlanc. Son récit platement anecdotique rappelle les malheureuses tentatives littéraires d’Henri La France et de Jacqueline Aubry-Morin.
Il manque aussi au roman de LeBlanc une distanciation minimale par rapport à la réalité. L’intrigue est censée se dérouler dans un proche avenir – le roman ayant été publié en 1971, on peut penser que le récit se situe au début de la décennie suivante – mais l’auteur évoque le Montréal de 1967. Visiblement impressionné par l’Exposition universelle, il ne rate pas une occasion de décrire les différents pavillons de Terre des Hommes. Ce souci finit par indisposer sérieusement le lecteur.
Le problème fondamental de ce roman, c’est que l’auteur ne sait pas quel genre adopter. Le cadre et la situation de départ appartiennent à la science-fiction, mais le comportement et la mission de l’Oiseleur en font plutôt un personnage de roman policier. Ajoutons à cela que l’auteur veut donner à son récit un caractère documentaire en décrivant l’architecture des pavillons d’Expo 67 et qu’il a des prétentions poétiques. Un exemple, parmi d’autres, de cette recherche ridicule de l’effet poétique : « L’amas de l’aube s’estérifie en un jour bleu clair. » (p. 63).
Il ne faut donc pas s’étonner que le récit manque d’unité, qu’il ne sache pas dans quelle direction aller et qu’il ne soulève en aucun temps notre enthousiasme. L’écriture n’arrange rien : elle est platement descriptive et elle affiche un manque flagrant d’imagination et de maîtrise. L’auteur nous inflige des phrases mal construites : « C’est à cet endroit précis, se dit l’Oiseleur, que monsieur de Paul a inauguré le pavillon avec le couteau auquel ressemblait de si près celui reçu à l’appartement du Maisonneuve. » (p. 26).
Le récit contient aussi de nombreuses redondances, de la philosophie à la petite semaine et des réflexions tout à fait oiseuses sur l’antipathie et la haine qu’éprouvent les gens à l’endroit des policiers. « Un humour qui ne s’affiche pas ! » lit-on sur la quatrième de couverture : en effet, on ne voit aucune trace d’humour dans ce livre ! La seule qualité que je trouve à ce roman, c’est d’être court…
Que pourrais-je ajouter de plus ? La trame narrative est tellement mince qu’elle tient dans un résumé de quelques lignes. Tout le reste n’est que verbiage, propos poétiques qui tentent maladroitement de transmettre l’émerveillement de l’auteur devant la beauté de la Terre et de la nature. LeBlanc dédaigne le matériau romanesque, de sorte que son œuvre est pauvre en rebondissements, en situations équivoques et en personnages inquiétants.
Rarement ai-je vu un personnage principal aussi peu vivant et incarné. Il n’a pas de racines et ne correspond en rien au modèle du Québécois. Quelle idée de confier la responsabilité de l’espèce humaine à cet individu solitaire, aussi abstrait, aussi peu humain ! Le choix du Québec comme carrefour des télécommunications apparaît aussi gratuit qu’arbitraire. Tout est en porte-à-faux dans ce livre ; il n’y a aucune page qui sonne juste. Il n’y a rien qui fonctionne dans cette histoire. Les protagonistes semblent appartenir à un autre univers et le lecteur ne se sent jamais concerné par l’enjeu de l’affrontement.
Pour un roman qui a comme sujet principal la communication, il est navrant de constater que l’auteur ne réussit jamais à établir une quelconque communication avec le lecteur. Léo LeBlanc, Acadien d’origine comme Ronald Després, prouve encore une fois qu’un théoricien ne fait pas nécessairement un bon romancier. L’information est une chose, la littérature en est une autre. [CJ]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 281-283.