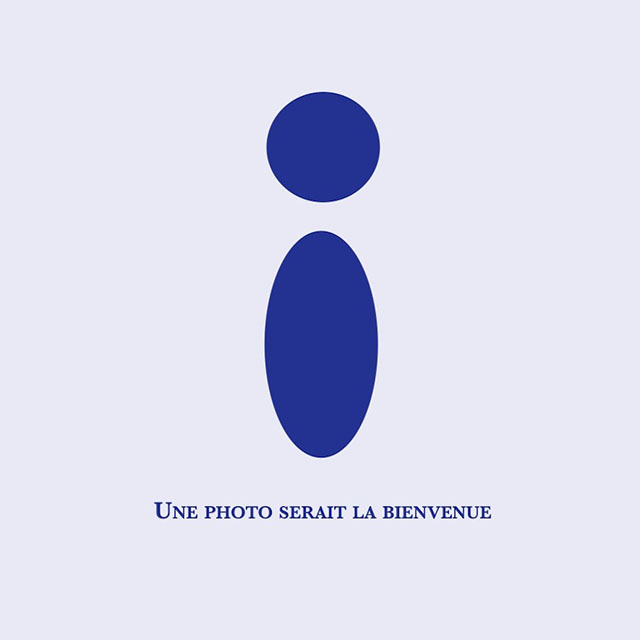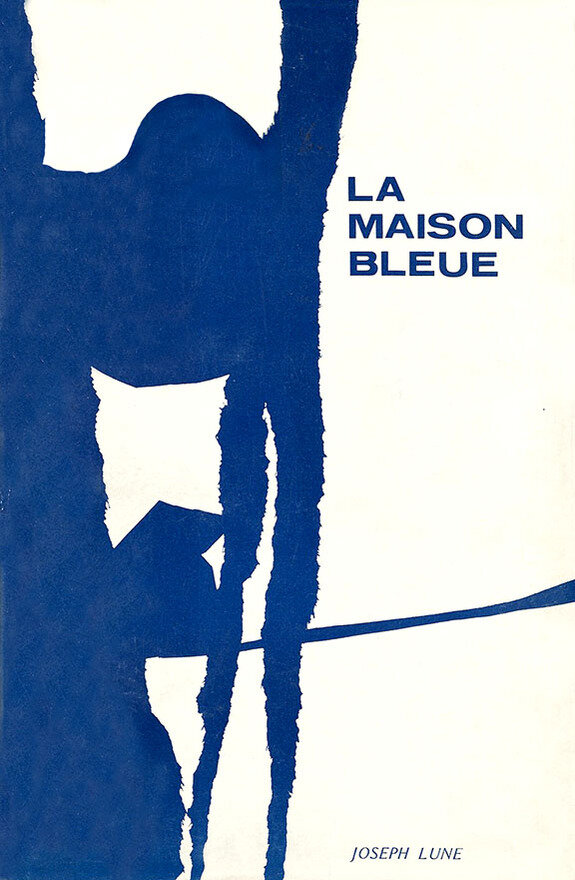Résumé/Sommaire
Monsieur Rose, artiste peintre sans envergure et alcoolique notoire, peint, un beau matin, une scène naturelle qui disparaît sitôt le tableau achevé, laissant place à un désert. L’événement nécessitant une bonne cuite, il répète, le soir venu et passablement éméché, l’expérience avec le laideron qui occupe alors son lit. Le succès de cette seconde tentative force aux réjouissances, ce qu’il ne tarde pas à faire le matin venu dans un bistrot où il fait la rencontre de monsieur Ponce, écrivain médiocre dont on refuse les manuscrits et, lui aussi, alcoolique notoire. Les deux artistes ratés, saouls, affirment qu’ensemble ils détiennent la clé de l’Univers « pour connaître l’Ultime et nous faire inviter quelque temps dans l’une des vastes pièces de la Maison Bleue ». (p. 26) Ils utilisent un pinceau pour ouvrir une brèche dimensionnelle qui les mène au Pays de la Renaissance, un monde de tableaux de grands peintres où ils rencontrent successivement Mona Lisa, Leonardo da Vinci et Raphaël, avant de visiter le pays des impressionnistes.
Déçus de ne pas en apprendre davantage au sujet de la Maison Bleue, les deux comparses utilisent ensuite une plume afin d’entrer dans la dimension de l’écriture, où ils rencontrent François Villon, Boris Vian, Émile Nelligan et Paul Verlaine, avec lesquels ils s’enivrent. Ces derniers tentent de décourager nos deux artistes, qui décident tout de même de poursuivre leur quête, laquelle les mène devant un jury composé de figures bibliques, du Père Noël et de Joseph Lune.
Le jury détermine que Rose et Ponce doivent compléter cinq épreuves avant de connaître la vérité sur la Maison Bleue : survivre à un monde qui est en réalité l’épiderme d’une géante nue en train de se masturber ; observer leurs propres cadavres dans une cathédrale où ils doivent tuer leur mère respective (Rose s’y refuse) ; être crucifiés aux côtés de Jésus, puis décapités ; rencontrer un pilleur de tombes cannibale et sataniste du nom de Hedjelé, à l’apparence d’un rat et qui dérobe leurs têtes coupées ; pénétrer dans le cirque des monstres, où le pire monstre est l’homme au service d’un gouvernement débauché.
Au terme de ces épreuves, Ponce, jugé indigne, se réveille dans notre monde en bossu, alors que Rose découvre la vérité sur la Maison Bleue, qui n’est nulle autre que la plume de Joseph Lune, avec lequel il a un entretien.
Commentaires
La Maison bleue est un roman d’un amateurisme flagrant qui tente vainement de se faire passer pour une œuvre d’avant-garde. Tout au long du récit, trop souvent décousu, le lecteur se demande constamment où l’auteur veut en venir, tant l’ensemble tient davantage du fantasme artistique et de la rêverie éthylique que de la véritable démarche créatrice. Joseph Lune jouissait de sa machine en écrivant, ou s’enivrait, ou les deux – on ne le saurait dire, et on s’en fout un peu –, et tentait de transposer cette explosion euphorique en un récit qui se voulait original mais qui tombe franchement à plat. C’est moche et sans réelle substance, et l’ensemble manque singulièrement de direction littéraire, au point où on se demande si la Maison d’édition populaire ne serait qu’une façade pour une publication à compte d’auteur, tellement le texte aurait nécessité une révision. Stylistiquement parlant, en effet, le lecteur est trop souvent confronté à des phrases inutilement ampoulées et désuètes, lesquelles conviennent mal à un récit qui se veut pourtant avant-gardiste et où l’argot aurait été de mise, vu l’ivrognerie des protagonistes – ne serait-ce que dans les dialogues. Cette faiblesse stylistique atteint d’ailleurs un degré de mauvais goût particulièrement indigeste lorsque Lune insère quelques vers de son cru, notamment lorsque Ponce et Rose visitent le pays de l’écriture, lesquels contrastent alors de manière flagrante avec les quelques citations de poésie canonique qui y sont également insérées, dans une juxtaposition qui révèle chez Lune le mauvais écrivain qu’il est.
Il y a bien quelques bonnes idées parmi ce ramassis de grand-n’importe-quoi et de délire alcoolisé, dont le summum demeure les cinq épreuves permettant d’accéder à la Maison Bleue. Lune se mettant en scène lui-même, dans une sorte de jeu métafictionnel où il entre en contact avec ses propres personnages, en est certes la plus intéressante, la finale donnant alors lieu à un petit moment savoureux – c’est déjà ça, certains diront –, mais c’est trop peu trop tard, et cette chute ne suffit pas à rehausser l’ensemble du texte, lequel s’apparente davantage à une ode à la beuverie et à l’art pour l’art plutôt qu’à une véritable création romanesque. À ce sujet, Lune ne manque jamais une occasion de sermonner son lecteur à propos de sa propre vision artistique – ce qui agace, parce que trop souvent insérée gauchement ou brutalement, comme si on nous l’enfonçait dans la gorge à s’en étouffer. Il y a bien quelques réflexions qui se démarquent des autres en ce qu’elles rejoignent une tendance lourde de l’époque où le texte a été écrit en faveur, d’une part, d’un retour de l’art pour l’art, et, d’autre part, d’une démarche créatrice reposant sur les paradis artificiels qui s’incarnait, en SF, dans une certaine frange de la new wave anglo-saxonne (Philip K. Dick, J. G. Ballard, pour n’en nommer que deux), à laquelle Lune semble vouloir se rattacher, comme dans cet extrait (dont la stylistique, ici admirable, n’est pas représentative de l’ensemble, il faut le souligner) : « [Rose] comprend que l’Art, prisonnier des frontières physiques, ne peut atteindre l’extase de la pure création ; que l’homme s’y transfigure trop facilement, et que cela tache non seulement l’œuvre, mais aussi l’individu ainsi transposé. » (p. 103)
Certes, l’appartenance générique de ce récit au corpus science-fictionnel québécois demeure indéniable, ne serait-ce que par l’emploi du topos des mondes parallèles ; mais il convient de souligner le caractère grotesque et sans grande imagination du moyen utilisé pour pénétrer dans lesdits mondes parallèles. Brandir un pinceau lorsqu’on est saoul afin de pénétrer dans le monde de la peinture ? Faire de même avec une plume en ce qui concerne le monde de l’écriture ? Franchement, c’est niais et sans grand intérêt. Cette sorte de passe-droit facile rappelle de vieux épisodes de cartoons vieillots à la sauce Hannah-Barbera ; sauf que le public cible, ne serait-ce que par le délire éthylique grotesque et insipide du contenu, n’est certainement pas celui d’une jeunesse naïve à qui on peut faire avaler un peu ce que l’on veut – en l’occurrence du mauvais vin qu’ingurgitent les deux protagonistes du récit.
En somme, le lecteur intéressé par la science-fiction et le fantastique n’y trouvera pas son compte dans ce récit somme toute mineur, qu’il vaut mieux reléguer aux oubliettes de l’histoire littéraire. [MRG]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 296-298.