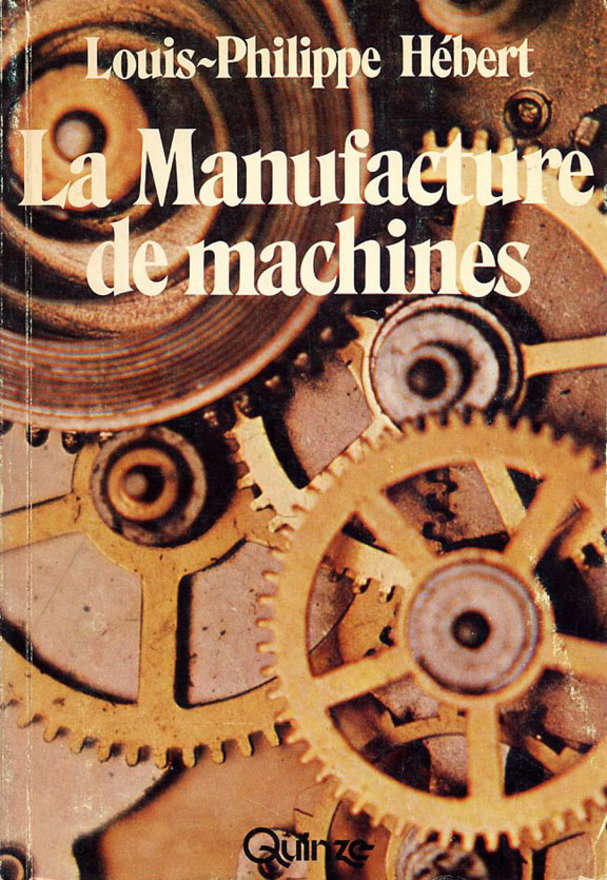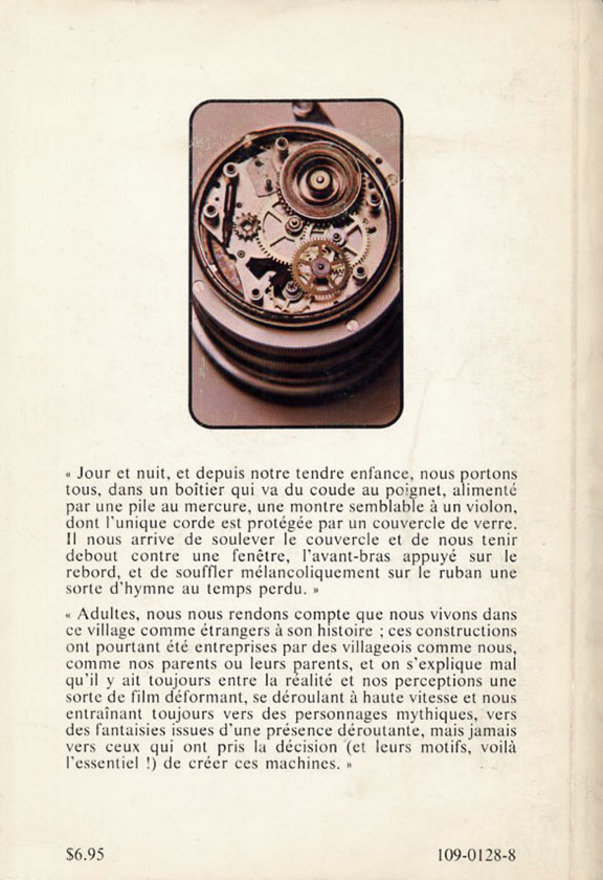À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
[7 FA ; 6 SF ; 2 HG]
Le Discours d'utilité
L'Aqueduc
Le Robot (1)
Les Cogneurs
La Fugue
Lettre à propos d'un trapèze
L'Activité cérébrale des gardiens de nuit
L'Extracteur de jus (robot 2)
L'Horloge musicale
La Valse des pieds ronds
L'Hôtel
Le Manoir de la Taupinière
Les Portiers
Le Vaisseau
Le Bernard-l'ermite (robot 3)
Autres parutions
Commentaires
Il faut surmonter la difficulté que présentent les premières pages des nouvelles de Louis-Philippe Hébert pour en apprécier le sens et, surtout, le commentaire extrêmement pertinent sur la société technologique. Ce n’est pas tant l’écriture qui est hermétique, malgré l’absence de paragraphes ; ce sont les machines insolites ou improbables qu’il est parfois difficile de se représenter malgré la précision inouïe des descriptions. Je serais bien en peine de dessiner l’appareil de « Robot 1 », la locomotive de « La Fugue » ou l’horloge musicale. On dirait des machines imaginées par Dali.
Au-delà des descriptions déroutantes cependant, c’est tout un monde absurde soumis à la technologie et un système qui tourne à vide qui se révèlent progressivement, chaque nouvelle ajoutant une couche de stupéfaction. Le recueil d’Hébert est savamment construit et compose un microcosme fascinant par l’entremise du village de Canterelle. On se croirait par moments dans le village de la série britannique Le Prisonnier, diffusée dans les années 1960.
Si la manufacture de machines est le point focal du village, elle n’en est pas le seul lieu d’intérêt. Des édifices tels que la gare, l’hôtel, l’horloge musicale, le funérarium et l’observatoire présentent des caractéristiques étonnantes. C’est ce qui fait la force du recueil, cette représentation implacable de la condition humaine qui s’impose à travers le cahier des charges d’une machine. L’individu est impitoyablement broyé par le Système, par la machine qu’il a lui-même créée. Toutes ses tentatives pour échapper au moule et se distinguer de la masse – par l’invention (« Le Discours d’utilité »), par le voyage (« La Fugue »), par le zèle même – se butent à un mur. Son existence apparaît futile.
Le dernier texte, « Le Bernard-l’ermite (robot 3) », pousse à l’extrême l’idée de se fondre dans la collectivité, de nier son individualité. C’est le texte le plus politique du recueil car il y est question d’un peuple, la population du village – microcosme de la société québécoise (?) –, qui, plutôt que d’utiliser les avantages de la « cage libératrice » pour décupler la force de son utilisateur et réaliser ainsi des choses grandioses, détourne le fonctionnement de l’invention pour réduire son corps à la grosseur d’un pois et enclencher sa disparition inévitable.
L’étude de l’astronomie peut nous amener à concevoir le cosmos comme une mécanique extrêmement complexe et réglée au quart de tour que le space opera scruterait avec le gros bout de la lorgnette. Pour sa part, Hébert regarde l’univers par le petit bout de la lorgnette en gardant en tête cette conception mécanique qu’il applique à une petite échelle. Il décortique le mécanisme des machines, tel un minutieux ingénieur mécanique, mais ce qui ressort de ses descriptions, c’est une absence de sens, un aveu d’inutilité. L’Homme n’est même pas ce grain de sable qui peut enrayer les rouages.
L’œuvre d’Hébert constitue une charge violente contre la société technologique qui produit des machines sans utilité. Elle diffuse un climat kafkaïen en raison de la lourdeur de la bureaucratie qui refrène toute velléité de création, de spontanéité. Incapable de se révolter, coupé de ses émotions, l’Homme est piégé par ses inventions, il est l’artisan de sa déshumanisation, de son glissement progressif vers sa condition de machine (« L’Extracteur de jus (robot 2) »). Autre exemple de cette autorégulation du système dont les individus sont les victimes consentantes : la nouvelle « Le Vaisseau », inspirée par un examen de la vue chez un optométriste. Voilà une merveilleuse métaphore d’un État totalitaire qui surveille ses citoyens car les observateurs – ceux qui regardent dans une lentille à cœur de jour – peuvent être dénoncés par les notes de leurs confrères. Le travail d’observation n’a aucune finalité scientifique ; c’est un leurre qui, au mieux, permet d’éliminer les éléments indésirables ou déviants.
Dans « L’Aqueduc », superbe nouvelle qui n’est pas sans évoquer la bibliothèque de Borges, c’est la curiosité et le zèle qui mènent le gardien à sa perte. Le narrateur décrit un funérarium souterrain composé de plusieurs niveaux de galeries à travers lesquelles se déploie un réseau de canalisations. L’eau qui traverse la nécropole alimente l’aqueduc et semble faire le lien symbolique entre les morts et les habitants du village.
Le climat oppressant suggéré par l’absence de paragraphes et la vision très pessimiste de la condition humaine attribuable à l’attitude fataliste et résignée des divers protagonistes – jamais désignés par leur nom propre, uniquement par leur fonction – peuvent laisser croire que La Manufacture de machines est un recueil très déprimant. Ce n’est pourtant pas le cas. Outre l’intelligence du propos qui multiplie les pistes de réflexion, un humour subtil jaillit ici et là à travers les observations neutres ou candides de certains narrateurs qui démontrent malgré tout une certaine lucidité. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui semblent avoir réussi le mieux à préserver leur humanité. Je pense à ce gallinacé mécanique de la dernière nouvelle du recueil, bien conscient de la situation et de son rôle [voir le résumé plus bas]. Ce qui apparaît nettement dans la juxtaposition des textes – qui n’auraient pas la même force publiés à la pièce –, c’est l’érosion progressive de la frontière qui sépare l’Homme de la machine, un des thèmes de la science-fiction moderne.
La Manufacture de machines est une œuvre dense et cérébrale, à l’écriture formaliste proche de l’esthétique du Nouveau roman. Même si le recueil est paru il y a plus de quarante ans, il conserve toute sa pertinence et son actualité. On peut certainement le considérer comme un classique de la science-fiction québécoise et le sommet de l’œuvre littéraire de Louis-Philippe Hébert. [CJ]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 258-262.
Références
- Canty, Daniel, Le Devoir, 18/19-02-2023, p. B6.
- Fournier, Martin, Requiem 16, p. 18.
- Morin, Lise, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec VI, p. 490-491.