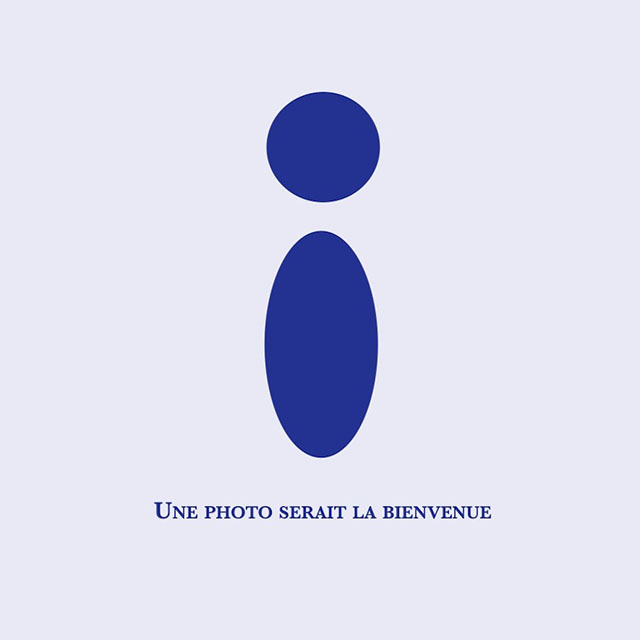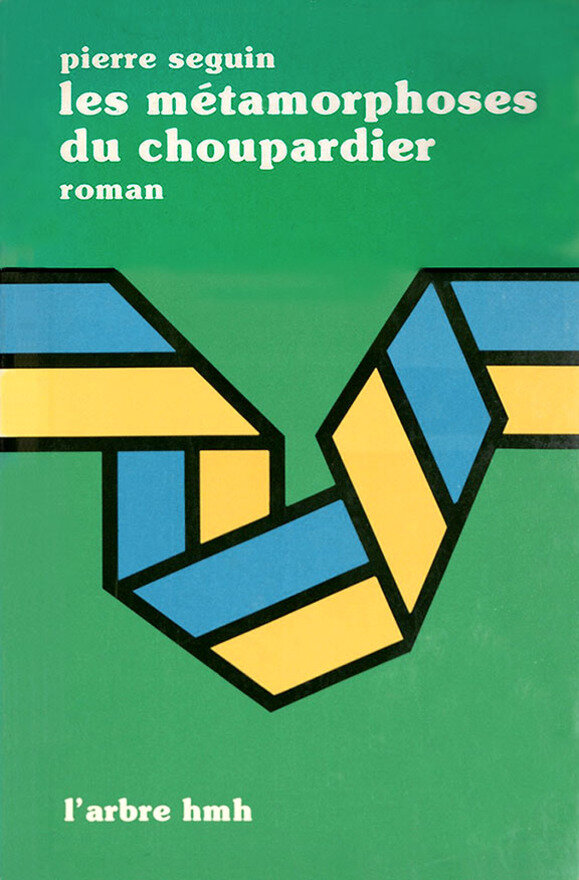Résumé/Sommaire
En Méricie, une majorité d’hommes se retrouvent émasculés du jour au lendemain. En ces temps incertains où les victimes sont obligées par le gouvernement de porter une prothèse de plastique pour compenser cette perte, la politique et les joutes oratoires insolites et violentes deviennent le nouveau divertissement par excellence. Au gouvernement, il y a Joseph, le directeur du Parc zoologique, qui se voit confier la mission de monter de toutes pièces la capture du mythique choupardier, une bête fantastique ayant la capacité de se métamorphoser, mission qui jouerait un grand rôle de diversion parmi les différentes décisions politiques du gouvernement.
Ainsi forcé dans cette aventure, Joseph amène avec lui un gorille du zoo en Troglésie pour le faire passer pour le choupardier, alors seulement une légende. La supercherie est pourtant inutile puisque, accompagné du vieillard Sigismond, Joseph trouve le vrai animal quelques minutes après qu’une chute de grêle tue le gorille. Malgré les protestations de Sigismond, Joseph ramène le choupardier au zoo et connaît la gloire.
Tout ne devient alors qu’astuces et machinations, propagande et chantage afin de faire de l’animal l’unique sujet de conversation des médias, une vedette incontestée grâce à laquelle des produits dérivés seront vendus. La découverte du choupardier devient le sujet préféré des scientifiques et des experts de tout acabit, qui sont tour à tour acclamés et conspués pour leurs observations toutes plus ou moins fondées.
L’animal extraordinaire, qui change d’apparence selon la personne qui le regarde, cause la controverse et le bonheur dans tout le pays. Des gens espèrent le voir mourir, d’autres tentent de l’aider à s’échapper, et le récit est une suite de revirements au bout desquels un Joseph déchu tente de retrouver le choupardier enfui, afin de se venger de lui et de l’éliminer. Mais c’est le choupardier qui, en dévalant la montagne dans une boule de neige géante, se tue par accident.
Commentaires
Le roman de Pierre Séguin est un étrange amalgame de fantastique, de dystopie et d’absurde. Le style de l’auteur est notable : un mélange habile de niveaux de langue soutenu, vieilli, familier, même argotique et joualisant, sans oublier quelques anglicismes et des expressions latines. Tout ce vocabulaire se marie bien tout en donnant une ambiance étrangement familière au récit, une familiarité accentuée par des noms de famille très communs au Québec, tels que Braband, Lachance et Laliberté. À ce mélange s’ajoutent des mots inventés, qu’on comprend par leur ressemblance à quelque chose de connu, un aliment appelé « érablette », par exemple, ce qui bien sûr rappelle l’érable. La combinaison de ces différents lexiques laisse croire que la Méricie serait en fait le Québec, sans pour autant le confirmer. De plus, bien que cela ne prenne qu’une place minime dans le récit, la présence de l’Église catholique renforce cette idée simplement par l’évêque qui mentionne « l’Église » et le « Christ ».
Le narrateur omniscient aime faire sentir sa présence et ce, en utilisant à l’occasion des formulations à la première personne du pluriel, soit par l’usage d’adjectifs possessifs ou du pronom personnel « nous », ce qui se justifie par son titre « d’historiographe de la glorieuse République méricienne ». Il tente de rapporter les faits le plus fidèlement possible, appuyé selon lui par de nombreux témoins. Lorsqu’il ponctue son récit de ses commentaires, c’est soit pour souligner les mérites et les fautes de personnalités historiques de la Méricie, soit pour se disculper d’éventuels reproches du lecteur sur la véracité et l’absurdité du récit. C’est dans ces derniers commentaires que s’opère la distanciation qui cultive le mystère entre réalisme et fantastique. Le narrateur pousse le lecteur à croire en l’impossible, en complimentant les rêveurs, qu’il considère comme les personnes intelligentes, tout en ridiculisant les personnes pragmatiques.
Vers les deux tiers du récit, les commentaires se font de plus en plus nombreux, surtout en présence du personnage de Samuel Laliberté, un ivrogne notoire que Joseph a rencontré au tout début du livre. Cette multiplication s’opère par l’insertion de parenthèses, et elle est si frappante qu’elle confirme que, tout comme le narrateur, Samuel est en soi un observateur du récit. Il est d’ailleurs intéressant de constater que c’est aussi un homme marginal : il a échappé à la grande castration, c’est un clochard et il fait souvent le procès de la société, tout cela avec une grande liberté mise en évidence par son patronyme. Ses critiques à l’endroit du gouvernement et de ses concitoyens sont véridiques, mais personne ne l’écoute puisqu’il est enivré la plupart du temps. Il a donc le rôle du fou du roi, voire de la Cassandre du récit, et c’est celui qui devient le plus grand ami du choupardier, celui qui le comprend le mieux. Il sera d’ailleurs le témoin de la mort de l’animal et évidemment le premier à découvrir sa vraie forme, soit celle d’un être humanoïde qui, selon la bête elle-même, serait supérieure aux hommes en intelligence, parce que leurs pensées sont ridicules.
Le côté fantastique est représenté par cette bête légendaire du choupardier, qui n’est prétendument qu’une croyance populaire qui n’intéresse que les enfants de Troglésie. C’est donc une heureuse surprise pour le ministre Siméon Lachance et Joseph lorsque ce dernier revient en Méricie avec l’animal, qui se métamorphose selon les personnes qui le regardent. Au lieu de duper le peuple, comme prévu, avec un gorille, ils pourront montrer le vrai choupardier, qui est si fascinant et surréel que des gens lui confèrent même une aura divine. D’ailleurs, l’Église est rébarbative à l’idée qu’une bête fantastique remplace sa propre influence sur le peuple, une crainte justifiée au point de planifier son assassinat. Pourtant, l’ascendant du choupardier sur la foule sera malgré lui renforcé par ses pouvoirs de transformation.
Toutefois, le monde dans lequel évoluent les personnages est aussi parsemé de motifs et de drôles d’événements qui confirment que le paysage narratif n’est pas réaliste. Le problème, c’est que les personnages ne semblent pas trouver ces derniers éléments inhabituels comme l’est le choupardier, seul élément fantastique. Le récit déborde d’absurde et se donne un petit air d’écriture à la Boris Vian : des éléments tels que les prothèses-godemichets dernier cri sont le plus grand désir des hommes ; les personnages-animaux tels que le plancton de service, le pingouin en tenue de gala, les cerbères-siffleurs, les cerbères-déblayeurs et les cerbères-flingueurs (ces trois derniers représentent des policiers et des gardes) ont des emplois tout comme les hommes ; les beignes sauvages, des fruits qui poussent naturellement, sont un poison pour l’homme, mais un grand délice pour le choupardier. Aussi, plusieurs événements donnent une touche burlesque au récit, par exemple le vendeur de ballons qui lui-même se dégonfle tel un ballon ; ou encore la maison de Joseph et de son épouse qui s’écrase au bout d’une de leurs violentes bagarres. Ces éléments dignes d’une caricature prennent parfois des allures de métaphores et, d’autres fois, doivent simplement être pris au premier degré.
La dystopie, quant à elle, s’opère en arrière-plan du récit. La situation géopolitique est une dichotomie représentée d’un côté par la Méricie, la zone plus urbaine, et de l’autre côté, la zone rurale et montagneuse, la Troglésie. En Troglésie, les habitants parlent un jargon qui est en fait de l’anglais, langue que les Mériciens ne comprennent supposément pas, puisque c’est la langue du petit peuple qui vit d’ailleurs dans des « trous », des cavernes. On comprend bien vite que pour les Mériciens, les Troglésiens, ce sont les autres, les étrangers, un endroit que les Mériciens n’ont aucun intérêt à visiter et dont le ministre Siméon Lachance ne se vante pas d’être originaire.
C’est probablement une bonne chose pour les Troglésiens, puisque la Méricie semble être un cauchemar bureaucratique. Les noms des comités, des ministères, des événements historiques, entre autres, sont dignes de Huxley et d’Orwell : « la Ligue pour la sauvegarde de la moralité », « la Grande Révolution populaire », « l’Île aux fous », « le Ministère zoologique » et « la Fête nationale ». Le personnage de Joseph et son implication dans les manigances du ministre montrent aussi certains topoï propres à la dystopie. Déjà, le ministre souhaite conserver les « apparences de la démocratie », alors même qu’il dupe et manipule les masses, avec pour excuse l’existence du choupardier. La seule raison de sa présence en Méricie est justement pour faire diversion pendant que le gouvernement fait comme bon lui semble.
Pour empêcher ses citoyens de trop réfléchir, le gouvernement fait aussi de la politique-spectacle. Rien de tel que de donner une allure de sport aux séances du Parlement, lesquelles s’appellent d’ailleurs des « joutes », au point où les députés portent un numéro dans le dos. Dans ces joutes, presque tout est permis, même les attaques physiques. Et les spectateurs ne sont pas en reste de violence puisque pour assister au Parlement, ils doivent d’abord réussir à se faufiler dans la salle sans s’empaler sur les murs chargés d’épées, de lances et d’autres objets contondants. Aussi dangereux que ce soit, les citoyens se prêtent avec ferveur au jeu, bien que les dommages collatéraux soient nombreux.
C’est à croire que seule cette caricature de la politique peut combler la masculinité perdue de tous ces hommes. Étant donné le contexte de montée du féminisme dans lequel le récit de Séguin a été écrit, il est par ailleurs surprenant de ne pas y trouver plus de femmes, surtout que le seul personnage féminin marquant, l’épouse de Joseph, est stéréotypé, sans compter que, dans l’esprit plutôt conservateur du récit, l’auteur utilise son infidélité à Joseph comme un élément péjoratif qui n’a pour seul but que d’intensifier l’échec total de ce dernier. Cela dit, les hommes aussi ont chacun leur côté exécrable, ce que le choupardier remarque et méprise. Par ailleurs, l’émasculation des hommes est accessoire au récit, tout au plus. Il est dommage que, comme d’autres éléments du roman, celui-ci n’aboutisse jamais à une critique en profondeur de la situation politique de la Méricie.
La finale s’étire malheureusement en longueur et tombe un peu à plat. On se demande ce que Séguin souhaitait accomplir : mettre en place un monde dystopique, auquel cas il n’avait pas vraiment de propos clair à ce sujet, ou faire un conte fantastique, une partie qui aurait pu être plus élaborée à travers le regard du choupardier sur les hommes. [SG]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 357-360.
Références
- L'Hérault, Pierre, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec VI, p. 515-516.