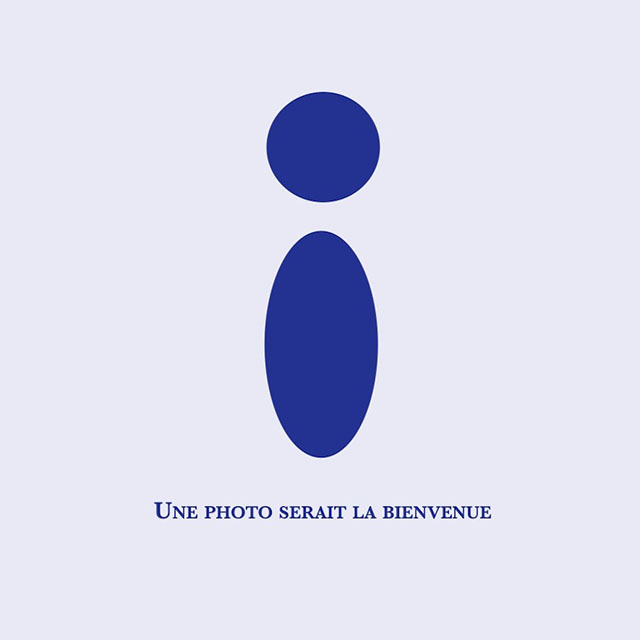À propos de cette édition

Résumé/Sommaire
Hercule range tranquillement livres et paperasse qui encombrent son bureau. Du coin de l’œil, il ne perd pas de vue le grand miroir qui occupe presque tout un mur de la pièce. Soudain, le miroir s’anime.
Tout d’abord, Hercule se voit adolescent, et revit intensément cette époque en se rappelant à quel point il l’a détestée. Au contraire de ses compagnons, les signes de la puberté (barbe, mue de la voix et envies sexuelles) sont pour lui des vecteurs de honte. Les filles de son âge ne l’intéressent pas, car avec elles il devrait jouer le rôle de l’homme qu’il refuse de devenir. Seule une trentenaire, cousine de surcroît, le fait fantasmer. Avec elle, il pourrait rester enfant, petit, soumis.
Mais un événement vient changer la vie d’Hercule et, s’il n’est en rien différent physiquement, un nouvel état de grâce lui permet de fugaces moments d’évasion avec une copine. Ensemble, ils oublient leur laideur et leur souffrance en devenant des personnages de romans.
Commentaires
Cette nouvelle fantastique pourrait fort bien ne pas l’être. En effet, si l’on oubliait le « miroir », on se retrouverait avec une nouvelle réaliste mettant en scène un homme aux prises avec ses souvenirs. Cela étant dit, tout l’intérêt de ce texte réside davantage dans son propos et ses possibilités d’analyse que dans sa filiation ou non à un genre en particulier.
Dans sa nouvelle, Normand Rousseau revisite sans le savoir – le terme n’aurait été utilisé pour la première fois par le psychanalyste Dan Kiley qu’en 1983 – le syndrome de Peter Pan. Malgré un prénom prédestiné à faire de lui un homme fort, Hercule est un adolescent qui refuse de vieillir et voit dans chacune de ses manifestations pubertaires une atteinte à sa liberté d’enfant, une ancre le tirant vers l’âge adulte et les responsabilités idoines. De là, toutes ses relations sociales, mais surtout sensuelles et sexuelles, sont bouleversées. Il ne peut que rêver jouir entre les mains d’une femme plus vieille que lui et incestueuse. À la suite de son improbable victoire à un concours de rhétorique, une nouvelle assurance s’empare de lui et, sans délaisser ses regrets de l’enfance et ses appréhensions d’adulte en devenir, il peut désormais se permettre d’apprécier certains moments – trop courts – durant lesquels il assume son adolescence en compagnie de son amie Fridoline, que l’on devine tout autant qu’Hercule en proie aux questionnements de cet âge ingrat.
Mais outre l’histoire d’Hercule, cet adolescent qui refuse de devenir un homme, ne serait-il pas question dans cette nouvelle de tout un pays qui se refuse de le devenir ? Un passage nous mène sur cette piste d’analyse : « Et comme ils étaient nés dans un drôle de pays, le Québec, il n’y avait pas de châteaux. À la conquête, les Français les avaient emportés dans leur douce France […]. Les Français, civilisateurs du monde, avaient laissé aux Anglais un fleuve, quelques montagnes et beaucoup beaucoup de petits Québécois. » Le qualificatif « petit » a bien entendu une connotation infantilisante. Le Québécois, ainsi fait enfant, a été abandonné par la mère France il y a quelques siècles et, nourri minimalement mais suffisamment par les Anglais qui « s’en arrangent très bien », refuse, comme Hercule, de vieillir et surtout, de subir les épreuves de l’adolescence nationale, du passage à l’âge adulte, au statut de pays.
On l’a dit plus haut, c’est sur sa cousine que portent les fantasmes d’Hercule. Comme lui, le Québécois, même celui aux aspirations nationalistes les plus fortes, peine à se détacher de son besoin d’approbation du peuple français – n’a-t-on pas fait tout un plat de la déclaration de de Gaulle au balcon ? Or, si la France n’est plus perçue ici comme une puissance maternelle depuis la Conquête, les Français ne sont-ils pas toujours nos cousins ?
Dans le cas d’Hercule, ce qui change, quoique pour de courtes périodes seulement, son attitude vis-à-vis la quête de la maturité, c’est la victoire au concours de rhétorique. La nouvelle ayant été publiée en 1976, quelques mois seulement avant la première élection d’un gouvernement souverainiste à la tête du Québec, difficile de ne pas faire de parallèle et de ne pas voir là une prévision pré-électorale de la part de l’auteur. Et si, dans le grand saut final dans le miroir qui conclut la nouvelle de Rousseau, ce dernier n’avait pas prophétisé, malgré le vent d’optimisme poussant les velléités indépendantistes québécoises, la défaite au référendum de 1980, misant sur la puissance de ce fameux syndrome de Peter Pan, de cet enfant/pays qui ne veut pas s’affranchir ? À moins que l’on choisisse de voir, au contraire, dans ce pas en avant, une acceptation du passé et une accession à la maturité, considérant que pour Hercule, ce n’est visiblement pas la première fois qu’il vit cette aventure, mais que jamais avant il n’était entré dans ce miroir magique. Voilà une des puisssances de la littérature, celle de souvent laisser aux lecteurs les choix définitifs.
Bref, nous voici donc ici devant un texte aux apparences banales mais qui, à la deuxième, voire à la troisième (et plus !) lecture, pousse le lecteur à aller plus loin, à se poser plus de questions sur lui-même, ses compatriotes et sa nation. [PT]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 345-347.