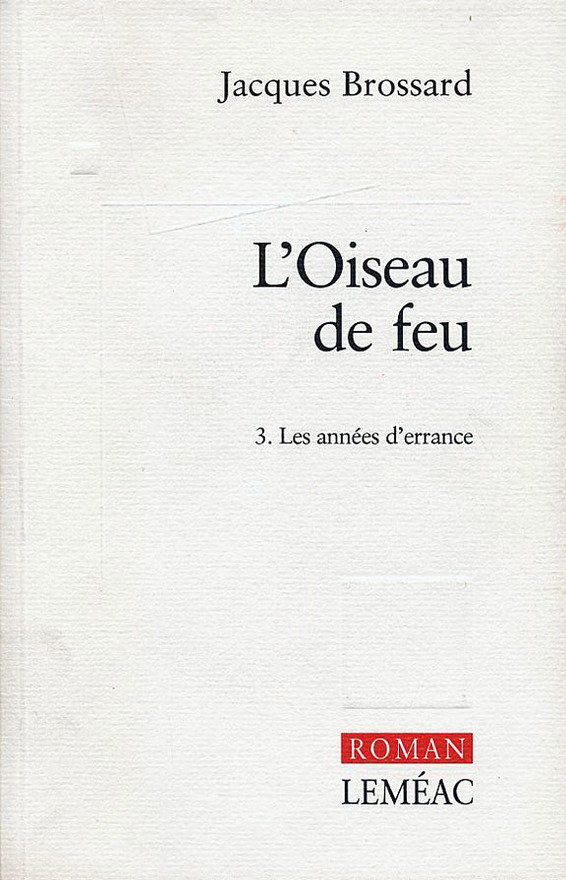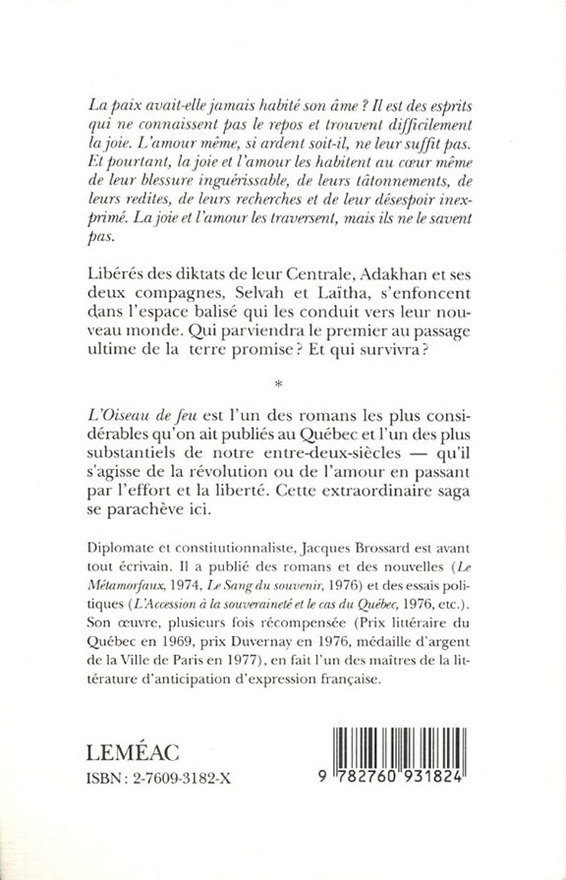À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
Alors que la Tour vient d’exploser et que Manokhsor est englouti par un gigantesque cataclysme, l’Oiseau de feu, ayant à son bord Adakhan, Selvah, Nyhrsangh, Viviane, Mawa et Laïtha, s’élève au-dessus de l’enfer pour se placer en orbite. Aucun des passagers n’a de contrôle sur les éléments du vaisseau et son plan de vol ; le cœur de l’Oiseau de feu, un ordinateur nommé Fantine, prend charge de tout, même de l’ouverture et de la fermeture des volets, les empêchant (sans raison ?) d’observer l’ensemble de la planète. Seul Adakhan verra la merveilleuse île située aux antipodes qu’ils ont visitée pendant les simulations, et il concevra de cette vision une grande amertume, croyant qu’il s’est fait berner de nouveau. Puis la poussée débute, les derniers étages de la fusée sont largués et l’Aigle d’Or, partie habitée du vaisseau, entame son long voyage vers Ashmev.
La traversée est ponctuée d’un « saut » de nature indéterminée – dérive quantique, renversement des ondes de probabilité, plis de l’espace-temps, transmission psi ? – qui a pour conséquence de réduire/amalgamer les six occupants du vaisseau en trois voyageurs – Adakhan, Selvah et Laïtha – à leur arrivée dans un nouveau système solaire. L’Aigle d’Or croise d’ailleurs plusieurs planètes avant de les mener à leur destination, la planète Ashmev où ils atterrissent sur une île.
Leur terre d’accueil est formidablement accueillante. Faune et flore s’offrent littéralement à eux et c’est dans une plénitude extrême que s’écoule le début de leur nouvelle existence. Qui plus est, ils ont développé, depuis l’atterrissage, un remarquable pouvoir d’osmose qui les unit jusqu’en pensée. C’est à cette époque que naît leur premier fils, Abhül, fils de Selvah, alors que l’Oiseau de feu, envahi par la végétation, se transforme progressivement en une sorte d’arbre qu’ils vénèrent. Adakhan, malgré le bonheur qui le submerge, a toujours en lui ce besoin d’explorer et il parcourt l’île afin de trouver un passage menant au continent aperçu lors de l’atterrissage et qui, il ne sait pourquoi, l’attire comme un aimant. Au cours d’un de ses voyages exploratoires, il rencontre Pégase, un cheval qui le mène enfin jusqu’à l’océan au-delà duquel s’étend possiblement la terre promise. Car Adakhan sait qu’il leur faut quitter cette île enchantée, qu’elle n’est pas l’objectif ultime de sa quête, mais une simple épreuve de plus à surmonter.
Au moment où ils traversent le détroit sur un radeau, une inconcevable tempête s’élève, rejetant à l’eau la totalité de leurs possessions – dont leur réserve d’aghératol, la drogue décuplant leur longévité – et détruisant, dans une gigantesque éruption volcanique, l’île qu’ils viennent de quitter. Nus, sans ressources, ils doivent survivre dans leur nouvel environnement. Mais ce dernier est beaucoup moins accueillant, voire hostile. S’organise alors une existence qui, devant leur dénuement complet, les ramène à un mode de vie quasi préhistorique. C’est à cette époque que Laïtha mourra en donnant naissance à une fille, Sed, alors que Selvah donnera la vie à un deuxième fils, Khan.
Au fil des ans, la famille poursuit une longue errance, au gré de l’idée fixe d’Adakhan, toujours à la recherche de sa fameuse terre promise. En chemin, ils construisent des campements, qu’ils désertent sitôt la chasse moins bonne. Les enfants grandissent, développant chacun des caractéristiques bien différentes – Abhül est plus intériorisé, plus mystique, Khan montre une grande violence intérieure ; quant à Sed, c’est la future mère de l’Humanité à venir.
Sed enfantera neuf fois, puis ses enfants auront à leur tour une nombreuse progéniture, de telle sorte que la minuscule famille deviendra bientôt un clan, puis plusieurs clans sous le regard de plus en plus lointain d’un Adakhan vieillissant. Malgré ses forces chancelantes, ce dernier cherche toujours à atteindre la contrée dont il rêve. Lors d’une ultime exploration solitaire, il la trouvera enfin, mais il trouvera la mort avant d’y poser le pied. La fin du patriarche signera une étape dans l’histoire des descendants d’Adakhan, qui continueront à se multiplier afin de devenir la nouvelle Humanité, mais cela est une autre histoire – ou peut-être est-ce la même ?
Autres parutions
Commentaires
Huit ans après la publication de son premier volet, voici enfin que nous est proposé le cinquième et dernier volume du cycle de L’Oiseau de feu de Jacques Brossard. En tout, ce gigantesque roman comprend donc plus de 2500 pages d’une richesse et d’une densité qui, sans l’ombre d’un doute, en fait l’une des œuvres les plus puissantes que la littérature québécoise, tout genre confondu, nous ait donnée depuis son éclosion.
Débutant avec l’envol de l’Oiseau de feu alors que Manokhsor et la Centrale sont détruits par un gigantesque cataclysme, les Années d’errance, qui relate les trois dernières « journées » de la grande aventure d’Adakhan, est ni plus ni moins que l’aboutissement logique de la difficile quête initiatique du héros principal, le départ définitif vers un nouveau monde, départ qui prend des allures de nouvelle naissance.
Car sur cette symbolique, l’auteur ne peut être plus clair : le nom de la fusée appelle l’idée du recommencement et de la renaissance associée au phénix, le cataclysme dévastateur mime les affres de l’accouchement alors que les voyageurs entament leur périple couverts d’une boue rouge qui imite le placenta qui barbouille les bébés naissants, le trajet – pendant lequel ils ne contrôlent rien – les propulse d’un milieu fermé et protégé vers un nouvel environnement ouvert où, après une période de rémission, ils devront faire face à l’adversité, etc.
Et l’auteur ne s’arrête pas là dans les analogies : sur la nouvelle Terre, l’identification de l’île au Paradis terrestre devient elle aussi évidente, tout comme celle de l’Oiseau de feu, réceptacle de l’ancien savoir, à l’Arbre de la connaissance. Le même parallélisme se produit avec la vie de la famille d’Adakhan qui, au fil des générations, rappelle beaucoup les débuts de la genèse.
Au fur et à mesure de la lecture de ce dernier volet, le projet d’ensemble de Brossard se dévoile dans toute son ampleur : L’Oiseau de feu, c’est ni plus ni moins que la chronique du passé perdu de l’Humanité, une tentative d’explication – rationalisée bien que remarquablement lyrique – à toutes nos légendes et à toutes nos différences, à tous nos maux et à tous nos espoirs…
L’esthétique littéraire privilégiée par Brossard depuis le tout début de sa chronique s’apparente à celle utilisée par des auteurs de la première demie de ce siècle comme Jünger ou Hesse – auteurs d’ailleurs abondamment cités dans les exergues qui précèdent chaque “journée”. Ce choix est d’autant plus saisissant que l’imagerie SF proposée, elle aussi, rappelle beaucoup celles qui tenaient le haut du pavé à la même époque.
Ces décalages dans le “fond” et la “forme” sont-ils volontaires ? À vrai dire, cela importe peu au regard de la qualité de l’œuvre, bien qu’il soit normal de croire que Brossard se soit appuyé davantage sur une tradition, lorsqu’il a été temps de rédiger cette chronique, que sur les nouveautés venues enrichir le corpus littéraire de la science-fiction mondiale des dernières décennies. Par contre, ces choix pourraient nettement influencer le plaisir de lecture d’un lecteur “non averti” de la fin de la dernière décennie du vingtième siècle !
Car s’il fallait se mettre en tête de comparer L’Oiseau de feu à un quelconque autre monumental cycle récent – par exemple celui de Mars, de Kim Stanley Robinson, ou celui de Tyranaël, d’Élisabeth Vonarburg – on pourrait faire valoir l’archaïsme des éléments technologiques provenant de la Centrale qui, il faut bien l’avouer, apparaissent issus d’une époque bien antérieure à la nôtre (mais n’est-ce pas le cas ?). Quelques exemples : les portes de l’Oiseau de feu s’ouvrent grâce à de grandes roues de métal, les hublots de la fusée sont munis de volets, l’ordinateur de bord se présente comme des blocs de lumière pulsante, etc. Peut-on alors affirmer que Jacques Brossard et son Oiseau de feu sont en retard de quelques décennies ? Aucunement ! Et je veux pour preuve que cette esthétique rétro est un choix volontaire – comme celui soutenu dans Dune, l’adaptation cinématographique de David Lynch où les décors s’inspirent directement de la fin du XIXe siècle – et non une méconnaissance des courants modernes, deux éléments : tout d’abord l’utilisation à bon escient par l’auteur des hypothèses les plus hardies de la science actuelle, démontrant qu’il n’est pas coupé de la modernité, et le discours magistral sur ce qu’est pour lui la SF qu’il nous sert dans un Après-propos dont je reparlerai plus loin.
Quoi qu’il en soit, ce visuel rétro disparaît très tôt dans ce dernier volume alors qu’Adakhan, Selvah, Laïtha et Abhül abordent le continent. À partir de ce moment, nous avons droit à un roman de la préhistoire – notre préhistoire ? – et la quête d’Adakhan cède la place à une autre, celle de l’Humanité en devenir qui, pour un jour retrouver l’exaltation du Paradis terrestre perdu, devra survivre et se multiplier au cours des millénaires.
Par ailleurs, on ne peut passer sous silence la structure extrêmement complexe de cette chronique qui, dès le premier volume, annonçait une œuvre ambitieuse à tous les points de vue. Après la lecture de cette saga divisée en douze journées et quarante-six chapitres, on constate que l’auteur n’avait rien laissé au hasard, l’Épilogue répondant au Prologue du premier livre afin d’assurer la circularité parfaite de l’histoire, les Notes des traducteurs successifs – dont Brossard – expliquant certaines particularités du texte, la Postface de l’éditeur du XXXe siècle ajoutant encore des explications – du mythe ? – quant aux lieux probables d’arrivée de l’Oiseau de feu sur la Terre et à l’époque présumée de cette arrivée, cet Après-propos de Brossard qui complexifie toujours plus les niveaux d’imbrication fiction/réalité en réinterprétant certaines données du roman et en les incorporant au propre mythe de la famille de l’auteur, une Finale de l’éditeur réel, Pierre Filion…
En parlant de l’Après-propos, je voulais y revenir car c’est là que Jacques Brossard explique la forme de L’Oiseau de feu, qui vient de l’hybridation de deux genres qu’il apprécie par-dessus tout, le roman initiatique de tradition germanique et/ou romantique et la science-fiction littéraire reliée au sociopolitique. Quelques paragraphes plus loin, il remercie trois critiques littéraires de la SFQ qui ont chaudement défendu son projet – au nombre desquels figure le collègue Claude Janelle – avant d’entamer une charge héroïque contre les « … gestionnaires, paresseux mentaux, peureux, bornés et autres sclérosés de l’ordre littéraire établi que l’étiquette “SF” fait encore se fermer hermétiquement… », genre qu’il avait qualifié plus tôt de « … une des deux formes contemporaines de la littérature ».
En terminant, parlons de deux éléments structuraux qui ne sont pas mentionnés (volontairement ?) ni dans le Plan de la chronique, ni dans la Table des matières. Ils sont insérés entre le dernier chapitre et l’épilogue.
Le premier, intitulé la Terre, comporte, outre les exergues, un seul paragraphe, dû au troisième traducteur – Brossard, donc. Je vous le livre dans son intégralité tant il “ouvre” la fin de la chronique : « Lecteur, patient lecteur, c’est à toi d’imaginer la suite de cette chronique inachevée à la lumière de tes désirs, de tes peurs, de tes secrets, de tes souvenirs, de tes expériences, de tes croyances, de ton savoir et du temps qui passe. À la lumière ou à leur ombre. Tu pourras ensuite passer à l’épilogue. »
Or, lorsque le lecteur tourne la page, il tombe sur le deuxième élément non répertorié, une Annexe où, écrit en caractères plus petits que le texte courant, un extrait de dialogue fait basculer toutes les notions reçues jusque-là par le lecteur auquel le troisième traducteur vient de s’adresser en faisant surgir les questions suivantes : Qui sont ces “programmeurs” qui parlent de l’histoire d’Adakhan comme s’il s’agissait d’une énième variante d’un éternel recommencement ? Sous les initiales VH et FR5 qui les identifient, s’agit-il des personnages de la Centrale que le lecteur a connus dans les volumes précédents, ou ces derniers n’étaient-ils que la projection fantasmée de ces “programmeurs” ? Et qui diable est le Grand Programmeur ?
Deux éléments escamotés, quatre petites pages, et voici que plus de deux mille pages d’histoire prennent une tout autre signification ! Avons-nous eu droit à la réalité ou à une simulation ? Dernier élément qui parachève l’ébranlement des certitudes, de “toutes” les certitudes, l’épilogue, qui enchaîne tout de suite après en reprenant, presque mot à mot, le prologue où Adakhan, alors âgé de sept ans, partait à la découverte du désert entourant Manokhsor, mais où le personnage principal est devenu une petite fille…
Alors, Adakhan qui, depuis le départ de l’Oiseau de feu, s’interrogeait sur la réalité de son expérience, n’avait-il pas raison de le faire ? N’était-il pas plutôt à la Centrale, perdu à l’intérieur d’une simulation de la centrifugeuse ?
C’est sur la réalité même de notre univers – et la nôtre ! – que Brossard nous laisse en dernier lieu, comme s’il voulait nous rappeler que, tout comme Adakhan, nous sommes de simples pions sur un échiquier dont nous n’arrivons même pas à imaginer l’ampleur. Et s’il avait raison ?
Un grand livre, qui ne saura être comparé à nul autre tant il est dans une classe à part ! [JPw]
- Source : L'ASFFQ 1997, Alire, p. 43-47.
Références
- Voisine, Guillaume, Brins d'éternité 47, p. 121-123.