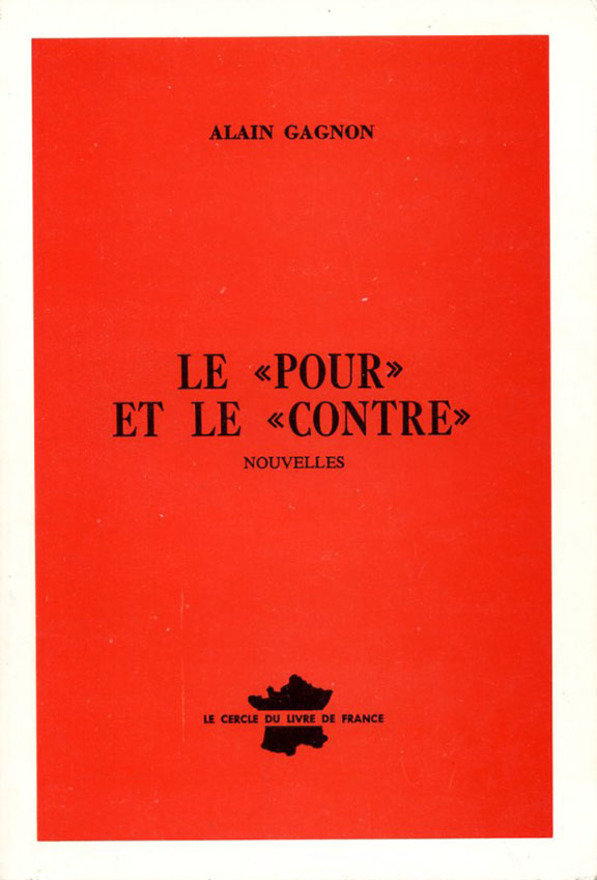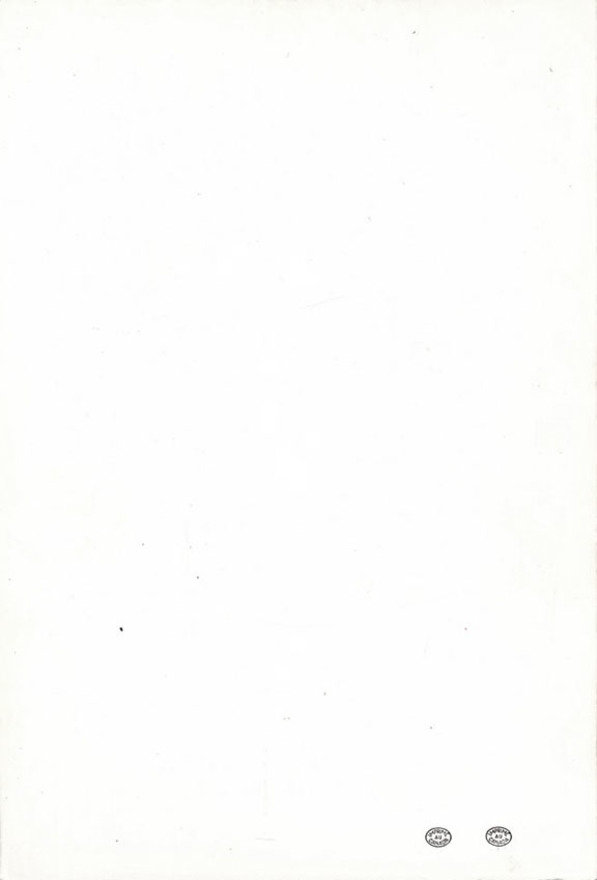À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
[5 FA ; 2 SF ; 6 HG]
Le « Pour » et le « contre »
La Mort du coordonnateur général
Lettre au Procureur
Sur L'Ashuapmouchouan
Entre deux bilans
Le Parfum des abîmes
De pantins en pantins
Journal d'un ambassadeur
Deux et deux font quatre
Le Vieux Nil
L'Égyptienne
Un voyageur dans le désert
Kim et Nathalie
Commentaires
Alain Gagnon est un écrivain régionaliste qui a publié plusieurs recueils de nouvelles et romans depuis 1970. Il a remporté une flopée de prix régionaux mais sa réputation littéraire ne dépasse guère sa région d’origine, le Lac-Saint-Jean, à laquelle il est visiblement attaché. Ses écrits contiennent de nombreuses pages qui en décrivent la beauté des paysages et de la nature. La nouvelle « Sur l’Ashuapmouchouan » qui fait partie du recueil Le « Pour » et le « contre » en fournit un bel exemple.
On reconnaît dans ce premier livre d’Alain Gagnon différentes influences littéraires : Ringuet dans la nouvelle « Le Vieux Nil » qui rappelle le thème de la transmission de la terre paternelle au cœur de Trente arpents, Roch Carrier dans « Un voyageur dans le désert », fable philosophique qui ne détonnerait pas dans Jolis Deuils. Plusieurs nouvelles suscitent peu d’intérêt tant le sujet apparaît anecdotique. L’auteur fait néanmoins preuve d’une certaine audace dans le dernier texte en mettant en scène l’amorce d’une relation saphique (« Kim et Nathalie ») dont la promesse d’avenir tranche avec le ton plutôt désenchanté du recueil.
La nouvelle éponyme est représentative du climat qui englue l’existence des différents protagonistes. Dans cette nouvelle réaliste, le narrateur fait le compte des « pour » et des « contre » pour déterminer si la vie vaut la peine d’être vécue. L’existence est réduite à une opération comptable, à une notion de rendement comme si la vie était un capital qui doit rapporter. Cette idée empoisonne le quotidien des personnages au point qu’ils éprouvent un sentiment de médiocrité, une frustration continuelle et une insatisfaction généralisée. Le recueil est le théâtre d’un affrontement entre la vie et la mort. Cette dernière l’emporte le plus souvent mais la mort n’est pas toujours synonyme d’échec. Pour le vieux Nil qui a ourdi un plan pour que son fils et sa bru meurent dans un accident, la mort constitue un moyen légitime à ses yeux de protéger l’héritage de la terre qu’il a cédé inconsidérément à son fils, au même titre que le fait de tuer des loups peut s’avérer nécessaire pour sauver un troupeau de brebis.
Le « Pour » et le « contre » contient treize nouvelles mais sept seulement relèvent des genres de l’imaginaire. J’inclus la nouvelle « Lettre au procureur » dans le corpus SF malgré le fait que la date de la lettre (6 février 2008) n’a aucune incidence sur le récit des événements ni même le fait que le Québec soit devenu une république. Quant aux nouvelles fantastiques, elles ne brillent pas, c’est le moins qu’on puisse dire, par leur originalité. « La Mort du coordonnateur général », en répétant à l’infini la substitution du despote par son homme de main, tourne court à toute discussion philosophique sur la responsabilité de chacun dans le maintien d’un régime totalitaire.
« De pantins en pantins », courte satire sur la mécanisation du travail et sur l’absence de tout contrôle sur nos vies, ne renouvelle pas le cliché du manipulateur de marionnettes lui-même manipulé. Par qui ? C’est bien là le plus absurde : l’homme n’a aucune prise sur son destin et Dieu est mort ou absent.
En fait, le texte le plus intéressant du recueil est « Deux et deux font quatre ». Si la prémisse est fantastique, elle ne constitue qu’un écrin pour mettre en valeur une société utopique basée sur l’égalitarisme. Les principes soutenus par les concepteurs de la ville modèle sont fort louables : répartition équitable des tâches domestiques entre l’homme et la femme, architecture uniformisée, biens matériels identiques et équitablement répartis. Le couple choisi pour tester ce modèle, sorte d’Adam et Ève du jardin d’Éden égalitaire, fait face bientôt à une réalité que les idéalistes avaient oubliée : la nature n’a que faire de l’égalité. Aussi quand l’homme se rend compte que sa femme est enceinte, il comprend que le concept d’égalité a ses limites et il ne peut supporter cette réalité.
La cité d’« Égalité-Ville » abandonnée témoigne de l’échec de l’utopie. Mais plus que l’échec de l’égalité entre les citoyens, c’est peut-être davantage le féminisme qui commence à agiter la société québécoise de l’époque qui est remis en question. Réactionnaire ou lucide, cette nouvelle d’Alain Gagnon ? À moins qu’elle ne démontre l’incapacité de l’auteur, qui n’est pas un écrivain de SF, à conjecturer un futur où la possibilité pour un homme d’enfanter ne serait plus uniquement un fantasme. Quoi qu’il en soit, elle suscite une réflexion féconde, ce dont sont dépourvues la plupart des autres nouvelles, à l’exception notable de celle qui clôt le recueil et qui suscite l’espoir d’une relation lesbienne assumée et heureuse. [CJ]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 205-208.
Références
- Boivin, Aurélien, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec V, p. 715-717.