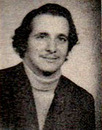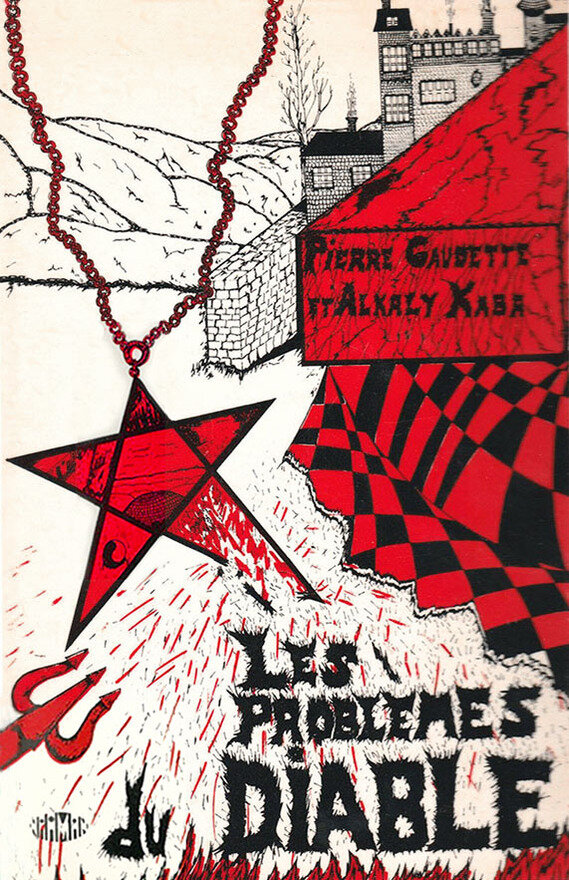Résumé/Sommaire
Edgard Halton, écrivain relativement jeune et déjà retraité, vivant dans un manoir au cœur des bois, est visité par un cauchemar extrêmement précis, au sortir duquel il est attaqué par un monstrueux inconnu – ou un monstre – à la fenêtre de son salon. Son collaborateur, Rodrigue Wildub, vient s’installer chez lui pour le rassurer, et ils chassent ensemble le lion des montagnes dans les environs. Lors d’une excursion, après avoir découvert un cultivateur massacré dans une maison de ferme, ils trouvent dressé sur leur chemin un homme qui porte des éléments de costume africain et arbore des mains griffues, explicitement reliées par la narration à de récents faits divers sanglants et à l’agression subie une nuit par Halton. Wildub est tué de manière expéditive par ce monstre – ou ce diable. L’écrivain s’enfuit à bord d’une jeep trouvée et s’égare dans le désert où la créature (sous diverses désignations) surgit plus d’une fois, pour finalement le tuer en lui broyant les os.
Dans une seconde partie, le récit se poursuit avec un autre homme. Dix ans ont passé et ce Hans Lewis est celui qui a ramené du désert le corps de Halton – par ailleurs son ami d’enfance, brièvement évoqué dans la première partie. Il descend à l’hôtel de Southdale, se promène dans la ville, le soir, et se retrouve en présence du diable aux griffes affilées – rencontre sans conséquence, d’ailleurs. Le lendemain, il accepte d’accompagner un inconnu vers un guet-apens, lieu d’une cérémonie maléfique standard, que Hans quittera avec autant d’insouciance qu’il y est allé – non sans écrabouiller quelques sbires au passage, car il est invincible.
Trois brefs chapitres finaux mettent en scène quelque chose comme une discussion entre le diable et ce Hans désinvolte, surnaturel lui aussi. La Terre, qui tourne en rond comme la conversation finale, est évoquée dans les mots ultimes. Ce perpétuel affrontement, divin à défaut d’être cosmique, serait le moteur du monde.
Commentaires
Écrit en collaboration avec Alkaly Kaba.
Dès la deuxième page, une alarme sonne. À moins de motivations narratologiques (nullement en cause ici), on s’efforce généralement à s’en tenir à un même temps de narration : le présent de l’indicatif, ou les temps du passé, mais pas les deux, et surtout pas dans le même paragraphe, ou pire, dans la même phrase. Au fil de la lecture, l’alarme ne cessera guère de sonner, stridente ou diffuse, entrecoupée à l’occasion par un gloussement du lecteur, ou carrément un rire.
Autre particularité : l’intrusion occasionnelle du nous, comme dans « nous admettons », « ce que nous avons l’habitude de voir » ou « nous avions alors appris que ». Tout se passe comme s’il existait du même récit une version narrée au « je » ou au « nous », et que l’auteur passait à celle-ci par inadvertance, pour revenir aussitôt à la narration en « il ». Je parle de l’auteur au singulier car, en dépit de la coécriture brièvement expliquée en quatrième de couverture, rien dans le « style » ne trahit l’écriture à quatre mains. On en voit plutôt les effets – désastreux – dans la complète anarchie qui a présidé à l’élaboration de l’intrigue. J’évite ici le mot « construction », mais « assemblage » s’appliquerait, à la rigueur.
Là comme sur d’autres aspects, l’absence d’une direction littéraire se fait douloureusement sentir. Un regard critique a manqué, qui aurait pu relever diverses petites contradictions, « oui mais au paragraphe précédent vous écriviez que… », « mais qu’est-il advenu des épouses ? », etc. On hésite à citer des exemples de maladresse, car des dizaines d’autres leur envieraient d’être mises en évidence. Citons quand même « Les épaules larges étaient rondes, délaissées de toute carrure » (p. 66).
Certaines perles méritent quand même d’être mises en lumière, ne soyons pas avare. « Il valait donc mieux… s’en tenir au doute, à la croisée de deux chemins : le réel et l’irréel, mais avec un parallèle le plaçant… juste au milieu » (p. 52). « Elle ressemblait à une scène biblique vue au travers d’un visage translucide contorsionné par la rage » (p. 72). « Le tout semblait avoir été solidifié dans un immense moule planétarien » (p. 80). Perles mises à part, certains passages forcent le regard à revenir en arrière, à relire plus attentivement… en vain. « Mais de quoi parlent-ils, au juste ? » On veut bien croire que les auteurs avaient là une idée (peut-être même pas compliquée), mais ils ont échoué à l’énoncer clairement. On soupçonne que, pour eux, tel passage ou telle observation sont… profonds, pénétrants, sentencieux ; mais que les mots pour le dire ne leur venaient pas – ni à leur éditeur, hélas.
C’est peu dire que les auteurs n’avaient pas une vision claire de ce qu’ils racontaient. Outre l’usage aléatoire de mesures impériales ou métriques (deux mille pieds, deux milles, « environ cent trente mètres devant lui », p. 75), citons un flou géographique absolu. La forêt et la toponymie anglophone évoquent l’Estrie ou la Nouvelle-Angleterre mais, à une vingtaine de milles du manoir, et à un jet de pierre d’une ferme, s’étend le désert de Southdale, un désert avec dunes de sable, soleil accablant, mirages et trajet en Jeep.
Quant à la créature antagoniste, elle incarne tout et n’importe quoi. Je ne serais pas surpris s’il s’avérait – mais on ne le saura jamais – que le titre a été trouvé en dernier, et que les auteurs ne l’avaient pas en tête lorsqu’ils mettaient en scène l’adversaire de Halton et Wildub.
Voici la description, dans le cauchemar initial, d’une « idole pharaonique […] Centaure de deux mètres de haut […] la figure de la statue était vampirique. Sur la tête, deux énormes cornes de bouc » (p. 19). Cette vision peut être, ou pas, un présage de ce qu’affronteront les protagonistes : un forcené costumé aux instincts meurtriers, une bête analogue à un fauve, un « monstre » aux multiples apparences mais à forme grossièrement humaine, un spectre, un démon au sens strict, puis son équivalent dans un paganisme vaguement africain, et finalement le Diable en personne, en tant qu’adversaire d’un envoyé divin (peut-être un ange ?). Quoique aucun de ces attributs ne soit incompatible avec d’autres, le lecteur avisé perçoit bien que l’idée de Gaudette et Kaba n’était pas faite. Je surestimerais les auteurs si je supposais que l’adjectif « protéiforme » leur était connu.
Le livre est agrémenté d’une couverture et d’une vingtaine d’illustrations au trait d’encre, signées Pierre Gaudette ; nous les qualifierons gentiment de juvéniles. [DS]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 213-215.