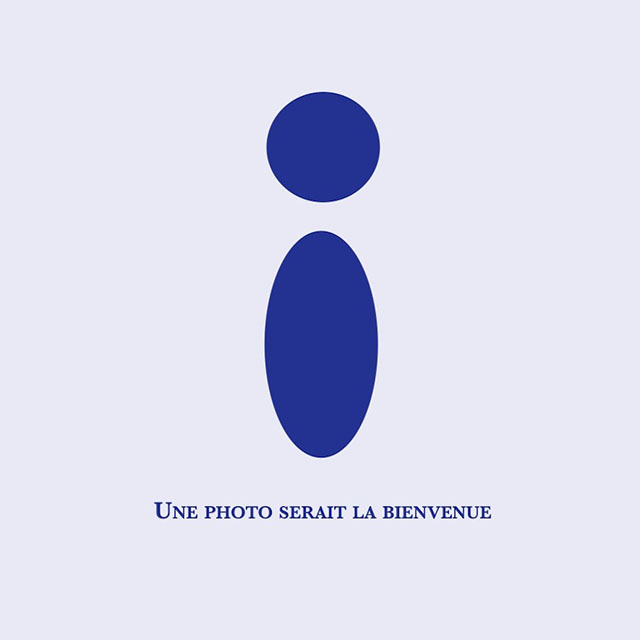À propos de cette édition

Résumé/Sommaire
Devant un jury dont le narrateur fait partie, l’accusé est livré à un instrument (d’interrogation, de torture, autant que d’exécution) en forme de coupole munie d’un laser et d’autres appareils qui le sondent impitoyablement.
Voici qu’entre le prochain et ultime accusé. La machine ne lit rien en lui, proprement insondable. Qu’à cela ne tienne, il est prolixe, verbeux et démonstratif. Selon ce qu’on croit comprendre successivement, ce personnage protéiforme est (ou a été) l’exterminateur de l’humanité entière par le moyen de toutes les maladies imaginables – dont la peste, qui a droit à sa propre digression – , un manipulateur de l’Histoire, tombeur de civilisations, un hypnotiseur de foules ou d’armées capable de provoquer des massacres – deuxième digression : le bunker d’Hitler à l’instant des suicides –, un démiurge omniprésent détenteur d’armes nucléaires et de vaisseaux spatiaux avec lesquels il annihilera ce reste d’humanité qui a l’outrecuidance de le faire comparaître. Sa dernière transformation est en figure christique, stigmates inclus, et le narrateur tend la main pour toucher la blessure rouge dans sa paume.
Commentaires
« Le Procès ultime » se termine sur une évocation du jugement dernier et sur un retournement narratif. La finale n’est pas un revirement de situation, mais un retournement évoquant celui d’un gant, dont l’intérieur serait plus petit que son extérieur, et beaucoup plus terne que ses atours déployés sur trois cents lignes. La référence la plus juste serait peut-être celle d’un château de cartes, qui aurait été édifié avec des dizaines de jolis valets, de belles dames et de superbes rois mais qui, une fois effondré dans le dernier paragraphe, n’aurait laissé qu’une modeste pile de cartes basses.
Chargée d’images fortes, la nouvelle de Clodomir Sauvé propose une lecture à dictionnaire obligatoire. L’auteur y démontre un faible pour les adjectifs en -oïde, existants ou inventés, et pour les nombreux synonymes de « transparent ». En deux pages et deux paragraphes, le lecteur de Requiem apprendra (s’il est studieux) des mots comme butome, chanci, cœlentéré, flavescent, hyalin, lampyre, micacé, pandanus, pellucide, phlox, phlyctène, safre, sagou, smalt, térébrant ou vouge.
Le quart de ce déploiement lexical sert à la description des multiples avatars du tout-puissant accusé. Fonctionnant beaucoup par analogies, Sauvé remplace parfois « comme » ou « tel » par la formule « dans le genre ».
L’auteur du « Procès ultime » déploie un style qu’on pourrait qualifier d’excessif : très imagé, constamment dans le registre de la surtension. Pensons à un film dont les couleurs seraient saturées, criardes, projetées par un appareil survolté dont l’ampoule brillerait à une trop forte intensité, au point de fatiguer les yeux et d’inviter la migraine. Si l’on transpose cette analogie au plan littéraire, on a une idée de l’approche de l’auteur. Au plan diégétique, pour rester dans le même registre, le film serait un peu confus ; on serait tenté d’en blâmer le scénariste, le cinéaste et le monteur, sans trop savoir comment répartir les reproches. Reproches qui auraient réjoui Clodomir Sauvé car, à l’évidence (et en évoquant mon souvenir du personnage), il n’écrivait pas pour être facilement compris, ni même compris tout court.
En somme, un jeune écrivain indéniablement doué pour la métaphore, ayant de vastes connaissances lexicales (ou une infinie patience pour l’exploitation du dictionnaire), avançant tel un équilibriste sur la fine ligne entre talent et prétention. [DS]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 355-356.