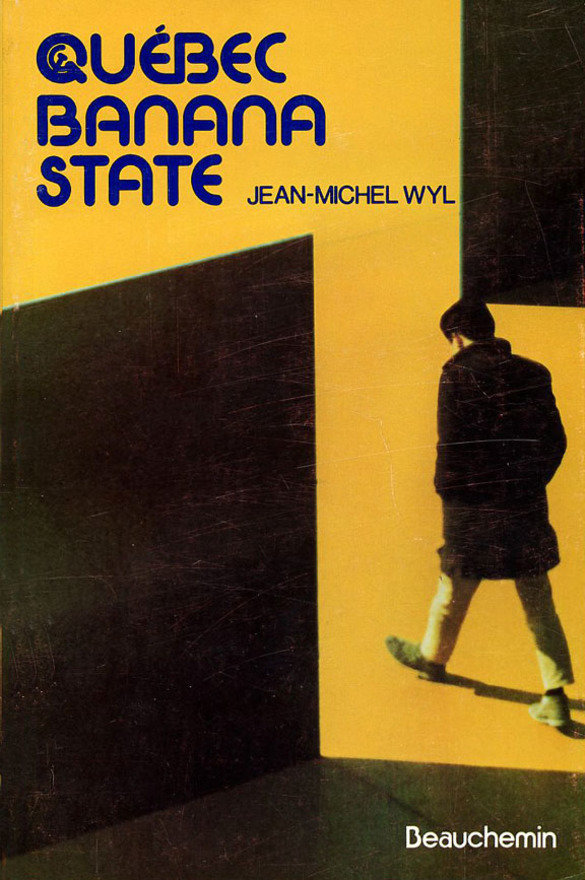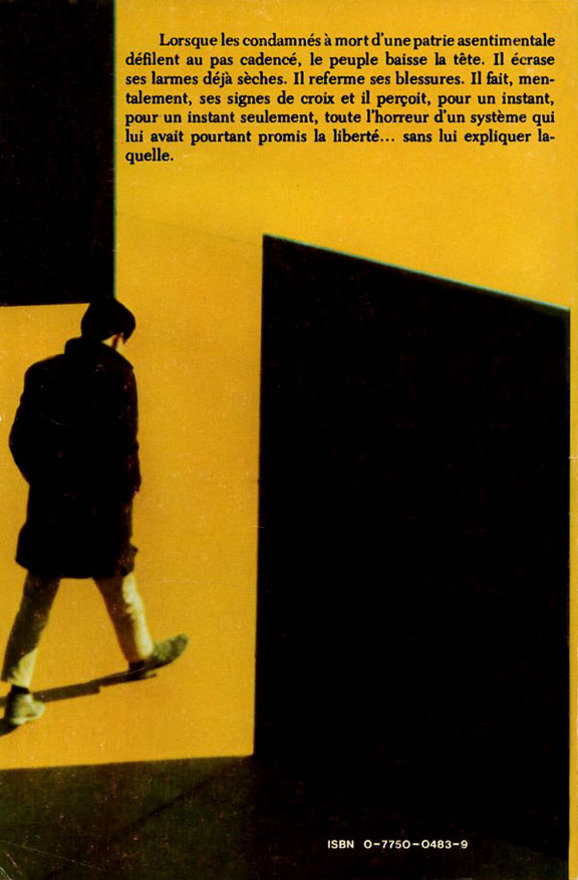À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
Un dimanche 24 juin, le Québec est envahi et occupé par une force expéditionnaire franco-soviétique arrivée dans les vaisseaux d’une puissante escadre. (La France a basculé dans le camp communiste deux ans auparavant.) La province acquiert ainsi son indépendance, sous tutelle soviétique. Les envahisseurs, après avoir assassiné le premier ministre René Lévesque, portent au pouvoir un ancien felquiste réfugié à Moscou qui instaure le règne de la terreur pour consolider l’emprise communiste sur la population québécoise. Des journaux sont fermés d’office et de nombreux livres systématiquement brûlés. Camps de travail, camps de concentration, hôpitaux psychiatriques axés sur la rééducation, exécutions sommaires et fosses communes font désormais partie du quotidien. Des mesures d’euthanasie éliminent les handicapés.
Les Québécois reçoivent du régime une cote de survivance, qui varie en fonction de leurs faits et gestes. La propagande du régime fleurit sur les murs et les établissements religieux sont saccagés. Une nouvelle monnaie, le québec, remplace le dollar canadien. Les frontières sont cadenassées, mais l’espérance de visas illusoires fait vivre ceux et celles qui souhaiteraient émigrer puisque la situation économique n’est pas rose : inflation galopante, rationnement des soins médicaux, coupures des services…
S’il y a des résistants, tels l’ancien écrivain qui a choisi Orgueil comme nom de guerre et un journaliste baptisé Éloi de Mingan, ils sont rapidement rattrapés par la surveillance policière du nouveau régime. Même libres, ils restent assujettis à une censure oppressive. Orgueil finit exécuté tandis qu’Éloi de Mingan se suicide douze ans après l’invasion.
Les premiers soulèvements populaires sont écrasés par les troupes et les survivants remplissent les camps. Il y a aussi des victimes, comme cet homme surnommé Fou-la-Valise qui subit un traitement psychiatrique mais déraisonne surtout parce que sa femme a été assassinée sous ses yeux durant son arrestation. Protégé par le Numéro-Un du régime, Fou-la-Valise sera pourtant celui qui abat ce dictateur dont il était le frère.
Pendant ce temps, au Camp 28, un forçat a construit une goélette miniature, symbole de liberté et d’évasion, mais elle sera enterrée avec lui.
Commentaires
Ce roman de politique-fiction est sans aucun doute un des meilleurs livres de la décennie dans les genres de l’imaginaire. Wyl signe des pages prenantes sur la vie de détenu, sur les techniques de l’écrasement psychologique des opposants et sur les mécanismes de l’oppression totalitaire. Sur un mode plus adulte, il n’est pas sans faire écho à la trilogie Compagnon du soleil de Monique Corriveau.
Le scénario s’inscrit quelque part entre l’invasion prussienne uchronique de Similia Similibus et la mainmise fasciste dans la trilogie Saisons de Pierre Gélinas. Toutefois, Wyl échoue à nous convaincre de sa possibilité. Même avec une France devenue communiste, une invasion soviétique du Canada aurait provoqué une riposte de l’OTAN ou son effondrement immédiat. Que des escadres hostiles aient pu entrer dans le golfe du Saint-Laurent sans être remarquées suscite également l’incrédulité.
L’intervention soviétique peut rappeler le complot communiste dans Crescent Street (1984) de Ron Jasper ou la collaboration d’un Québec indépendant avec l’URSS dans le roman Chronoreg (1992) de Daniel Sernine. S’agit-il d’envisager sérieusement le sort d’un Québec indépendant, comme Amy Ransom l’a suggéré en 2001 ? Si oui, ce sort est d’une noirceur extrême.
Toutefois, le choix du Québec m’apparaît plutôt comme un prétexte pour condamner, dans un cadre plus familier pour les lecteurs de Wyl, les affronts à la dignité humaine de tous les régimes dictatoriaux ou totalitaires du demi-siècle précédent, en confondant dans la même réprobation les camps nazis, le goulag soviétique et la répression chilienne. On sent en particulier l’influence de L’Archipel du Goulag (1973) d’Alexandre Soljénitsyne.
Wyl reste vague sur la datation des événements. L’invasion soviétique a lieu un dimanche 24 juin, ce qui situerait l’amorce de l’action soit en 1979, soit en 1984 pour rester en aval de la date de publication. Toutefois, le roman évoque aussi une prise du pouvoir par les Communistes en France, deux ans avant l’invasion. Si celle-ci avait eu lieu dans la foulée d’une élection présidentielle, il s’agirait forcément de celle de 1981, ce qui situerait l’invasion en 1984, année emblématique.
Orgueil a combattu l’indépendantisme québécois avant l’invasion (p. 39) et le Québec restait une province canadienne au moment de l’opération franco-soviétique (p. 56). René Lévesque en était encore le premier ministre et il est question de son second mandat (p. 56), ce qui plaide en faveur de 1984. De plus, John Turner est premier ministre du Canada, ce qui était envisageable pour toutes ces dates, mais en particulier pour 1984 – et il l’est d’ailleurs devenu fin juin. Quant au président des États-Unis, Frank Allison, il ne semble pas correspondre à un politicien réel.
Le roman accorde au minimum douze ans (p. 313) d’existence au nouveau régime, ce qui nous amènerait en 1996, même s’il est question du « jubilé » des accords d’Helsinki (p. 259) qui prolongerait le cadre temporel jusqu’en 2025, selon l’acception qu’on donne au terme. Il est d’ailleurs loin d’être certain que l’assassinat du Numéro-Un entraînera la chute du régime.
Il s’agit plus d’une fresque que d’un roman, car il n’y a pas vraiment d’intrigue suivie, contrairement à Compagnon du soleil. Wyl procède par vignettes en livrant des fragments, parfois dans un certain désordre chronologique. Il combine les descriptions relatives à l’état de la société québécoise avec des scènes plus courtes, des extraits du journal de cellule d’Orgueil et d’autres pièces d’archives. L’ensemble brosse un portrait dévastateur, mais pas exactement original, du nouveau Québec.
Dix ans après le Printemps de Prague et cinq ans après le 11 septembre 1973, quand Salvador Allende est mort dans son bureau durant le putsch de l’armée chilienne, Wyl restait en-deçà des horreurs du génocide cambodgien qui avait lieu au même moment, dans un certain silence, mais il ne manquait pas de références potentielles plus anciennes. Ainsi, la résistance animée par l’Organisation Armée Secrète du Québec renvoie à l’OAS de la guerre d’Algérie. Les exemples à la disposition de Wyl sont nombreux et il s’en sert pour explorer la condition humaine.
Toutefois, le roman a ses limites. Wyl situe l’action au Québec, mais il restitue la réalité québécoise en usant d’un français international qui sape tout réalisme et réduit la province à un décor commode. S’il dépeint avec compassion et compréhension les souffrances des opprimés, il est beaucoup plus sommaire en ce qui concerne les motivations des bourreaux. Quelques aperçus des dirigeants s’adonnant au grand jeu de la politique internationale et de la répression interne ne suffisent pas à répondre à la question de l’identité ou du parcours des collaborateurs québécois au service de la dictature. Dans Saisons, Gélinas embrassait plus large.
Écrivain et journaliste lui-même, Wyl est plus à son aise quand il attribue à ses personnages qui œuvrent dans la même branche des morceaux de bravoure dénonçant l’inacceptable. En revanche, il n’approfondit guère la psychologie des exécutants. Il se borne à parler de la pourriture intérieure des policiers et des tortionnaires. Du coup, il dédaigne les observations des années 60, tant du fanatisme juvénile des Gardes rouges en Chine que de la banalité du mal associée aux fonctionnaires nazis par Hannah Arendt. Pourtant, la question la plus intéressante demeure non pas l’ampleur de la cruauté humaine quand les circonstances s’y prêtent mais plutôt la nature du basculement psychologique ou de l’effet d’entraînement qui fournissent les tyrans en âmes damnées.
L’impression de n’obtenir de Wyl qu’une vision partielle de la réalité d’un Québec totalitaire est renforcée par l’absence de personnages féminins agissants. Quand des femmes sont mentionnées, c’est en tant que compagnes de hasard ou éléments des vies de couple ou des existences familiales auxquelles les protagonistes masculins ont été arrachés. Bref, elles n’existent guère qu’en fonction de l’affection ou du désir masculin.
Si l’abondance de personnages masculins reflète en partie leur prédominance en politique à l’époque, le personnage d’Orgueil n’hésite pas à assimiler les femmes à de la viande et les plaisirs de la liberté qu’Orgueil regrette incluent celui de payer pour le temps et l’amour d’une prostituée. C’est une forme de réalisme cru, mais qui ne contribue pas à le rendre plus sympathique.
De fait, le roman pâtit aussi de l’absence de personnages forts et sympathiques, même si, en dernière analyse, cette absence rend un peu plus supportable l’annihilation de toute forme d’espoir. Gélinas terminait Saisons avec la construction d’un bateau qui illustrait la possibilité d’une fuite. Alors que la goélette du Camp 28 est enterrée avec son constructeur, le personnage de Gélinas ne baissait pas les bras et recommençait la construction de son bateau même après un accablant revers.
Wyl nous laisse sur un verdict nettement plus désespéré, puisqu’il n’a pas vu venir la chute de l’empire soviétique douze ans à peine après la parution de ce livre. [JLT]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 413-416.
Références
- Pettigrew, Jean, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec VI, p. 669-670.