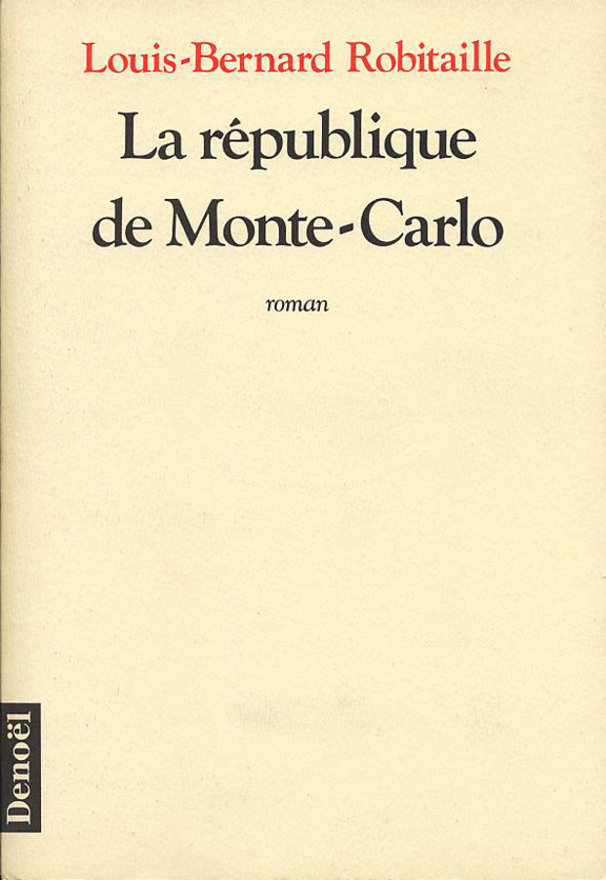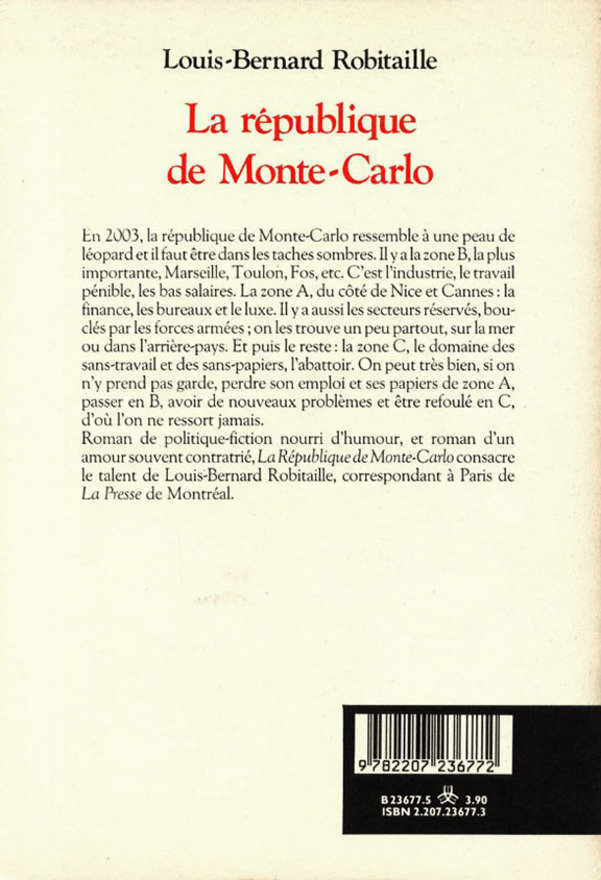À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
Première décennie du XXIe siècle en Europe. La carte géopolitique du monde est considérablement bouleversée par des troubles politiques qui ne semblent épargner que l’Australie. Le Sud de la France a fait sécession avec le Nord où sévissent des hordes de vagabonds, de chômeurs et de mutants dans les campagnes et en banlieue de Paris. Les dix millions d’habitants du Sud se sont regroupés autour des villes de Nice et de Marseille et ont fait de Monte-Carlo la capitale politique de la république. Mais une échéance pèse sur l’existence des citoyens de cet État : l’annexion au Nord prévue pour le 1er janvier 2009.
Entre temps, la vie continue malgré les perspectives d’avenir peu encourageantes. Le narrateur raconte la chronique de cette époque à travers sa relation avec une jeune femme depuis une dizaine d’années. Il a rencontré Vénus Lambropoulos dans un bar qu’il fréquentait avec des amis. Au début, elle ne lui a pas plu mais après deux ou trois rencontres, il est tombé sous son charme. Lui, occupe un emploi de journaliste sportif dans un quotidien de Nice. Elle mène une existence mystérieuse dont il ne cherche pas à percer le secret. Elle disparaît pendant des mois mais elle revient toujours et tout reprend comme avant, comme s’il n’y avait eu aucune interruption. Même après une absence de cinq ans (1998-2003), en raison d’un coma prolongé dans lequel il a été plongé à la suite d’une blessure subie lors d’une émeute au moment où il s’apprêtait à traverser la frontière au Sud, il la retrouve comme si c’était la veille.
Toutefois, depuis qu’il l’a vue sur une photo prise au Bristol, un hôtel de Paris fréquenté par les dirigeants du régime du Nord, il n’a pas tout à fait l’esprit tranquille. D’abord, qu’est-ce qu’elle peut bien faire là ? Et cet homme à l’arrière-plan, n’est-ce pas Natoll, une connaissance dont il se méfie ? Serait-il son amant ? Le narrateur préfère ne pas savoir et ne questionne pas directement Vénus. De nouveau séparé d’elle à la suite de l’invasion de la république du Sud par les troupes du Nord, il doit se réfugier dans la montagne à Coursegoules. Dix-huit mois à vivre terré avec deux amis en attendant que la situation s’améliore, que le calme revienne. Dix-huit mois à penser à Vénus dont il finit par comprendre la nature des activités grâce à son ami Macao avec qui il se planque. Et à la lumière des événements qui les ont amenés à quitter Cagnes en catastrophe pour la montagne parce que la région n’est plus sûre, il y a tout lieu de croire que cette fois-ci, il ne la reverra pas vivante.
Commentaires
Je retrouve Louis-Bernard Robitaille tel que j’ai appris à le connaître dans ses chroniques journalistiques. Un sens de l’observation fameux, un esprit d’analyse brillant, l’impression d’être aux premières loges de l’actualité. Correspondant de La Presse à Paris, Louis-Bernard Robitaille vit en France depuis de nombreuses années. Cette position géographique teinte grandement le portrait du monde qu’il brosse dans son premier roman, La République de Monte-Carlo. Plus sensible que nous aux événements politiques qui secouent l’Europe de l’Est comme la communauté économique européenne, le nouveau romancier anticipe ce que deviendra cette partie du monde à la fin du siècle.
C’est donc un roman de politique-fiction qu’il nous livre sous forme d’une chronique d’une époque qui couvre une quinzaine d’années, de 1997 à 2011. Époque troublée par des changements politiques en Amérique comme en Europe, par une épidémie terrible, par des problèmes économiques et par des disparités sociales. Sur cette toile de fond inquiétante se superpose l’évocation d’une relation amoureuse entre un journaliste et une jeune femme qui fait écho en quelque sorte au désordre politique. Di Zazzo, le narrateur, est journaliste. C’est donc tout naturellement qu’il en viendra à écrire son étrange relation avec Vénus Lambropoulos afin de se souvenir d’elle pendant leurs nombreuses périodes de séparation.
L’époque est au désenchantement. Les riches qui se sont réfugiés dans la république de Monte-Carlo pour échapper aux horreurs du Nord s’éclatent dans des fêtes pour oublier leur chute prochaine. C’est le règne de la décadence, des petites combines pour survivre et de la loi de la jungle. L’heure n’est pas au romantisme mais au cynisme. J’imagine que le même climat malsain devait régner en France au moment de l’Occupation allemande. Rompu aux rebondissements de la vie politique en France et en Europe, Louis-Bernard Robitaille est visiblement à l’aise dans la description de l’évolution du climat social des deux régimes qui s’affrontent et des alliances politiques qui modifient constamment les rapports de force entre le Nord et le Sud et à l’intérieur même de la république de Monte-Carlo. Son expérience de journaliste le sert grandement également pour présenter les individus qui composent l’entourage du narrateur.
La République de Monte-Carlo contient toute une galerie de personnages fortements typés qui traduisent un éventail complet des attitudes et comportements de l’être humain dans des situations de fin de régime ou de fin d’un monde. L’auteur a vraiment le don de décrire en quelques pages des personnages qu’on n’est pas près d’oublier. Qu’on pense à Natoll, le cobra, à Macao, jamais à court de ressources, à Archibald, le photographe gauche avec les femmes, à Paolini, le patron du journal, à Alex, le meilleur ami du narrateur et sa femme Corinne (« On l’attendait salope, aux ordres, elle arrivait dure et tranchante comme l’acier, patronne de bordel plutôt que pensionnaire. »). La différence entre Corinne et Vénus ? «Corinne donnerait volontiers dans la pute haut de gamme, tandis que tu joues davantage les sorcières nymphomanes. »
Le narrateur se paie des portraits féroces de ceux qui composent son cercle d’amis ou de connaissances mais il cache un fond de tendresse et d’humanité malgré le cynisme à la mode du jour. Il est sans complaisance face à lui-même et ne prétend pas faire autre chose que sauver sa peau. Néanmoins, son histoire d’amour avec Vénus qui constitue le fil conducteur de ce roman nous le rend sympathique. Certes, ce lien est fragile et la jeune femme est plus souvent occupée à jouer les Mata-Hari que présente dans la vie du narrateur. Le souvenir devient l’unique refuge de Di Zazzo et la certitude de la revoir le maintient en vie et lui donne le courage de lutter pour survivre. Dans ce monde qui a perdu le sens des valeurs morales, le narrateur demeure néanmoins un privilégié parce qu’il peut travailler, avoir un appartement et manger à sa faim. Rien à voir avec le sort horrible des parias qui sèment la terreur dans la zone C. Il affiche un détachement de bon aloi mais c’est l’amour qui le sauve quotidiennement du désespoir.
La République de Monte-Carlo aurait pu être un roman insupportable tant l’atmosphère de l’époque porte à la déprime mais il est sauvé par le vieux fond d’humanité qui résiste aux avanies les plus terribles. Ce romantisme fin de siècle a quelque chose de sublime qui transcende la corruption et la dépravation ambiantes. À la fin, le narrateur atteint même une sorte de sérénité qui lui fait accepter l’éventualité de sa mort alors qu’il s’apprête à quitter son refuge dans la montagne.
La République de Monte-Carlo est un roman typiquement français. L’intrigue n’y est pas très consistante malgré les événements politiques importants qui bouleversent le quotidien du héros. C’est aussi un roman très branché en ce sens que l’auteur y énumère les endroits qu’il faut fréquenter, le nom des personnalités bien en vue et les derniers phénomènes culturels à la mode. Il propose un art de vivre dans une société en pleine débandade qui court à sa perte.
J’y ai retrouvé le style du journaliste dont les chroniques composent une lecture extrêmement lucide de la vie politique, sociale et culturelle en France. L’écriture est vive et précise, bien servie par un sens de la formule qui fait image, particulièrement dans les portraits sans complaisance qu’il brosse des contemporains du narrateur. Cette chronique d’une mort annoncée d’une civilisation ne manque pas d’intérêt malgré quelques longueurs et redites qui affaiblissent la narration et l’utilisation d’une certaine langue qui vise parfois plus l’épate que l’efficacité. La science-fiction n’y trouve pas nécessairement son compte mais la littérature n’en sort pas perdante car l’auteur fait preuve d’une sensibilité peu commune aux démons qui agitent en profondeur l’ordre ancien en cette fin de siècle. [CJ]
- Source : L'ASFFQ 1990, Le Passeur, p. 162-165.
Références
- Bélil, Michel, imagine… 54, p. 86-87.
- Bordeleau, Francine, Nuit blanche 52, p. 22-23.
- Gagnon, Valérie, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec VIII, p. 763-764.
- Ménard, Fabien, Solaris 91, p. 14.