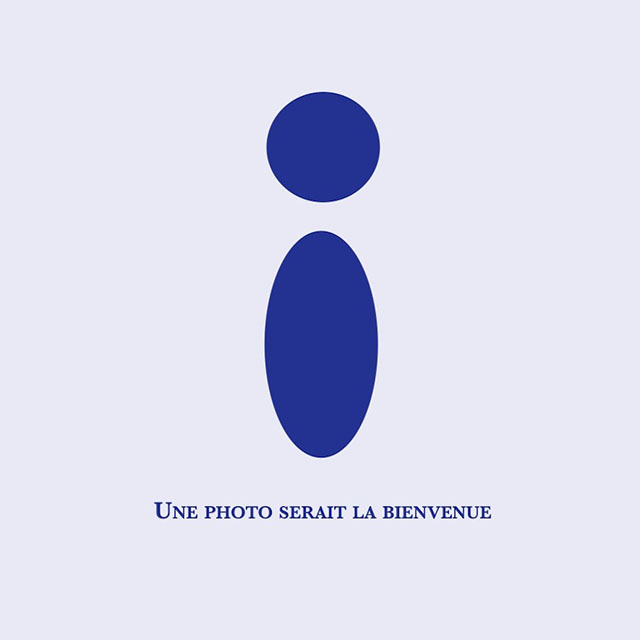À propos de cette édition

Résumé/Sommaire
Depuis 1984, les femmes, plus intéressées à la politique et plus assidues aux bureaux de vote que les hommes, ont pris le pouvoir dans l’élan des revendications féministes des années 60 et 70 et retourné la situation des sexes. Elles sont aux commandes partout, l’État, c’est elles. Les hommes sont confinés aux tâches subalternes, en particulier celles qui nécessitent de la force physique, mais on en garde un peu dans les arts et les sciences, sous la supervision des “Femmes de Tête”. Tout est considéré comme une richesse collective, l’air, l’eau, l’énergie, les ressources en général et tout doit être payé par les usagers. Les hommes sont devenus une de ces « richesses nationales » et on les achète pour des mariages de courte, moyenne ou longue durée.
Diane, à vingt-huit ans, occupe un poste important. Elle n’a pas encore un appartement ou une maison à elle ; elle se décide. On lui explique longuement ses devoirs : on lui confie ce logement, il appartient à l’État. Quant à s’acheter un homme pour aller avec, rien de plus simple. On lui en propose un qui ne lui convient pas et qu’elle refuse avec énergie. Elle a assisté plus tôt à une scène où une femme voulait garder son homme mais était en retard de paiement ; l’homme a été repris sur-le-champ. Il est encore là. Il lui rappelle quelqu’un.
Elle se souvient de sa jeunesse à l’université où elle s’était amourachée d’un étudiant en droit qui l’a ignorée délibérément. Elle croit le reconnaître en cet homme, qui dit pourtant s’appeler Éric, et non Georges comme cet étudiant du passé. Elle songe à l’acheter, avec une vague idée de revanche. Mais la conversation qu’ils ont ensuite la fait changer d’avis : cet homme n’est pas comme les autres et le revendique. Il est « masculiniste ». Il traitait autrefois fort bien les femmes, sans les asservir, et refuse donc d’être asservi. Poète, il a pratiqué la résistance passive avec ses cinq précédentes épouses, qui ne le comprenaient pas. Après leur mariage, formalité rapide, il finit par admettre sans l’admettre qu’il est bien Georges et dit à Diane qu’ils auront fait un mariage d’amour, car il a en fin de compte choisi de se laisser choisir : après cinq mariages couronnés d’insuccès, un homme est retiré du marché, mais Diane l’ignorait.
Commentaires
On est habitué aujourd’hui à des versions plus subtiles du renversement des rôles, et surtout à des questionnements sur les rôles eux-mêmes. Il n’en allait pas de même au Québec au début des années 1970, c’est évident. L’arbitraire infondé de la prémisse de base – un État contrôlé par les femmes ne peut être qu’autoritaire, matérialiste et collectiviste –, la désinvolture avec laquelle on passe sur les modalités de ce retournement socio-politique majeur et pourtant quasi instantané (d’après les dates et chiffres donnés, cela ne fait pas même vingt ans), tout cela montre bien que le « Et si ? » science-fictionnel est demeuré des plus superficiels pour l’auteur ; la science-fiction ici n’était qu’un prétexte à un pamphlet à peine déguisé.
On n’aborde que de manière très détournée les relations amoureuses entre femmes, on a conservé le mariage – en tant que reddition de services exploitant l’homme – et l’on envisage les relations de travail comme hyper-hiérarchisées avec tout en haut des « matrones » dépourvues d’humour : transpositions sans imagination. Il est assez évident qu’on nous invite à être choqué par la situation des hommes, sans une seule excursion du côté de ce que les mêmes situations avaient pu avoir de choquant et de pénible pour les femmes, sans une seule réflexion sur ce que le renversement des rôles pourrait illuminer. On n’est pas là pour réfléchir.
C’est bien en effet un discours « masculiniste » qui se dévoile ici, y compris la magnanime reconnaissance par le protagoniste, du bout des lèvres, que la société organisée par les femmes « ne manque pas de sens mais doit être repensée sur des bases d’égalité » (de toute manière, dit-il, elle ne va pas tarder à s’écrouler). Il n’est pas indifférent non plus que le cœur du texte soit une histoire… disons d’amour, centrée sur le protagoniste masculin. Georges-Éric est décrit comme « un être qui a souffert », ce qui attire automatiquement l’intérêt de Diane ( !) ; il mène le dialogue, et le jeu, jusqu’à ce que la proie soit captivée, et capturée.
On se serait au moins attendu à voir souligné avec ironie le côté « féminin » de ces tactiques retournées contre une femme… Mais non. C’est moins de la revanche des femmes que de celle d’un homme qu’il est question ici. Le plus affligeant, à la lecture de ce texte, c’est de se dire qu’il pourrait encore être écrit par quelqu’un (voire quelqu’une) quelque part, aujourd’hui, et être publié à peu près tel quel. [ÉV]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 184-185.