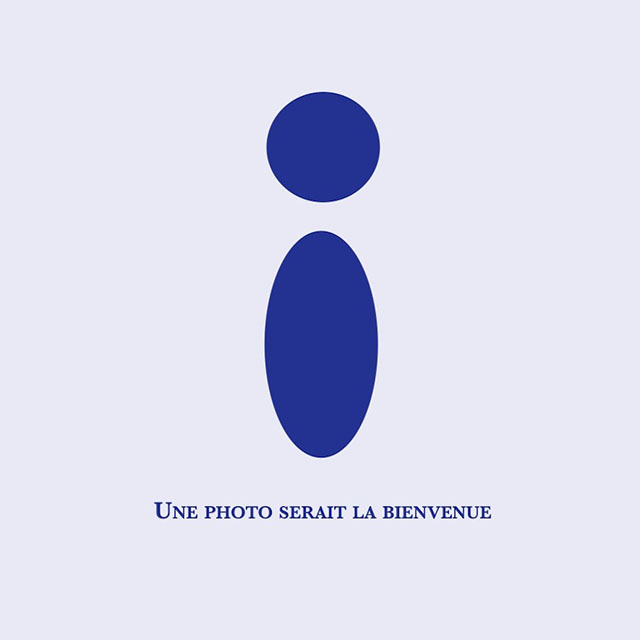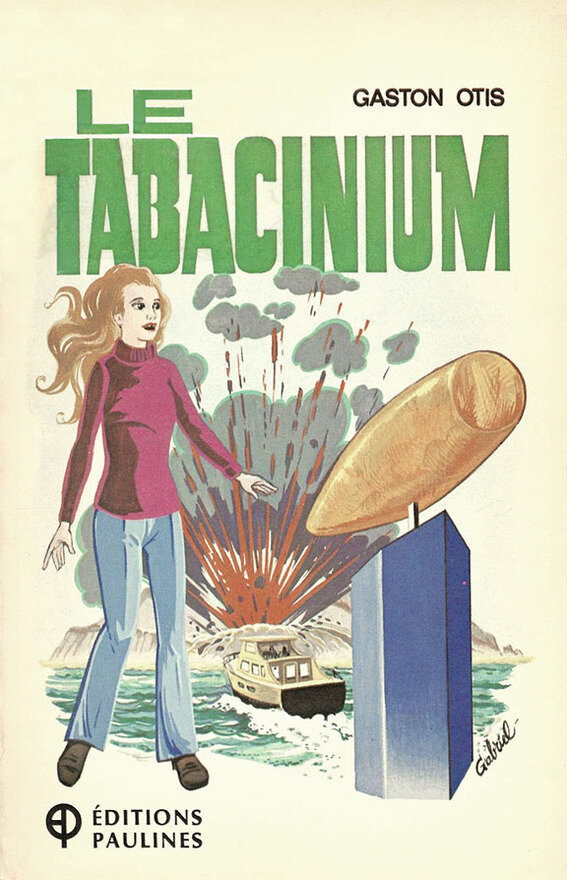Résumé/Sommaire
Le gouvernement de l’île Blanche, une petite république isolée en plein océan Atlantique à mi-chemin entre le Groenland et Terre-Neuve, est aux abois. Une sculpture du musée national a été volée. Or la sécurité de l’île est liée à cette sculpture qui contient le programme de défense du territoire et des mines de tabacinium, richesse naturelle rarissime convoitée par les grandes puissances. Le gouvernement fait appel à une ancienne compatriote, mademoiselle St-André, pour tenter d’élucider l’affaire et de rétablir la situation.
On soupçonne d’abord les Russes, les Américains ou les Chinois d’avoir fait le coup, mais il apparaît assez rapidement, quand mademoiselle St-André est kidnappée, que c’est le général Biggerman qui tire les ficelles du complot. Supposément mort dans un accident d’avion quelques années plus tôt, ce mégalomane a travaillé dans l’ombre pour mettre sur pied une organisation qui veut imposer un « Monde Meilleur » sur la planète entière. Il a besoin du tabacinium, un combustible solide, pour alimenter ses fusées pointées sur les grandes capitales au moment de lancer son ultimatum. Avec l’aide de quelques collègues espions et de la nièce du général Biggerman qui se retourne contre son oncle quand elle se rend compte qu’il est fou, mademoiselle St-André livre aux grandes puissances réunies contre cette menace les coordonnées de la base secrète du général. Au moment où celui-ci meurt, l’île qui abritait la base est détruite par une série d’explosions.
Commentaires
Le Tabacinium de Gaston Otis ressemble à un croisement de Bob Morane et de la série Unipax de Maurice Gagnon. Mais là s’arrête la comparaison car Otis n’a ni le sens de la narration et de l’intrigue d’Henri Vernes ni la précision d’écriture de Gagnon. En fait, le roman d’Otis est un ratage complet tant le récit est truffé de nombreuses invraisemblances. Cela commence par le vol de la sculpture qui est censée constituer la clé du système de défense de l’île Blanche et d’une tonne de tabacinium. Or la sculpture est remise en place sans qu’on sache qui l’a rapportée et le tabacinium est retrouvé sur un navire qu’on a vite fait d’intercepter. Ces deux opérations sont pourtant considérées cruciales pour la réussite du plan du général Biggerman. Il n’en est plus question par la suite.
Par ailleurs, il apparaît tout à fait invraisemblable que trois espions représentant chacun une puissance mondiale, un Russe, un Américain et un Chinois, collaborent comme de vieux potes avec l’espionne venue à la rescousse du gouvernement de l’île Blanche, mademoiselle St-André. Je veux bien saluer l’audace de l’auteur qui a confié à deux femmes – sans compter le double rôle de la nièce du général, Shirley – la responsabilité de l’enquête. Que mademoiselle St-André joue les Bob Morane, passe encore, mais que mademoiselle Leblanc, dite La « Vieille », occupe la fonction de chef des services secrets, c’est assez peu crédible.
La scène la plus surréaliste du roman est certainement celle où Shirley, à la faveur d’un arrêt sur un îlot rocheux à proximité de la base de son oncle, se fait bronzer en bikini alors qu’elle et son dévoué garde du corps doivent livrer manu militari trois prisonniers (Mlle St-André, Dubuc et Kofsky) au général.
Quant à la situation géopolitique de l’île Blanche, elle est à peine évoquée en deux paragraphes. L’île est peuplée « à 95 % de gens d’origine québécoise » qui s’y installèrent vers 1800. Sa capitale, Germainville, compte environ 45 000 habitants et son économie repose sur l’exploitation des mines de tabacinium, du nom d’un savant italien, Tabacini, qui a découvert ce combustible solide en 1922. L’auteur rappelle que l’île est minuscule et pourtant, il faut trois quarts d’heure en auto sur une route nationale, « à une vitesse folle », pour se rendre de la capitale à un quai d’embarquement. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’auteur n’a pas la notion des distances puisqu’un personnage mentionne, à un moment donné, que deux individus qui viennent d’être arrêtés à Los Angeles pourront être interrogés dans trois heures (!) à l’île Blanche.
Tout cloche dans l’intrigue et l’auteur n’est guère plus compétent dans l’écriture. Il se montre incapable de soutenir une description ou d’exposer une mise en situation de plus de deux lignes. Les débuts de chapitre font penser à des didascalies : « Nous sommes présentement dans la grande salle du Conseil du gouvernement de l’île Blanche », « Dans le bureau de mademoiselle Leblanc ». Cette impression est accentuée par le fait que le roman contient beaucoup de dialogues. Si au moins ces dialogues sonnaient juste, mais non ! On se donne de La « Vieille » et du « mon vieux » à qui mieux mieux tandis que Dubuc, un ancien espion qui reprend du service comme comparse de mademoiselle St-André, fait connaître périodiquement son étonnement par un risible juron : « Pétarade ! »
Il y a aussi un manque flagrant de cohérence dans le texte. L’auteur utilise le système métrique pour donner une idée de la dimension de la grotte qui sert de porte d’entrée au repaire du général Biggerman. Deux pages plus loin, il exprime en pieds la longueur du couloir emprunté par les protagonistes. Ailleurs, dans une même scène, Mlle St-André passe du tutoiement au vouvoiement avec la même interlocutrice. En outre, plusieurs mots sont utilisés à mauvais escient. Tel prisonnier se fait imposer un bâillon… sur les yeux ! Autre exemple patent : « Elle a enfin l’affirmation que toutes ses hypothèses sont fondées. »
Au demeurant, Le Tabacinium, avec sa figure de mégalomane fou qui veut imposer à tous un « monde meilleur » – « où les classes sociales seront beaucoup plus compartimentées, où les faibles de corps et d’esprit seront éliminés » – et ses personnages d’espions, relève davantage du roman d’espionnage que du roman de science-fiction. Si ce n’était la situation politique improbable de l’île Blanche – une quasi-utopie du fait de son existence même – et les propriétés révolutionnaires du tabacinium, il n’y aurait pas lieu d’inclure ce roman dans le corpus SF. La même question d’appartenance générique s’était posée dans le cas de la série Unipax de Maurice Gagnon mais là, la qualité de l’œuvre ne faisait pas de doute. [CJ]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 317-319.