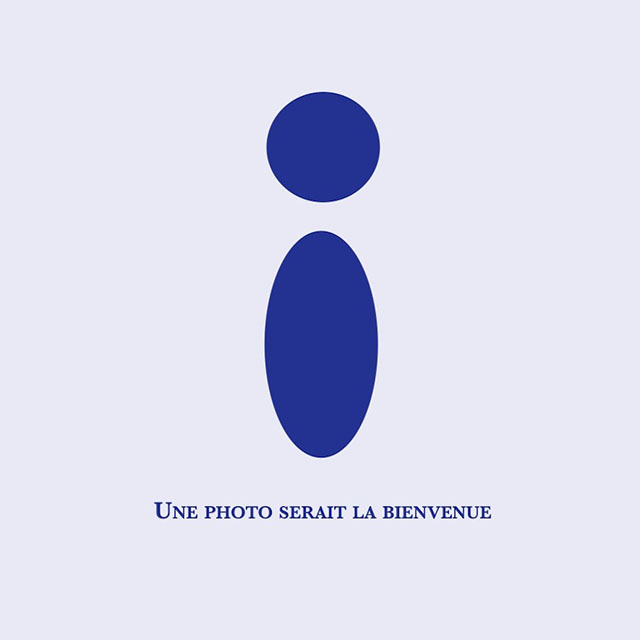À propos de cette édition

Résumé/Sommaire
Alors qu’il se fait siffler sur la rue et que Mariette, sa femme, lui dit pour qui voter, Manuel doit penser à tout et s’occuper de tout le monde. Il ne profite que depuis peu d’un compte conjoint qui lui évite de demander constamment de l’argent à sa femme, trop préoccupée par son travail ou la politique. Il passe ses journées à faire des courses, parler au téléphone ou planifier le repas du lendemain, malgré la mélancolie qui s’empare progressivement de lui. Il vit dans un monde où les hommes sont ménagers, secrétaires ou instituteurs, commençant à peine à songer à l’émancipation.
Commentaires
La science-fictionnalité du monde dans lequel cette nouvelle de Pierrette Roy se déroule relève d’une distanciation purement sociologique : les hommes jouent le rôle des femmes, et inversement. C’est la logique de l’inversion des pouvoirs sociaux et amoureux, d’un renversement parfait des constructions et des hiérarchies genrées, qui rappelle un peu La Planète des singes de Pierre Boulle (1963). La société qui y est dépeinte est précisément celle de la classe moyenne québécoise des années 1960, semblant tout droit sortie d’un téléroman. Le quotidien y est aliénant et les relations inégalitaires de couple omniprésentes. L’homme de la maison se fie à son « intuition masculine » pour faire des choix culturels pour le couple, il lit la « page masculine » dans le journal, remplie d’« histoires cochonnes » et de « revendications masculines », ou écoute « Homme d’aujourd’hui », lorsqu’il a terminé les courses et qu’il a discuté au téléphone avec son beau-père. Il s’occupe aussi méticuleusement de son corps pour demeurer attirant et viril pour sa femme, le plus souvent indifférente et froide.
L’idée de départ de cette nouvelle est loin d’être inintéressante : elle permet de mettre efficacement de l’avant l’absurdité d’une situation banalisée — celle des femmes dans une société patriarcale –, de créer un effet de distanciation qui relève autant de la science-fiction que de l’approche brechtienne d’un théâtre social qui appelle à la révolte. Il y a bien quelques rares trouvailles formelles intéressantes, notamment l’utilisation d’un langage pornographique masculin pour parler de ménage : « Il faut y mettre beaucoup d’amour. De l’amour dans les deux cuillerées de détersif que tu éjacules sur la vaisselle, chaque caresse d’ammoniaque que tu prodigues aux vitres, glaces et chromes, sur le tapis que tu pelotes dans les moindres recoins avec l’aspirateur, dans la tasse de sucre que tu fais tomber dans les pommes […]. » Mais, malgré ces courts passages, l’effet est plus vaguement amusant que véritablement révolutionnaire, et la simple inversion filée finit par s’essouffler.
S’adressant surtout à des femmes de son époque (la nouvelle est publiée dans un « magazine féminin »), le texte de Roy a un peu mal vieilli ; la vie quotidienne qu’elle décrit à coup de clichés nous semble lointaine et son appel au masculinisme (même s’il est ironique) semble aujourd’hui problématique. De plus, pour faire mouche, c’est à un public masculin qu’il aurait fallu s’adresser, les femmes, déjà bien au fait des travers d’une société qui ne les favorise pas, ne peuvent qu’y voir un exutoire temporaire et divertissant. [ED]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 347-348.