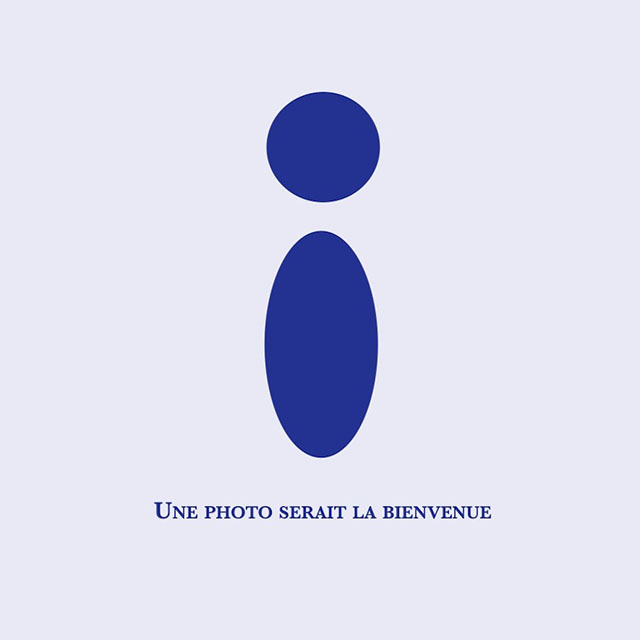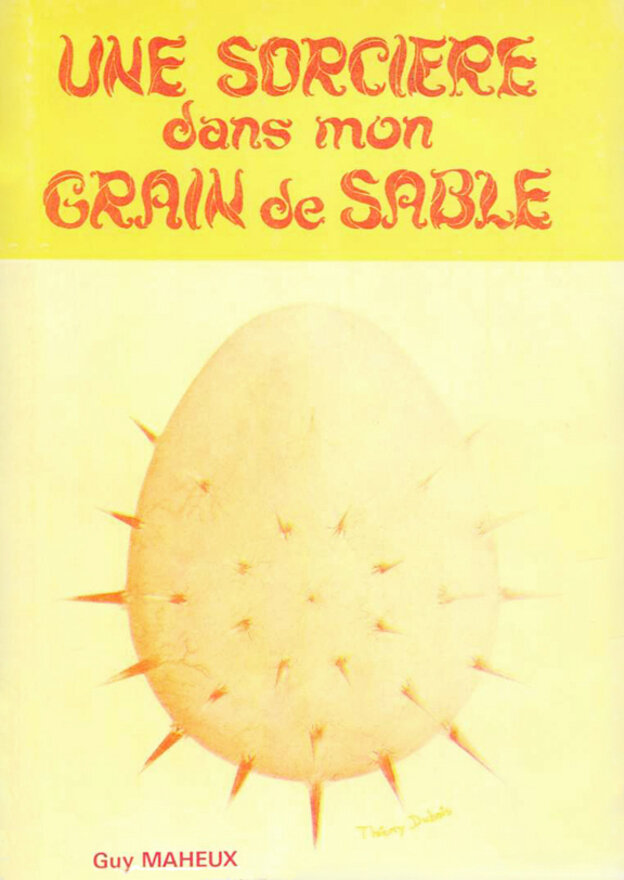Résumé/Sommaire
Affligée par la disparition de son amant, Vison-Noir, une prostituée de Montréal, espère retrouver ce Guillaume, dont le souvenir est prometteur d’une vie nouvelle. Pendant une année, Vison-Noir continue de rencontrer des hommes et d’accumuler en secret les dollars nécessaires pour fuir ce monde avec Manou, sa fille. La drogue et surtout l’alcool sont les plus grands obstacles de Vison-Noir, bien que ce soit une échappatoire facile de cette vie défavorisée. C’est l’espoir chimérique de retrouver Guillaume pour se sortir de sa situation qui obsède Vison-Noir, alors que sa mère meurt de honte et que sa fille est laissée à elle-même.
La protagoniste perd peu à peu conscience de la réalité, confondant parfois ses clients avec Guillaume, ce qui ne fait que renforcer son espoir de le voir revenir. Elle est même persuadée de l’avoir revu une nuit, dans un hôtel, nuit où il lui aurait donné un livre de poésie, et l’aurait rendue enceinte. Persuadée que Guillaume est le père, Vison-Noir se laisse embarquer par Salomon dans un rituel d’initiation satanique accompli par une sorcière et qui, croit-elle, lui ramènera son bien-aimé. Elle est tenue au secret, sous peine de ne pas voir son vœu se réaliser. Enivrée presque en permanence et impatiente, Vison-Noir dévoile partiellement le secret du rituel à deux hommes, ce qui, selon Salomon, chasse Guillaume, qui ne réapparaît donc jamais.
Manou tente alors de séduire Cacus, l’amant de Falline, sa grand-mère, qui succombe presque à la tentation. Alors que rien ne se produit, Vison-Noir et cette dernière trouvent, de retour à la maison, les deux autres sur le plancher, Manou étant presque nue. Cacus est incarcéré ; et lorsqu’il est libéré, il refuse de sortir et se suicide. Falline sombre peu à peu dans le laisser-aller et la folie, et Manou fugue, se retrouvant à Sept-Îles dans un bar de danseuses. Vison-Noir voit tous ses espoirs futurs brisés : le soir où Salomon lui explique pourquoi Guillaume n’est pas revenu, à bout de nerfs, elle attaque l’amante de Cacus, qui se moquait d’elle, et la tue accidentellement. Grand-Tuyau, un client de la protagoniste qui se révèle être un ministre, apprend la nouvelle et décide d’utiliser ses contacts pour que Vison-Noir ne soit pas inculpée, tout en complotant avec Salomon pour adopter l’enfant, ce à quoi cette dernière consent, peu avant de mourir en couches.
Commentaires
Rythmé par les mois d’une année, qui le divisent en autant de chapitres, le roman de Guy Maheux prend du temps à s’installer. Parfois narré à la première personne, mais surtout par un narrateur omniscient, le récit nous emporte dans les illusions de Vison-Noir, qui s’y perd la plupart du temps. L’auteur aime être évasif, ce qui est malheureusement confirmé par la surenchère de points de suspension. C’est pourtant ce qui garde le lecteur à la limite de la réalité et du rêve et insuffle l’aspect fantastique du roman, puisque le récit en soi est plutôt réaliste. En effet, c’est à force de voir tout ce qui joue sur la conscience de Vison-Noir (drogue, dépression, alcool, espoirs) que le fantastique apparaît. Elle semble constamment se retirer de son existence exécrable pour s’évader dans un monde onirique, le seul endroit où son amant, Guillaume, semble encore exister, s’il a existé.
Manifestement, seulement deux personnes autres que Vison-Noir disent lui avoir parlé, mais le lecteur n’est jamais certain que ces personnages ne mentent pas. Quant à Vison-Noir, dans ses apartés, elle dit souvent qu’elle est Guillaume, ce qui pourrait n’en faire qu’un fragment de son imagination. D’ailleurs, dans ce monde où elle s’adresse à lui, le temps s’écoule différemment : les secondes sont des siècles, et bien que les chapitres soient chronologiques, la notion de temps dans la relation de Guillaume et de Vison-Noir ne l’est pas et en accentue l’aspect chimérique. Vison-Noir entretient l’ivresse, sa réalité reste floue, lointaine, et ce qui s’y passe n’est que divagations : pendant ce temps, la réalité crue est bien présente dans le roman et pour tout le monde autour du personnage principal. C’est pourquoi le fantastique s’amenuise par rapport au reste du récit, peut-être trop même pour avoir l’effet escompté.
Outre le fantastique onirique, le récit illustre la déchéance de trois générations de femmes d’une famille défavorisée, dont les deux mères sont monoparentales. À l’image d’une tragédie grecque, le mauvais sort s’acharne sur ces femmes qui ont vendu, vendent et vont vendre leur corps, à défaut de connaître mieux. D’ailleurs, à l’issue du récit, les quatre personnages composant cette famille connaissent une fin tragique : la folie de Falline, l’incarcération et le suicide de Cacus, l’exploitation de Manou et la mort de Vison-Noir. Ces différentes chutes sont convenues et à la limite du mélodrame.
Le récit porte les influences de la tradition catholique québécoise et de ses contes où le diable apparaît si souvent. Le récit débutant en décembre, ce n’est pourtant qu’en juin qu’apparaissent les thèmes de la sorcellerie et du satanisme dans le récit, avec Salomon qui convainc Vison-Noir qu’il a la solution pour faire revenir Guillaume. Le rituel, cette intrusion du fantastique, arrive tard, mais est nécessaire afin de mettre en place la confiance de Vison-Noir en Salomon, qui lui est d’abord inconnu, puis la volonté de charité et la pitié de Grand-Tuyau, qui sauvera le bébé de Vison-Noir grâce à ses contacts.
L’adhésion plus ou moins réfléchie de Vison-Noir à la secte arrive alors qu’au bout de ses ressources, elle est dans un état d’extrême faiblesse psychologique. Elle est prête à tout faire, même participer à cette messe noire qui lui semble tout de même être une blague. Il faut noter cependant que, bien que l’auteur écrive de manière explicite qu’il s’agit là d’une cérémonie satanique, il n’hésite pas à choisir des figures d’hommes et de femmes noires, dont la sorcière, qu’il nomme l’Africaine. On est un peu mal à l’aise de constater que cet office démoniaque ressemble à une cérémonie vaudou à la mise en scène douteuse et que, étant donné son échec retentissant, Salomon et l’Africaine soient vus par Vison-Noir comme des profiteurs.
On se demande donc si, dans ce chapitre, Maheux a consciemment introduit ces malheureux clichés comme un message raciste qui, par ailleurs, détonne du reste de l’histoire et qui nous empêche de le confirmer. Notons également que le rapport de Vison-Noir à Guillaume, qu’il soit réel ou non, change à ce moment décisif du récit. D’une part, avant le rituel, ses souvenirs de l’homme évoquent la beauté, le rêve, la mélancolie, la nostalgie ; d’autre part, parce que Guillaume tarde à lui revenir, Vison-Noir pense peu à peu à lui avec haine, colère, et ses rêves deviennent des cauchemars. C’est malgré tout avec amour qu’elle nommera son enfant Guillaume avant de mourir.
C’est à partir du chapitre de juillet que le récit est particulièrement marqué par les symboles catholiques, héritage culturel provenant de la domination de l’Église catholique sur le Québec. Entre autres, Falline sombre dans la folie et brûle son lit en criant qu’elle voulait punir ceux qui ont volé la Sainte Famille. L’hystérie de la grand-mère, nourrie par sa honte, souligne la distorsion du mythe chrétien opérée par sa famille. Dans un contexte où Vison-Noir est loin de la sainteté, elle représente Marie qui tombe enceinte d’un homme qu’elle idolâtre, un personnage en soi invisible pour tous les autres. Nommer l’enfant Guillaume, c’est presque faire le lien entre lui et Jésus, qui est, selon le mythe, Dieu incarné. Falline considère évidemment que ces rapprochements corrompent un symbole religieux pur, mais l’auteur n’élabore pas plus à ce sujet, ce qui crée pourtant une belle dichotomie avec les éléments sataniques du récit.
Ainsi, le roman de Maheux se rapproche plus du conte avec son ton quelque peu moralisateur, un conte fantastique, mais surtout tragique. [SG]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 299-301.
Références
- Péan, Stanley, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec VI, p. 854-855.