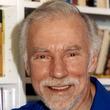À propos de cette édition

Résumé/Sommaire
Un petit homme de noir vêtu arrive à Solériville, en l’an 38 de la Grande Solution, c’est-à-dire au XXIIe siècle environ. La pluie ne le mouille pas, les voitures ne peuvent pas le renverser et ses pouvoirs de persuasion lui permettent d’influencer à sa guise la plupart des habitants de Solériville. Il entreprend de visiter l’immense agglomération en compagnie de Marcheur, un jeune réfractaire à peine libéré de prison.
Le petit homme débarque d’un objet volant d’origine inconnue et il observe avec déception que l’immense cité, compacte et respectueuse de la nature extérieure, n’a instauré l’harmonie et empêché les gens d’être malheureux qu’en abolissant la volonté individuelle. La violence est combattue par une alimentation fade et une musique pacifiante.
Marcheur caresse l’espoir de trouver un milieu plus à sa convenance dans Solérigrad, la ville jumelle devenue le refuge des mécontents. Le petit homme insiste toutefois pour explorer auparavant plusieurs facettes de la vie à Solériville. En quittant enfin celle-ci, ils croisent un dissident de Solérigrad, où la liberté individuelle permet à tous et chacun de donner libre cours à leurs impulsions du moment.
Toutefois, les autorités de Solériville ont découvert la machine volante du petit homme et ils se méprennent en faisant de Marcheur le pilote présumé de l’appareil. Ce dernier est donc abattu sous les yeux du petit homme atterré.
Commentaires
Ce récit d’anticipation relève de ce qu’on appellerait aujourd’hui une dystopie, mais une dystopie dont le principal défaut est d’être trop parfaitement lénifiante. Somcynsky aborde un thème qui lui restera cher, celui de la liberté individuelle. Dans quelles circonstances est-on porté à la sacrifier ? Au nom de quoi ?
Les conurbations jumelles de Solériville et Solérigrad regroupent a priori l’essentiel de la population planétaire. Elles s’inspirent des arcologies proposées par l’architecte italien Paolo Soleri, mais Somcynsky s’inquiète moins des aspects techniques de leur réalisation que des contraintes que leur densité imposerait aux habitants. Soit que les citoyens ne peuvent échapper à l’enrégimentement (à Solériville), soit qu’ils sont soumis aux frasques et caprices de leurs concitoyens plus forts (à Solérigrad). Somcynsky inverse ici les suffixes que l’on associerait d’emblée aux systèmes politiques contemporains correspondants, mais ce clin d’œil suggère surtout que les deux systèmes s’opposent si bien qu’ils se complètent et se confondent dans leur inhumanité foncière.
À Solériville, la Grande Solution de l’abolition de la volonté individuelle l’a emporté (p. 185 et 189), ce que le petit visiteur en noir résume en concluant que « Ce ne sont pas les gens qui ont décidé de vivre bien. […] C’est leur gouvernement qui a décidé cela pour eux. » (p. 221). Quand Marcheur finit par être éliminé, le visiteur d’un monde inconnu décrète sans ambages que c’était le dernier homme sain de Solériville, sans doute parce qu’il avait conservé son libre arbitre. (En 1989, Somcynsky soulignera de nouveau l’importance de cette capacité de refus dans une nouvelle marquante, « Dire non ».)
Le petit homme « aux moustaches noires, au drôle de chapeau melon » (p. 241) incarne sans doute un avatar de Charlot, faux ingénu qui conserve un peu de légèreté à une histoire plutôt tragique en définitive, tout en rappelant les films plus engagés de Chaplin, comme Modern Times. L’organisation de la satisfaction humaine à Solériville fait parfois aussi écho au film Soylent Green (1973) en démontrant que, même sans ce que le recyclage intégral avait de plus glaçant dans ce film, cette organisation même de l’existence reste condamnable. Au cœur d’une décennie qui voit la science-fiction québécoise proposer d’autres dystopies, celle-ci a l’avantage d’identifier clairement et simplement l’ennemie de la liberté, soit la négation de la volonté personnelle. [JLT]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 372-373.