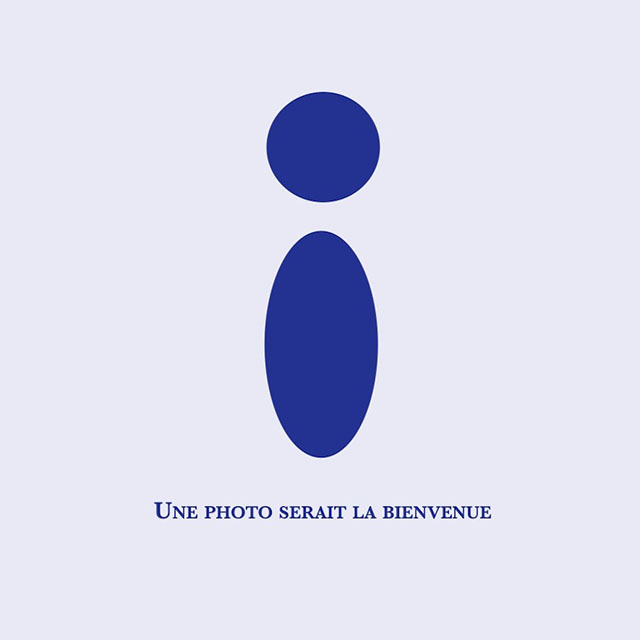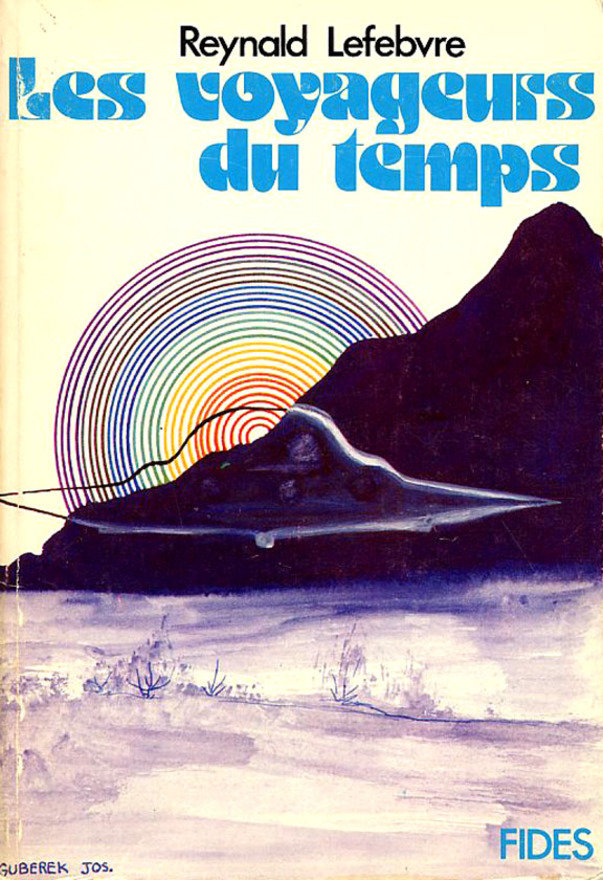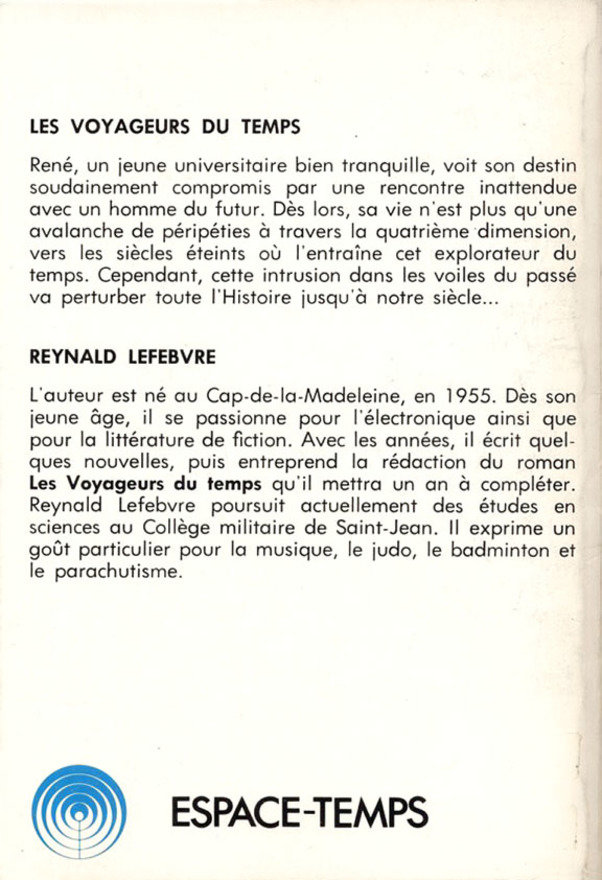À propos de cette édition
Résumé/Sommaire
En 1977, René Levert sauve un homme d’une bataille dont il est la proie dans une rue de Saint-Donald. Le visiteur refuse de donner son nom ; il lui laisse cependant le numéro de sa chambre d’hôtel. René se promet de revoir l’étrange personnage pour discuter, mais c’est plutôt un meurtre qui les réunira.
Un soir où René se promène, il aperçoit un corps inanimé. Il fait alors l’erreur de s’en approcher, et un jeune couple de passants le découvre, penché sur la victime. Ainsi désigné comme principal suspect par les témoins et interdit de sortir de la ville par les policiers, René cherche à faire comprendre qu’il n’est qu’un témoin comme les autres. C’est son nouvel ami mystérieux qui, ayant appris la nouvelle, décide de lui confier son secret, c’est-à-dire qu’il a en sa possession une machine à voyager dans le temps et qu’il vient en fait de l’an 2276. Le nommé Inock propose alors à René de retourner dans le temps, la veille, afin de connaître le vrai coupable.
Malheureusement, un problème avec la machine les projette plutôt en 1584, alors que le Québec n’est encore qu’un territoire inexploré par les Européens. René apprend de surcroît que ce simple voyage 400 ans dans le passé est suffisant pour changer complètement son monde : son époque d’origine a maintenant disparu et elle sera impossible à retrouver telle qu’il l’a quittée. Ils doivent alors redoubler de ruse afin de convaincre les matelots suspicieux de les embarquer sur l’un des rares bateaux de l’époque, à destination de la France, où ils pourront trouver les matériaux pour réparer la machine à voyager dans le temps.
C’est après un long périple jusqu’à Paris, une courte romance entre René et une dénommée Marie, un duel et une séparation qu’ils réussissent à obtenir les matériaux qui permettront à la machine de tenir assez longtemps pour les amener en l’an 1714. Ils doivent se remettre à la recherche de matériaux mieux adaptés et réparer le tout avant de retourner en 1977, mais seulement après avoir été soupçonnés de sorcellerie par un moine universitaire, qui est lui-même sorcier, et qui fait du chantage au duo de voyageurs dans le but avoué d’avoir leur aide pour fomenter une révolution. René et Inock s’enfuient pourtant, ayant rassemblé tout le nécessaire, et repartent dans la machine.
Inock laisse René en 1977, puis repart à son époque d’origine. René rentre ainsi à la maison, perdu dans un futur alternatif où il ne connaît plus personne et où Saint-Donald se nomme plutôt Cap-de-la-Madeleine.
Commentaires
Une dizaine d’années avant que l’Américaine Diana Gabaldon amalgame le voyage dans le temps et le récit historique dans sa série Le Chardon et le tartan, Reynald Lefebvre a eu la joyeuse idée de faire de même en situant son récit au Québec, en Nouvelle-France et en France. Les Voyageurs du temps est un roman sans prétention, même un peu trop court pour bien développer un récit passionnant, et c’est bien dommage.
La machine à voyager dans le temps fonctionne au nucléaire, source d’énergie qui alimente nombre de récits de science-fiction rédigés pendant la Guerre froide. Bien influencé par l’ère atomique, le récit sous-entend que c’est toujours l’énergie par excellence au XXIIIe siècle, époque d’origine d’Inock. Alors que l’auteur a pris le temps d’imaginer que l’usage du prénom et du nom de famille n’était plus à la mode au temps d’Inock, il est un peu décevant qu’il n’ait pas pu imaginer une source d’énergie originale, voire visionnaire, qui serait devenue la tendance du XXIIIe siècle. D’ailleurs, le mode de vie général de ce siècle, tel que raconté par Inock, est déjà dépassé pour un lecteur du XXIe siècle ; le roman semble donc avoir cruellement mal vieilli.
Une des choses qui nuisent malheureusement le plus au texte est en fait tous les petits détails qui empêchent la suspension de l’incrédulité que consent le lecteur lorsqu’il lit un récit de voyage dans le temps. D’abord, si les dialogues sonnent parfois un peu faux, au moins René pose des questions sur les mystères qui entourent son ami et le voyage dans le temps, mais est-il pertinent que les éléments mystérieux auxquels il cherche des réponses soient effectivement mystérieux ? De plus, Inock et René passent beaucoup de temps à planifier leurs histoires pour que les gens du passé ne les trouvent pas étranges, discutant même du risque d’utiliser, en 1714, des pièces de monnaie frappées en 1584, mais il y a quelques oublis boiteux dans leur préparation. Par exemple, Inock ne pense pas à se donner un nom plus adéquat au XVIe siècle et doit l’improviser au moment où il se présente. Ce genre de maladresse est peu convaincant pour un voyageur temporel prétendument expérimenté.
Le rythme du roman et sa narration sont inégaux par moments. Certaines ellipses dans l’histoire contrastent avec les pages d’explication de détails techniques. Il faut aussi dire que pour les deux protagonistes, tout est trop commode, puisque même dans les moments de danger évidents, les deux réussissent à s’en sortir plutôt aisément, et le lecteur ne craint jamais pour eux. Les dangers sont mentionnés comme de graves situations, mais les antagonistes ne se montrent pas ou ne réussissent jamais à attraper Inock et René, ou ils sont mentionnés, mais on n’en entend plus jamais parler après un saut dans le temps ou, plus surprenant, un simple tour de charrette.
Dans la même veine, de nombreuses pistes sont disséminées dans ce roman, mais ne sont jamais résolues. Nous voulons bien croire qu’en voyageant dans le temps, ce qui était n’est plus, mais quand Inock ne veut pas donner son nom parce qu’il n’a pas le droit, jamais il n’explique pourquoi. Si le futur est changé, quelles pourraient bien être les conséquences de donner son nom ? Ou encore, René et lui remontent le temps pour découvrir le véritable meurtrier. Soit, mais le lecteur n’en connaît jamais la réponse, puisqu’à leur retour en 1977, tout a changé.
En fait, toutes les explications sont peu convaincantes ou même parfois inexistantes. Les situations rencontrées, quant à elles, manquent de profondeur ou sont absolument inutiles. Par exemple, lorsque Inock propose à René de remonter le temps pour découvrir le meurtrier, leur simple promenade en forêt déclenche une poursuite policière, mais on ne comprend pas comment les policiers ont su qu’ils partaient. C’est sans compter l’histoire d’amour insipide et inattendue entre René et Marie, qui est si courte et si inutile dans le récit qu’il ne semblait pas pertinent d’en parler dans le résumé, bien que l’auteur ait cru bon d’intituler un chapitre du nom de Marie et de créer de surcroît un chapitre mettant en scène un duel entre René et le fiancé de Marie alors que René se laisse convaincre de ne pas rester dans le passé (pour des raisons obscures et laissées en suspens).
C’est aussi le problème de la rencontre avec le père Séguin, qui est en fait un sorcier et qui, croyant que les voyageurs aussi sont des sorciers, souhaite les utiliser afin de prendre le pouvoir en France, récit qui fait écho à la Révolution française quelques décennies plus tard… histoire plus ou moins développée et qui s’interrompt au bout d’une poursuite et de la disparition de l’appareil. La fin du roman arrive comme un cheveu sur la soupe, en trois pages à peine, avec le retour des voyageurs en 1977, et le départ pressé d’Inock qui retourne chez lui avant que l’appareil ne tombe en ruine. Le lecteur ne peut qu’être frustré par un manque de détails aussi flagrant, alors que des explications auraient permis de peaufiner les tenants et les aboutissants du voyage dans le temps selon Lefebvre.
C’est d’autant plus regrettable, enfin, que le cœur du récit, le voyage dans le temps, soit si déplorablement élaboré. Décrivons-le d’abord : l’appareil qui les transporte peut se déplacer, et il peut voyager à différentes dates et différentes années. Peu importe l’influence qu’ils auront dans le passé, à leur retour, absolument tout ce qu’ils connaissaient aura changé. Le type de voyage de ce roman est une chronologie dynamique (ex. Le Voyageur imprudent, René Barjavel), au contraire d’une chronologie fixe, où le futur n’est pas changé par les actions du voyageur dans le passé et le font donc exister à deux époques différentes à la fois (ex. Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, J. K. Rowling).
Dans le roman de Lefebvre, la nouvelle réalité n’est pas un monde parallèle qui s’ajoute à tous les autres créés par les voyageurs, mais bien une nouvelle réalité qui fait disparaître l’originale, qui ne reste vraie que dans les souvenirs des voyageurs. Il est donc surprenant qu’au départ, Inock offre à René de reculer dans le temps seulement de quelques jours afin de résoudre le meurtre, alors que voyager dans le temps change le futur totalement, à moins que les personnages décident de rester dans le passé et de revivre ces quelques jours jusqu’à leur point de départ. Cela ne semble pourtant pas être une option lorsque René, sachant que sa réalité originale n’existe plus, caresse l’idée de rester en 1584.
De toute façon, l’auteur n’offre jamais la réponse à cette question, préférant prétexter un problème technique de l’appareil qui les enverra plutôt près de quatre cents ans dans le passé. Ainsi, au contraire des récits de voyage dans le temps tel que le film Retour vers le futur, René et Inock ne sont jamais confrontés à eux-mêmes plus jeunes ou à des personnes de leur entourage. Ce faisant, il est assez incroyable qu’un voyage aussi loin dans le passé puisse éventuellement transformer la totalité de leur époque d’origine en une réalité totalement nouvelle.
Le plus gros problème du roman se trouve dans son dénouement en rapport avec le type de voyage dans le temps qui y est illustré : étant donné que la réalité de départ est changée du tout au tout par la simple apparition des voyageurs dans le passé, cela crée un paradoxe qui démolit la logique interne du voyage dans le temps dans ce roman, puisque les voyageurs ne devraient pas exister : leurs parents, s’ils existent encore, ne sont même plus leurs parents, probablement qu’ils ne se connaissent même pas. Ainsi, les voyageurs, dans un tel type de voyage, devraient automatiquement disparaître dès que l’appareil arrive dans le passé, annihilant toute trace de leur propre existence.
La logique intrinsèque de la chronologie dynamique n’a pas été respectée ici et n’a pas du tout la même profondeur que le paradoxe du grand-père illustré par Barjavel. Le récit ne semble tout simplement pas avoir été réfléchi jusqu’au bout. Même le questionnement moral d’un tel voyage aux conséquences radicales est laissé de côté, alors qu’il élimine en un sens le concept de libre arbitre de tous les personnages disparus des réalités originales, et met tout le poids des décisions sur les gens qui ont accès au voyage dans le temps. Un des deux voyageurs est expérimenté, mais se demande-t-il seulement si ce qu’il fait est correct ?
Ce roman était peut-être une nouveauté fascinante en 1978, mais de nos jours, malgré un thème qui fascine encore et toujours les lecteurs, il s’en dégage une dose d’amateurisme qui n’est pas sans rappeler des récits de fanfiction, donnant ainsi l’impression d’une œuvre inachevée et le goût amer d’une lecture sans conclusion digne de ce nom. [SG]
- Source : Les Années d'éclosion (1970-1978), Alire, p. 287-291.
Références
- Chabonneau, Hélène, Lurelu, vol. 2, n˚ 1, p. 9.
- Cloutier, Georges Henri, Dictionnaire des œuvres littéraires québécoises VI, p. 900-901.